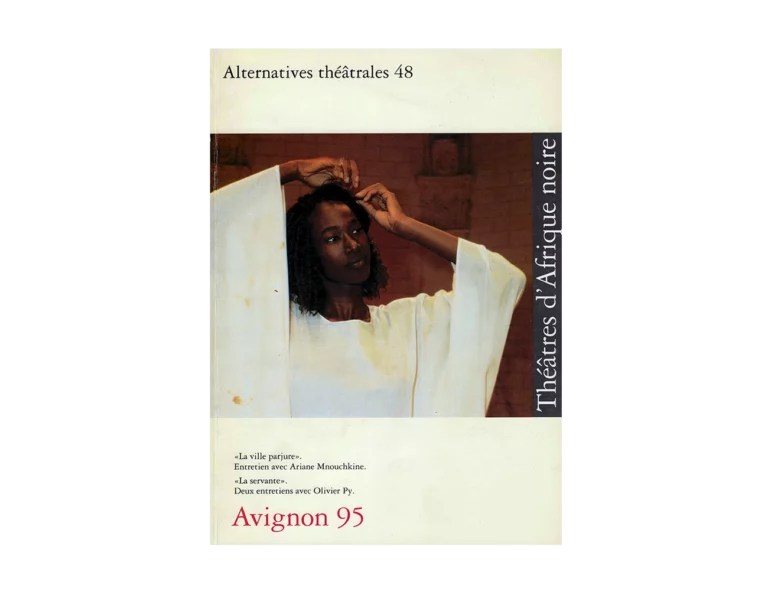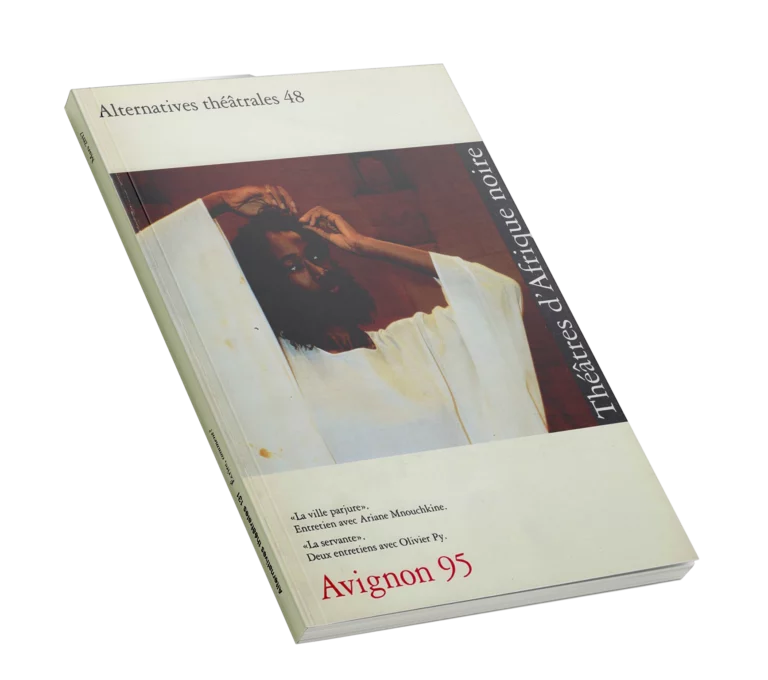La MÈRE de Bertolt Brecht, une création du Groupov mise en scène par Jacques Delcuvellerie est, après L’ANNONCE FAITE À MARIE de Paul Claudel et TRASH, À LONELY PRAYER de Marie-France Collard, le troisième volet d’un tryptique que le metteur en scène a centré sur la question de la « vérité ». Le numéro 44 d’Alternatives théâtrales (juillet 93), intitulé « Théâtre et vérité », a consacré un dossier au Groupov et reproduit dans sa totalité la longue lettre de Jacques Delcuvellerie, « À celle qui écrit Lulu-love-life », dans laquelle il expose et théorise les fondements de sa pratique théâtrale et de celle du Groupov.
JACQUES DELCUVELLERIE : Le désir de parler de l’aspect artistique de LA MÈRE, de sa mise en scène et de l’influence que Brecht a pu avoir sur notre propre travail vient avant tout d’un événement :la vision du film de la mise en scène de LA MÈRE réalisée au Berliner Ensemble. Ce film a été un choc : un choc lumineux. Ça m’est apparu comme une manière de faire du théâtre hautement déconcertante et troublante, dont je n’ai que très progressivement compris la complexité, la subtilité, l’intelligence. Ce n’était pas une approbation immédiate ;oui il y avait une approbation globale, je sentais que c’était vraiment dans ce sens-là qu’il fallait travailler, mais en même temps, j’étais choqué. Alors que depuis maintenant très longtemps, j’ai beaucoup lu Brecht, tous les écrits, le journal de travail, j’ai vu les films, écouté les musiques, des tas de versions différentes, des interprétations de ses poèmes, j’ai vu des mises en scène célèbres et d’autres inconnues…, mais je n’étais pas préparé à voir la mise en scène de Brecht lui-même. Ça m’a totalement surpris et cela continue à me paraître un théâtre surprenant.
Anne-Marie Loop : Jacques parle du terme lumineux. Moi, je dirais : discrétion, épuration, une ligne pure, simple, calme. Je me souviens d’une conversation tout au début où Jacques disait : « Ça va être un travail assez dur pour les acteurs, parce que souvent ils demandent (avec de nobles motifs) des numéros. Ils aiment plutôt jouer des héros, avec une expressivité où l’acteur va chercher à l’intérieur de lui, avec sa vérité, son rapport au monde, quelque chose d’intime pour le donner à voir. » Et Jacques continuait : « avec cette pièce ce sont des héros du travail de taupes, oui, plutôt des héros anonymes qui choisissent ce chemin… »
J. D.:.… et à qui on n’érigera jamais de monument, comme Brecht l’explique très bien dans son poème aux ouvriers-acteurs de New-York. Il y a quelque chose dans le théâtre de Brecht qui est ce vers quoi l’acteur spontanément n’a pas de chemin facile. Il n’y a pas de grand personnage. Même la mère, présente dans toutes les scènes, (ce qui est peut-être unique dans une pièce de théâtre) est avant tout un personnage qui réagit et non pas qui tire la scène. Et c’est une toute petite madame. Mais que j’ai eu un choc montre à quel point nous ne prenions pas au sérieux ce que nous avions lu et ce que nous disions nous-mêmes. Plusieurs choses étaient pour moi tout à fait connues mais je n’en aurais jamais imaginé l’audace réelle. Et d’abord, c’est la confiance faite à la fable, complètement. C’est-à-dire : la fable d’abord. Il s’agit de raconter cette histoire exemplaire, qui est comme un mystère du Moyen-Âge, comme un fabliau, une histoire avec une morale, une pièce didactique. Il s’agit de lui faire confiance. Personne en tant qu’acteur ou collaborateur du spectacle ne peut se mettre en avant. C’est la fable qui compte. À ce point là c’est rare. Pour donner un exemple concret, il y a un refus d’exploiter systématiquement tout ce que le rôle permet. Quand on lit la pièce, très riche, très intelligente, émouvante, drôle et en même temps par moment effectivement très rigoureuse, très enseignante, on voit qu’il y a des scènes, des personnages, où si l’acteur veut exploiter le texte avec tout ce qu’il permet, il y a moyen de se faire une petite fête du théâtre au sens habituel du terme. Mais quand on regardait la mise en scène de Brecht, c’était curieux, il n’exploitait pas la moitié du matériau. Et pourtant il était parfaitement conscient de tous les ressorts dramatiques possibles. À chaque fois, il faisait les choix de ce qu’il fallait mettre en avant. Et sans doute que la différence avec un autre metteur en scène provenait de ces choix. Mais, en tous cas il ne décidait jamais d’exploiter à fond chaque élément.
Le deuxième point c’était que tous les personnages étaient crédibles. Tous les personnages étaient, on pourrait dire, joués par de grands acteurs. Alors que la manière de jouer, enfin ce qui est dit, n’est pas entièrement réel : la scène du 1% mai est déjà écrite sous forme de compte rendu : « dis-je, dit-il » , etc. et cette distanciation crée un effet émotionnel supplémentaire. Mais, à l’intérieur de cette chose qui n’est pas réaliste, du dispositif qui ne l’est pas, de la musique qui vient faire contrepoids, il y avait une densité de réalité de chaque être qui était très impressionnante.
La crédibilité est inséparable de ce grand calme qui nous a frappés dans la mise en scène de Brecht, l’extrême calme de tous les acteurs, du jeu même dans les situations tendues, et dans l’exécution des chants. Ce calme est tout à fait essentiel et il est profondément historique. Il a une signification historique et pose une difficulté historique aux acteurs d’aujourd’hui. Ce calme est tout à fait nécessaire parce que la pièce est politique et militante. Même si elle comporte des aspects mythologiques, même si comme Barthes l’analyse très bien (dans un texte paru en 1960 dans la revue Théâtre Populaire) elle est aussi une pièce de la maternité, vue d’un point de vue matérialiste et dialectique, même s’il y a toutes ces dimensions secondaires, elle est une pièce militante et politique. À cette fin, il est essentiel qu’elle soit faite avec ce calme, c’est-à-dire par des gens convaincus. Et pas du tout avec des gens véhéments, qui se font croire (et qui donc ne nous feront jamais croire) à la réalité de ce dont il est question. Il y a donc un contenu politique à ce calme. Ce contenu politique signifie qu’il s’agit d’une personne pour qui c’est réellement une conviction et la pratique de tous les jours. Et qui en parle comme à un ami. Peut-être à un ami même très lointain. Peut-être à un ennemi temporaire. Mais dans le désir de lui exposer ce qu’il croit si profondément que cela ne comporte aucune forme d’agression. Et la nervosité, déjà c’est une agression. Cela paraît sur scène comme un manque de certitude.
Le deuxième élément philosophique en scène dans ce calme, c’est qu’il y est une projection du futur. Non seulement la pièce dépeint un petit groupe de militants qui traverse des périodes très diverses de répression, et puis finalement la guerre jusqu’à la révolution de 1917, mais elle doit donner à voir, dans les rapports entre ces gens et dans la manière dont ils se comportent déjà, quelque chose de la société future, rêvée, imaginée, entrevue et pour laquelle ils luttent. C’est-à-dire qu’il y a déjà dans la manière de se comporter entre eux, quelque chose de ce qu’ils espèrent réaliser plus tard, qui est au travail. Et nous voyons que c’est un comportement, comme dirait Brecht amical mais sans concession. Dans Les petites réunions militantes du début de la pièce, si quelqu’un a quelque chose à dire, et bien il pousse l’autre, pas brutalement, mais pour dire : « c’est à moi je parle ». Tout le monde est dans des rapports cordiaux, mais sans chichis, sans trop de politesse. Comme des gens réunis uniquement en fonction d’un but, et que cette réunion rend meilleurs, car le but est évidemment plus important que leurs histoires personnelles. Et donc il doit y avoir également chez les acteurs chargés de les représenter une forme de ce calme. Pour que ce dont il est question à travers cette représentation ait déjà une forme de réalité tangible sur scène. Il est vrai que des acteurs comme Busch et Weigel, au moment où le film est réalisé doivent vraiment croire que toutes les épreuves qu’ils ont traversées (il y en aura encore d’autres bien entendu) avaient un sens. On leur a rendu un théâtre dont les nazis les avaient chassés, la guerre a été gagnée, essentiellement par les communistes et par l’Union Soviétique. Ils sont en train de parler de quelque chose qui est en train d’avoir lieu, sans aucun triomphalisme, mais quand même avec une profonde confiance en soi, ce qui n’est pas du tout notre situation aujourd’hui. Donc, à tous les égards le problème du calme est aussi un problème de distance historique. Nous avons passé beaucoup de temps à lutter contre la tachycardie de l’énervement et l’histrionisme habituel de nos acteurs et : nous avons aussi lutté contre le pseudo-calme à l’allemande. Évidemment, nous ne pouvons pas avoir le même calme et donc nous ne pouvons pas, sauf en étant des irresponsables, entièrement le viser. Nous devons savoir qu’il y avait ça dans le désir de Brecht, déjà dans l’écriture de la pièce, et comme metteur en scène quand il l’a fait, et dans le film quand nous le voyons. Nous serions fous de prétendre l’incarner complètement aujourd’hui, parce que nous ne sommes pas dans la même situation historique et parce que notre spectateur n’est pas dans la même situation historique. On ne peut pas entièrement le faire comme cela, mais on doit savoir que c’est essentiel. On doit en tenir compte.

Comment donner du réel (volonté, ruse, humour, peur) à des gens vivant sous un régime de terreur policière (la Russie tsariste, pays le plus arriéré d’Europe au niveau industriel et agricole, était le régime policier le plus sophistiqué du monde), et qui sous ce régime visent à renverser et à détruire le pouvoir d’État, sérieusement, et peu importe le délai. Nous avons visionné un certain nombre de documentaires où on peut rencontrer ce type d’êtres humains à travers le monde, même si l’expérience justement paraît loin de la pièce. Par exemple nous avons visionné un très beau documentaire sur trente ans de guerre populaire en Erytrée jusqu’à la conquête du pouvoir. Et la toute première chose qui nous frappait tous en voyant s’exprimer ces gens qui avaient perdu trois, quatre enfants dans la guerre, c’était leur calme et leur détermination. La manière très simple dont ils exprimaient des convictions qui étaient complexes et qui s’enracinaient dans des sentiments humains très profonds. Nous retrouvions ce que la mise en scène du Berliner communique. On en a vu d’autres sur l’Amérique latine, sur l’Asie, etc.
Les porteurs de paroles, les personnages doivent être extrêmement denses, concrets, mais quand on essaye de leur faire jouer vraie une conversation réaliste ou une bagarre, très vite ça s’effondre. On sent qu’on est en train d’essayer de séduire le public mais qu’on ne raconte pas ce dont il est question. Et qu’on s’éloigne de cette représentation dont on vient de parler : celle d’un autre monde, où les rapports ne seraient pas concurrentiels et pressés. Respecter la structure de l’écriture et faire confiance à la fable, sans que ça nous dispense du tout de créer de la densité dans les rapports et dans les porteurs de paroles, les personnages, c’est un point essentiel. Mais inversement, en tant que fable dramatique, la pièce est incroyablement bien construite. Elle comporte aussi tous ces petits plaisirs dont l’acteur a besoin pour aimer aller sur le plateau. Il n’y a pas un rôle qui n’ait pas sa chanson, chacun a au moins un vrai petit moment, même si ce n’est qu’une réplique ou une entrée, et qui a du sens et fait de l’effet, il y a, au vieux sens du terme, des coups de théâtre. Par exemple après la scène où on voit Le mieux les rapports d’affection et de compréhension entre la Mère et son fils, quand Pavel revient de Sibérie, après la chaleur des retrouvailles et du travail commun, juste après Ça, avec une brutalité terrible, dans la scène suivante, Pélagie apprend que son fils est mort, fusillé.. Tout le temps les vieilles lois de l’économie dramatique sont présentes, mais dans une autre dramaturgie et donc elles apparaissent masquées. Les gens innombrables qui ont écrit que c’étaient des pièces didactiques, « des cours du soir pour attardés » (Le Figaro), etc. , n’ont évidemment jamais remarqué ça, tellement ils étaient contre ce que ça raconte. Les chants, par exemple, présentent une très grande variété : éloge funèbre, marche de combat, chant de protestation, berceuse, récit parlé, choral, fugue. Il faut comprendre comment chaque genre est choisi en fonction du propos de chaque scène, comprendre cette architecture c’est déjà mettre beaucoup de chances de son côté.
Nous avons eu la volonté de considérer l’ensemble des propositions qui nous ont été léguées, au point de vue musical, scénographique, de jeu, etc. , comme une indication dont nous devions repartir, que non seulement nous ne rejetions pas a priori, mais que nous devions assumer. Et nous avons constaté dans le processus de travail que chaque fois que nous ne commencions pas par là, nous faisions fausse route. Par contre en adoptant l’attitude de repartir d’abord de l’héritage, nous créions nécessairement une interprétation nouvelle, puisque nous vivons dans un temps différent, puisque nous n’avons pas vécu les mêmes choses, puisque les acteurs n’ont pas le même physique, n’ont pas le même passé, etc. Progressivement, en acceptant d’abord dans l’humilité de repartir de cet ensemble de propositions nous trouvions des choses différentes, je ne dis pas meilleures, mais en tout cas différentes, et qui nous semblaient plus justes pour notre représentation. Cela veut dire que concrètement, oui, dans la scénographie, il y a un tas de choses qui évoquent la scénographie de Brecht, mais ce n’est pas la même. Il y a des scènes où la mise en place est en partie la même et d’autres pas du tout. Et puis on finirait par croire que nous faisons une fixation morbide sur Brecht, mais on a aussi vu un tas d’autres choses : la mise en scène de Sobel ; nous avons vu un film de la mise en scène de 1970 de Stein à la Schaubühne avec Theresa Ghiese, un monument. Mais, au bilan, c’est très clairement chaque fois du côté de la mise en scène de Brecht que ça semblait le plus juste. Bien que je crois que la mise en scène de Stein à ce moment-là, en Allemagne était une mise en scène juste, profondément intéressante, mais provocatrice. Nous n’avons pas adopté les mêmes solutions parce qu’il me semble aussi intéressant, ça c’est encore un aspect de la mise en scène, de réaffirmer nettement hautement, explicitement, Brecht aujourd’hui. Il ne se porte pas si mal. On n’a jamais écrit autant de livres contre lui etona pendant dix ans joué toutes ses pièces de jeunesse et les grandes fables qui n’ont pas l’air trop politiques. Mais personne ne veut le réaffirmer comme un auteur révolutionnaire. On ferait une anthologie extraordinaire de tous les livres et articles disant qu’il est bon malgré ce qu’il pensait. Nous n’avons pas adopté la même attitude, nous Le prenons avec ce qu’il pensait, intégralement. Et quand il paraît y avoir contradiction dans ses écrits ou ses actes, nous ne partons pas de l’hypothèse du rusé renard hypocrite, mais nous cherchons où se trouve l’unité fondamentale sous la contradiction.
Quand à la question de la distanciation qui a fait couler tellement d’encre, mon opinion là-dessus bien avant de voir le film de Brecht ou celui de Stein était que le problème n’a plus de sens en ce qui concerne la représentation d’une pièce comme La MÈRE. D’abord le théâtre, dans son entier y compris celui qui se veut Le plus naturaliste ne produit plus du tout l’effet de naturalisme ou de réalisme que Brecht critiquait à son époque. C’est impossible de le produire tout simplement à cause du cinéma, de la télévision, de tous les arts du réalisme immédiat. Quiconque va aujourd’hui s’enfermer dans une salle de théâtre y voit du théâtre, et rien d’autre. Ici, de surcroît, LA MÈRE est écrite par l’homme qui a énoncé cette théorie, qui l’a perfectionnée, qui l’a faite sienne et lui a donné un statut essentiel. Il l’a écrite en pensant à la manière de la représenter, à la fois écrivain et metteur en scène, donc le travail de distanciation est déjà largement fait dans la pièce même. Il est impossible de la représenter en s’abandonnant au théâtre romantique ou expressionniste, sauf à démolir complètement ce qu’elle exprime et qui la rend belle, drôle et émouvante.
Donc, au contraire, et avec aussi tout ce qu’on a raconté avant sur le fait qu’on est dans un effet d’éloignement historique par rapport à la révolution (sinon par rapport à sa nécessité en tous cas par rapport à celle qui a existé et par rapport à celle qui pourrait venir), notre effort ne devait pas du tout porter sur comment distancier une pièce écrite par l’inventeur de la distanciation, mais comment lui donner de la densité et de la réalité pour nous. Et ce faisant parce qu’elle paraît justement loin de notre époque, elle nous parle très fort et très brutalement d’aujourd’hui.
Propos recueillis par Laurence Gay et Benoit Vreux
LA MÈRE
de Bertolt Brecht
D’après le roman de Maxime Gorki
Une création du Groupov
Musique :
Hanns Eisler
Texte français :
Maurice Regnaut et André Steiger
(Éditions de l’Arche)
Mise en scène :
Jacques Delcuvellerie
Direction musicale :
Geneviève Foccroulle
Scénographie :
Johan Daenen
Costumes :
Greta Goiris
Avec : Anne-Marie Loop (la Mère), Mireille Bailly, Luc Brumagne, Denis Closset, Thierry Devillers, Francis D’Ostuni, Luc Dumont, Cathy Galétic, Olivier Gourmet, Bernard Graczyk, Gil Lagay, Francine Landrain, Martine Léonet, Henri Monin, Délia Pagliarello, Max Parfondry, Lara Persain, Rosaria Puma, Michel Ratinckx, Marie-Rose Roland, Maurice Sevenant, François Sikivie, Mathias Simons, Véronique Stas, François Vincentelli
Piano : Geneviève Foccroulle
Trompette : Marc Frankinet
Percussions : Michel Debrulle
Trombone : Michel Massot
Coproduction Groupov, Théâtre National de la Communauté française de Belgique, Centre dramatique de la Communauté française — Théâtre de la Place (Liège), La Monnaie-De Munt/Opéra National, Théâtre de la Renaissance.