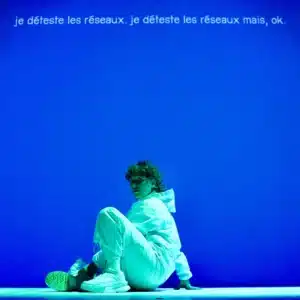Dans Performing Art, on assiste pendant près d’une heure à l’installation et au décrochage d’expositions éphémères, conçues à partir d’oeuvres de la collection du Centre Pompidou. Des techniciens entrent sur scène, poussant des caisses de bois contenant des oeuvres de formats très variés (tableaux, photographies, objets…) qu’ils déballent avec soin. Sous le regard d’une conservatrice du musée, qui veille aux conditions dans lesquelles l’installation a lieu, ils s’attellent alors à agencer l’espace, assemblant les oeuvres, les posant au sol ou les accrochant au mur blanc qui occupe le centre de la scène.
Puis ils disparaissent en coulisse, laissant pendant quelques dizaines de secondes l’exposition se déployer sous les yeux des spectateurs. Avant de revenir pour faire le chemin à l’envers : décrocher, démonter, emballer, ranger, fermer les caisses et les pousser hors de scène. Chacune des installations dure de dix à quinze minutes, seules deux projections vidéos (dont une clôt la performance) venant rompre cette mécanique rigoureuse.
Le Noé Soulier qui se dévoile ici semble être davantage le titulaire d’un master en philosophie que le chorégraphe. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas le processus créatif, mais l’art comme agencement, représentation et mise en scène d’un geste et/ou d’une intention matérialisés sous forme d’objets. L’art en train de se faire, non en train de naître d’une intériorité individuelle, pas vraiment non plus comme impression laissée sur la rétine, les neurones ou le coeur du regardeur (l’exposition, une fois l’installation achevée, ne se donne à voir que très brièvement) ; plutôt comme expérience sociale, façonnement d’un cadre permettant de dire, comme y invitait le glissement du philosophe Nelson Goodman, non pas ce qu’est l’art, mais « quand y a‑t-il art ».
« Performer l’art », ici, c’est donc performer les coulisses du monde de l’exposition et leur faire investir la scène ; ouvrir, comme y invite Bruno Latour, sociologue curieux de la manière dont on fait « tenir la réalité », les boîtes noires de l’art. Et pour cela, suggère Performing Art, il y a bien des boîtes à ouvrir, requérant des outils et des manipulations ; des gestes à faire, minutieux et rodés ; des manières de faire ensemble et de s’ajuster pour déplier, ranger, faire tenir, proprement et avec soin ; des chariots, des trous, des soudures, et les bruits qui vont avec. L’art est une performance équipée. Si les arts plastiques sont un processus concret, semble dire Noé Soulier, sa matérialité ne se livre pas uniquement dans l’extase sauvage d’un Jackson Pollock ou les rituels d’un Yves Klein baignant les corps dans la matière avant d’en recueillir l’empreinte, en somme dans ces engagements physiques de plasticiens qui se prêteraient presque naturellement à la chorégraphie. Noé Soulier regarde ailleurs ce qui danse, ou du moins ce qui bouge : dans les bruissements mêlés des objets et des hommes, dans ce travail modeste avec les choses, dans les coopérations intimes qu’elles exigent pour former le musée.
Il déplace aussi notre attention de spectateur, en jouant sur l’inversion des temps. L’installation s’étire : pousser les chariots, ouvrir les caisses, sortir les oeuvres de leurs emballages, s’assurer que l’accrochage est droit, donner la juste place, et tout refaire à l’envers. Tout ce travail exige du temps, beaucoup ; c’est le temps de ceux qui s’effacent ensuite, auquel nous n’accordons jamais le nôtre, et que Noé Soulier prend et nous donne. Ensuite, les oeuvres semblent tenir toutes seules et la scène se vide ; nous sommes comme au musée, laissés face à leur mystère. Mais cela ne dure pas, et surtout, ce n’est nullement comme au musée : le temps si bref de la contemplation est habité par les présences qui viennent de s’évanouir, les mains expertes et vigilantes tournant encore, invisibles, autour des oeuvres (re)devenues solitaires, passées à d’autres yeux. On les a vues comme des objets à placer, à prendre et à ranger, on les voit maintenant cristallisées dans l’écrin de l’espace d’exposition, art pour un temps, très court.

Noé Soulier aborde ici des questions passionnantes, philosophiquement et sociologiquement. Comment les choses se mettent-elles à fonctionner en tant qu’oeuvres d’art ? À partir de quand les voit-on autrement ? Comment traite-t-on avec elles, avant qu’elles soient là pour être regardées ? Que se passe-t-il, qui les transforme en autre chose ? Depuis un siècle, bien des artistes et bien des chercheurs se sont précisément pensés sur cette fabrication de l’art comme monde en soi. Duchamp, en posant son urinoir, dresse un constat du point de vue du créateur : un objet fonctionne comme objet artistique par le choix de l’artiste. Le brouillage des catégories entre art et non art, la tension entre l’oeuvre comme produit et la création comme processus, traversent tout l’art contemporain depuis son éclosion. Du côté des sciences sociales, on explore l’art comme production sociale : les « mondes de l’art » sont tissés de collectif, insiste Howard Becker à la fin des années 1980. Des sociologues, à l’instar de Nathalie Heinich ou Roberta Shapiro s’intéressent quant à eux aux processus de qualification. L’« artification » désigne ce « passage à l’art », l’entrée d’une pratique dans le champ artistique, qui requiert aussi bien des corps que des institutions, des lieux, des normes ou des gens. Car les chercheurs ne se focalisent pas uniquement sur l’échelle macro et l’institutionnalisation : les sociologues qui s’inscrivent dans le sillage pragmatique depuis la fin du xxe siècle scrutent tout ce qui est mobilisé concrètement par des acteurs engagés, en situation, pour faire exister une réalité particulière – qu’il s’agisse de la science (Bruno Latour), du bien (Laurent Thévenot et Luc Boltanski) ou de l’art (Antoine Hennion).

Assurément, Noé Soulier engage une discussion avec ces courants de réflexion particulièrement stimulants. On peut toutefois se demander s’il s’agit bien d’un dialogue, ou s’il ne verse pas plutôt dans l’illustration de théories, de manière finalement assez scolaire. On comprend bien de quoi il est question : l’art se passe avant l’exposition, performer l’art revient à activer les oeuvres en tant qu’oeuvres, ce travail requiert des gestes et des corps bien au-delà de ceux de l’artiste, l’art est une construction hybride, etc. Pour le spectateur, la situation est plutôt confortable : depuis son fauteuil, il est en train de se dire à lui-même que le chorégraphe est en train de lui dire qu’il est en train de regarder une performance qui montre ce qui normalement se dérobe à la performance et qui fait performance par le fait même que lui, spectateur, est installé dans son fauteuil. Il active ainsi la performance de Noé Soulier à l’instar des techniciens activant le potentiel artistique des objets manipulés. Mais en dehors de la démonstration, on s’interroge : qu’est-ce que la performance apporte au-delà de ce que son résumé couché sur le papier suffirait à expliquer ? Les gestes, les corps, les images et les objets sont bien là, mais comme saturés de concept.
Performing Art tend à nous faire regarder ailleurs et autrement, mais l’intention marquée ne suffit pas toujours pour qu’il se passe quelque chose entre les choses et nous. Car c’est peutêtre précisément en s’en tenant à des formules laconiques et tautologiques que des artistes comme Franck Stella (« ce que vous voyez, c’est ce que vous voyez ») sont parvenus à créer des oeuvres qui nous apprennent à regarder autrement – sans sous-texte pour nous dire où, comment et pourquoi. Du côté des arts de la scène, Jérôme Bel, dans les années 1990, avait déjà frotté sa chorégraphie aux objets du monde matériel dans Nom donné par l’auteur – sa performance était certes nourrie par de nombreuses références (Barthes, Duchamp, Cage, etc.), mais elle témoignait d’une recherche personnelle et d’une radicalité autres autour de l’envie d’« activer le spectateur ».