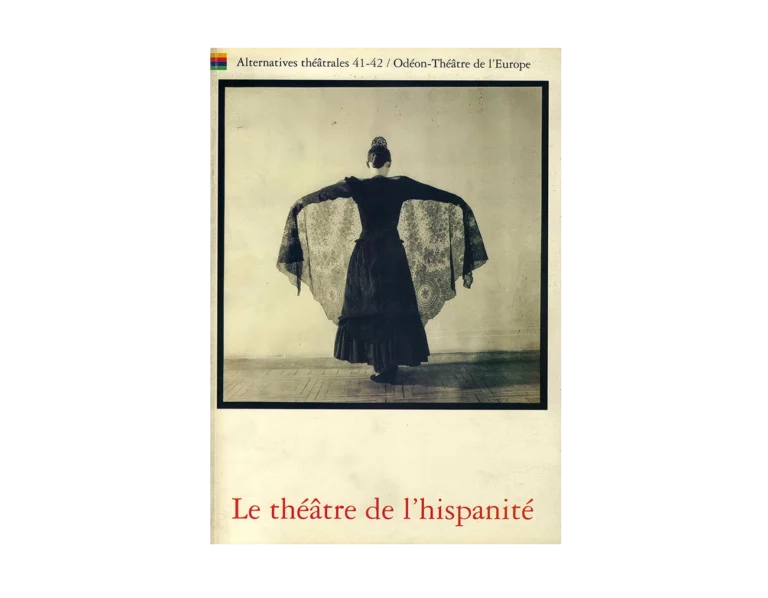ON a trop disputé, ici et là, de ce que l’on nomme l’esprit des peuples. J’ai lu Taine et Spengler, d’autres encore, sans que leurs arguments me convainquent. Car ce qui manque toujours à ces démonstrations impeccables, à ces parallèles séduisants entre les cultures et les civilisations, c’est, je le pense chaque jour davantage, moins l’étude que l’expérience intime de l’idiome où chacune d’elles s’est exprimée. C’est là, et nulle part ailleurs, que bat le cœur secret d’une nation — je le dis hors de toute considération politique ou partisane — et c’est à l’écoute de ce battement verbal que l’on appréhendera la personnalité d’un peuple, ce qui fait de lui, non pas seulement une entité historique, mais un corps vivant qui s’aventure à travers le temps et l’espace, avec ses désirs et ses peurs, avec surtout cet étrange regard qu’il est seul à porter sur l’immédiat et sur l’inaccessible.
Ainsi voyais-je, à travers l’espagnol, se dessiner une Espagne plus véridique, plus déroutante aussi que celle dont on m’avait entretenu. Ce qui ne cessait de me requérir dans l’espace de la langue française, c’était l’extraordinaire transparence qu’elle promettait à l’esprit dès lors qu’il s’aventurait dans l’entrelacs ombreux des apparences. Rien d’opaque, rien d’incertain qui ne soit comme filtré, délivré de ses intrications malignes par le truchement des concepts, par l’ordonnance d’une pensée, maîtresse de soi-même et du monde. Nul besoin, pour cela, de recourir à Montaigne à Montesquieu, à Valéry. Il semble que chaque individu de langue française, par le système linguistique dont il dispose, ait la capacité de distribuer les éléments du réel en quelques catégories très claires, invulnérables à l’erreur, à l’usure du temps, au dessein capricieux des circonstances. Je ne trouvais plus rien de cette assurance au cœur de la langue espagnole. Elle prenait appui, certes, sur une sorte de substrat originel, une solidité du sensible qui communiquait à ses mots comme une énergie heureuse, surabondante de sèves et de sucs. J’oserai dire qu’en parlant l’espagnol on éprouve quasi matériellement la sensation d’avoir comme un peu de réel dans la bouche, non seulement parce que les vocables y sont empreints d’une consistance sonore, d’une épaisseur vocale que le français ne connaît pas, mais surtout par le fait, difficilement explicable à un étranger, que le mot semble tenir, de toute sa force obscure, à La chose qu’il prétend convoquer. La distance entre le signe verbal et son référent — pour user d’une terminologie commode — tend ici à se réduire, à n’être qu’un recours de l’entendement et non point une expérience vécue par les sens. Au reste, la richesse et l’ampleur du vocabulaire ayant trait à l’univers du sensible attestent bien le souci qu’a l’espagnol de se détacher le moins qu’il le peut des phénomènes immédiats, de leurs variations, de leurs mouvances particulières. Là où le français s’applique avec une ténacité admirable à reconnaître, sous le particulier, l’immutabilité d’une essence, l’espagnol prend plaisir, semble-t-il, à répertorier ce qui distingue précisément tel bruit de tel autre, telle nuance de rouge ou de gris — au point, parfois, de se perdre dans la pluralité des possibles. Mais quel bonheur aussi est réservé à celui qui, sur tout spectacle du visible, a la chance de poser le mot juste, le mot unique, alors que le français, s’il lui prend envie de rendre compte de l’éphémère et du particulier, se doit de réunir périphrases et qualificatifs autour d’une notion toute abstraite.
Mais cette profusion a son revers qui fait de l’espagnol moins une langue incertaine que traversée d’absence. Le français n’a rien à craindre du monde puisqu’il s’en sépare. L’espagnol ne connaît pas ce recours ; il épouse les aléas de l’immanence, il en subit aussi toute l’ambiguïté. On dirait que dans le jardin édénique des apparences un serpent subtil s’est insinué, un questionnement, un doute subreptice qui ronge par le dedans la belle quiétude des phénomènes, qui porte atteinte à leur innocence première, à leur santé. Je ne sais si mon récit, d’une symbolique un peu trop simple, peut avoir quelque valeur éclairante pour un lecteur français qui ignore tout de ces périls, puisque sa langue l’en sauvegarde si vite. Je m’étais, moi aussi, composé une seconde nature trop française pour saisir clairement ces tentations de négativité auxquelles la langue espagnole est soumise.
Elles étaient inhérentes au génie singulier de cet idiome, mais je n’avais pu, trop longtemps, que les endurer, sans même en soupçonner l’origine. Ce vieux compagnonnage avec le vertige me rendait, toutefois, la tâche désormais plus facile, moins périlleuse plutôt, pour sonder les gouffres où cette langue espagnole, anxieuse néanmoins de vivre, ne manquait pas de s’aventurer. Je m’y risquais avec elle ; je descendais jusqu’où elle voulait me mener ; j’écoutais sourdre de ses mots, de l’agencement superbe de ses phrases, une plainte nocturne et noire.
Lisant Quevedo et Jean de la Croix, mais Cervantes aussi bien, où l’enjouement n’est qu’un masque, je faisais à travers eux ce que j’appellerai une expérience métaphysique du manque. Expérience à laquelle pas un écrivain de langue française ne m’avait jusqu’alors confronté, ni même Pascal en qui le doute, comme chez Descartes, est moins ressenti que recherché à des fins apologétiques. Mais ici, à travers ces mots qui tentaient de rejoindre une certitude, que de menaces, que de présages d’une catastrophe déjà inscrite dans le devenir du monde ! L’appel du néant figurait sans relâche une sorte d’horizon désert, un crépuscule pour l’esprit auquel il fallait bien que celui-ci se résigne, quand il n’en hâtait pas la venue dans les consciences les plus farouches. Oui, la langue espagnole est marquée du sceau de la nuit, et son versant de soleil, auquel on s’attache volontiers, ne fait que rendre plus poignante la ténèbre qui le gagne et qui, comme fatalement, tente de l’offusquer. Je retrouvais quelque chose de cette vocation nocturne parmi ceux-là même qui s’en défendaient le plus ou qui la baptisaient d’un nom de lumière. Je songe ainsi, dans LE CANTIQUE SPIRITUEL de Jean de la Croix, à ce vers qui défie toute traduction et qui recueille en quelques mots très simples le génie majeur de l’Espagne, son ardeur de vie et son destin de déréliction : « Un no se qué que quedan balbuciendo…» Ce je-ne-sais-quoi, que des lèvres parviennent mal à dire, qu’est-ce donc, sinon l’acquiescement de l’âme à une plénitude qui se donne tout à la fois et se refuse dans la substance d’un peu de pain ou dans ces mots à jamais réunis ensemble ? Cette impérieuse provocation des sens, ces sortilèges si insinuants d’un hédonisme portaient en eux, sinon leur contraire, du moins ce qui contrecarrait leur pouvoir. Il suffisait que l’on s’attarde un peu plus dans ce jardin mélodieux des apparences pour que se lève une autre voix, récusant le réel, en dénonçant l’incomplétude et l’illusion latente, prêchant à l’homme une sorte de solennel désabusement auquel l’espagnol a donné le nom, intraduisible en français, de desengaño. Je le retrouvais, cet appel ombreux, chez Quevedo plus que chez quiconque, lorsqu’il avait forcé la syntaxe de sa langue à exprimer en une ligne étonnante le harassement de l’Être à travers le temps : « Soy sn fue, un ser y un es cansado ». Et je laissais cette phrase terrible s’emparer de moi, jusqu’à ce qu’elle m’emporte au plus désolé de ses dédales — par la seule vertu de trois temps de verbe devenus soudain des vocables morts.
Claude Esteban in LE PARTAGE DES MOTS, Gallimard, 1990.