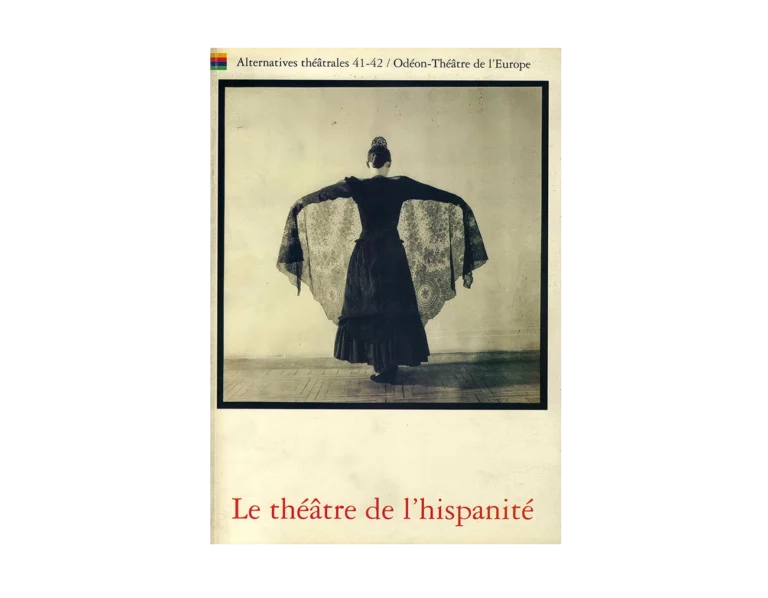COMME Abraham revenait d’une expédition victorieuse contre quatre rois, Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Cette offrande est, dans la Genèse, la plus lointaine annonce de l’Eucharistie.
Le repas du Seigneur eut lieu la nuit où il fut livré. L’apôtre Paul en recueillit le récit au printemps de l’an 57 et l’Église en commémore l’institution au soir du Jeudi Saint. Mais ce soir-là, les lumières ont beau être vives, les fleurs immaculées comme les nappes, le cœur des convives n’y est pas. La douleur du lendemain est trop proche.
C’est un autre jeudi, fin mai ou début juin selon le calendrier, quand le cortège des Pâques et du Temps Pascal est achevé, que le peuple chrétien célèbre au soleil, en plein air, le banquet divin et son pacte avec l’éternité, Il s’agit de la Fête-Dieu ou Corpus Christi.
Dans cette religion on n’est finalement triste que pendant le Carême. Il y a tant de raisons de se réjouir et, en conséquence tant de fêtes que la Très Catholique Espagne du Siècle d’or chômait une bonne partie de l’année. Des esprits chagrins ont vu là une des raisons de son retard économique. Nous préférons y voir l’avancée d’un genre théâtral unique dans l’histoire de la pensée : l’acte sacramentel.
Le culte du Rédempteur ayant, sous CharlesQuint, pris le pas sur le culte des saints, la grande fête printanière du Corpus Christi devint la plus importante des réjouissances. Villes et villages la célébraient en plein air, par des processions et des représentations qui avaient pour thème obligé le mystère de l’Eucharistie. Dans la communion, la substance du pain et du vin se change en la substance du corps et du sang du Christ. La théologie nomme « Transsubstantiation » cet article de la foi catholique.
Souvenons-nous que Luther, réclamant la communion sous les deux espèces, dénonçait la doctrine de la Transsubstantiation comme contraire à l’Évangile. Que Protestants et Catholiques s’étripèrent là-dessus. La treizième session du Concile de Trente, en octobre 1551, consacra solennellement le dogme de la présence réelle contre l’erreur luthérienne. Parmi d’autres « erreurs » Luther niait l’action machinale du sacrement. Celle-là même qu’affirme l’auto, acte, sacramental, du sacrement, et, par tous les moyens possibles dont le génie, don Pedro Calderón de la Barca.
Calderón, dont la longue vie silencieuse et relativement quiète coïncide avec la ContreRéforme, devint le fournisseur attitré de la FêteDieu, non seulement de la capitale Madrid, mais de la province, Tolède, Séville, Grenade. De printemps en printemps, avec une incroyable fécondité, il se renouvela. Cent-vingt comedias au cours d’une vie, c’est beau. Plus de soixante-dix autos, soit plus de soixante-dix fois un millier de vers, sur le seul thème du Pain et du Vin, c’est confondant.
D’autant plus qu’il s’agit chaque fois d’œuvres originales n’ayant de commun que leur fin originelle.
De rares fois il revint sur le même pour en donner une seconde version, plus admirable. Tel est le cas de LA VIE EST UN SONGE — à ne pas confondre avec la comedia du même titre. Transporté « a lo divino » le prince Sigismond devient l’Homme. Son père n’est plus le roi Basile, imprudent astrologue, mais Dieu, le dramaturge par excellence, qui réunit en lui Pouvoir, Savoir et Amour. La prescience divine y remplace l’horoscope.
LA VIE EST UN SONGE
Aux quatre coins de la place, ou du parvis, sont disposés quatre chars. Du premier, qui représente la sphère terrestre peinte en bocage, fleurie de roses et peuplée d’animaux entre le tracé de ses lignes (équateur et tropiques), sort une femme qui chevauche un lion au naturel. Vous l’avez reconnue, c’est la Terre. Du second char où nuages, constellations et signes du Zodiaque dessinent la sphère céleste, sort une autre femme chevauchant une salamandre : c’est le Feu. Le troisième char représente le globe arrondi des flots bleus où nagent une infinité de poissons : l’Eau en surgit sur un dauphin. Du quatrième enfin, plein d’oiseaux et couleur de l’air, sort l’Air en personne sur un aigle.
Descendant de leurs montures les quatre éléments se saisissent d’une couronne qu’ils se disputent.
EAU
À moi la couronne !
AIR
À moi le laurier !
TERRE
Pas tant que je ne serai morte.
FEU
Pas tant que je vivrai.
EAU
Ce lien entre nous quatre
jusqu’ici jamais défait
ne pourra que se rompre
si je ne règne pas.
TERRE
Que Dieu au commencement
fit le ciel et la terre
sera-t-il dit. Soumission
par conséquent m’est due
puisque je précède les trois,
créée par article de foi
en même temps que le ciel.
AIR
Terre informe et vide
dira la même Écriture,
pourquoi, si c’est de l’air
que tu boiras le souffle,
rivalises-tu avec moi ?
EAU
De lui-même l’esprit de Dieu
se mouvait sur les eaux
qui sont la face de l’abîme.
Puisqu’au-dessus de l’eau
ondoyait l’esprit de Dieu
à l’eau vous devez vous soumettre.
FEU
Globe et masse confuse
qu’en leur style les poètes
appelleront chaos
et néant les prophètes,
voilà ce que nous formions
les quatre.
Arrêtons-nous là. Vous aurez reconnu dans les arguments que se lancent à la tête les éléments, instruits du futur, les premières phrases de la Genèse. La sainte Trinité — Pouvoir, Savoir et Amour — va maintenant intervenir sur le chaos, le penser, le classer, pour préparer la naissance de l’Homme.
Une remarque pragmatique
« Parler de la spontanéité créatrice des grands dramaturges, de leur culte théologique, de la dévotion qu’ils partageaient avec tout leur peuple, c’est peut-être rester dans le vague et ne pas voir Auto sacramentel de Calderón, mise en scène de Victor Garcia, Théâtre de Chaillot, 1981. dans sa réalité concrète le régime de production des auteurs. Lorsque Calderón publie un choix de ses autos et entreprend de défendre cette partie de son œuvre, il ne se présente pas au public comme un poète qui cèderait à des inspirations toujours nouvelles d’un même sentiment. Il s’excuse plutôt de la monotonie de ces pièces de la Fête-Dieu. C’est comme une gageure, semble-t-il dire, d’arriver à des résultats variés sur des sujets qui sont toujours les mêmes et avec des moyens qui sont toujours les mêmes. Mais qui lui impose cette gageure ? Sa foi ? Sa muse ? Non, mais bien le Conseil Municipal de Madrid ou de telles grandes villes qui ont fait de lui le fournisseur attitré d’autos sacramentales. »
Que le prince et les conseillers municipaux qui nous gouvernent entendent cette remarque de Marcel Bataillon. Passer commande aux auteurs dramatiques développe leur « genio » — terme qui, en castillan, désigne aussi bien Le génie que le caractère. La contrainte de la commande a certainement été un facteur essentiel de l’approfondissement du génie caldéronien en quête de solutions nouvelles à chaque printemps.
L’arène du monde
« Lope est la vigne, Calderón le vin », nous disait José Bergamin dans son magnifique essai sur L’ESPAGNE DANS SON LABYRINTHE THÉÂTRAL DU SIÈCLE D’OR. Et que le théâtre national de Lope de Vega s’était fait notionnel avec Calderón. L’art de théâtraliser la foi, de la populariser par le théâtre et par la poésie, Bergamin le définit « art de Birlibirloque » : acte de prestidigitation, tour de passe-passe de l’illusion qui conduit à la pure vérité. Il n’emploie pas d’autre image pour désigner l’art de toréer. « L’art de Birlibirloque est celui qui sait qu’en toute action ou œuvre humaine, Dieu est toujours de moitié. Et si ce n’est pas lui, c’est le Diable. »
Quand on demandait au torero Rafael el Gallo quelles étaient les bêtes qu’il avait eu le plus de mal à toréer, il répondait : celles qui n’avaient pas mon style, ou plus exactement : celles qui étaient contre mon style. Calderón n’aurait pu toréer l’âme et la vie, le pain et le vin, devant un public qui n’avait pas son style, qui était contre son style, c’est-à-dire sa pensée.
Puisque le théâtre n’est pas tombé du ciel pour les seuls Espagnols, il faut en passer par l’afición, qui est goût et savoir. Nul public ou peuple n’a manifesté envers son théâtre une telle afición, un goût si prodigieux. On s’est demandé, bien sûr, si la fréquentation populaire des pièces religieuses n’était pas due aux décrets qui fermaient, à certaines périodes, les portes des théâtres profanes. L’interdiction ne visant, en général, que Le temps du Carême, cette explication paraît insuffisante. Plus convaincante nous paraît celle de Menéndez y Pelayo : le peuple espagnol avait cessé d’être catholique pour devenir théologien. (Comme il l’est aujourd’hui, selon moi, en tauromachie). Aucune règle du grand jeu, aucun dogme ne lui étaient étrangers ; aucun sacrement n’avait pour lui de mystère autre que son mystère propre.
Les Espagnols éprouvaient donc tout simplement du plaisir. Le public ou le peuple éprouvait du plaisir à reconnaître dans les autos et comédies de saints Les rimes, les rythmes et Les images de poètes qui, n’étant jamais loin de lui, reflétaient maintenant sa vie spirituelle. Plaisir à retrouver ses acteurs, c’étaient les mêmes. (Il arrivait que saint Joseph fut interprété par celui qui, à la ville, était l’amant de Marie). Aucune peine à identifier à son costume de fou, le Libre-Arbitre, à sa faux la Mort, à sa beauté le Corps joué par le galant de la troupe. Et, puisqu’il s’agissait d’un spectacle total, plaisir enfin à découvrir sur ces scènes roulantes dites chars disposées aux quatre coins de la place de fabuleux décors dont les machineries préfigurent l’opéra.
LA NEF DU MARCHAND
Le navire qui se tourne lentement vers nous est noir, noir son gréement. Un clairon sonne. À la proue, coiffé de plumes, l’épée au côté, se tient un splendide capitaine. Il crie au timonier d’aborder et saute à terre, seul. Trois conjurés, ses alliés, déboulent du pont au seul son de sa voix. Tous ennemis jurés de l’Âme qu’ils convoitent d’un Homme qu’on attend. Ces caudillos se nomment Monde, Démon et Lascivité. Leur capitaine n’est autre que la Faute.
Un rocher s’entrouvre sur l’homme endormi à même le sol, quasiment nu. Son Désir veille, lui, bien éveillé. À l’intérieur d’un autre rocher dort également, richement vêtu sur un lit de fleurs, un marchand arménien qu’‘Amour veille. L’action commence. Le premier homme sera sauvé par le second qui n’est autre que le Christ, second Adam.
La Nef du Bon Marchand nourrit les hommes que la noire Faute affame. Riche et blanche nef dont le fanal est un calice et la proue un séraphin. Elle s’est appelée la Santa Maria, comme la caravelle de Christophe Colomb, elle est passée par Puerto Rico, riche port, et par la Floride (ainsi nommée parce que Ponce de Leôn la découvrit un beau matin de Pascua Florida, Pâque fleurie, dimanche des Rameaux). La nef est passée par Vera Cruz, la Vraie Croix, et par Santa Fe, la Sainte Foi. Elle a doublé le Cap de Bonne Espérance. Et, se rapprochant de nous, elle transporte le blé d’(h)Ostie à Cadix, calice.
Impression que « la pensée se fait dans la bouche » n’est-ce pas ? Fausse impression. Calderén joue avec des mots qui sont des concepts parce que dans sa langue concepto signifie mot et concept. Et, comme en passant, il projette une histoire sur une géographie.
Le Dieu Pain
Précieux Calderén qui peut édifier un acte sacramentel entier, sur une simple homonymie. Tel est le cas du VRAI DIEU PAN fondé sur les deux sens du même vocable pan : pain et Pan, Dieu grec. Le dieu des bergers d’Arcadie ayant diverti tous les dieux fut baptisé Tout, en grec : Pan. Calderén joue aussi avec cela. Ce Tout est notre Pain. Pan sort en chantant d’un nuage, revêtu de ses habits de fête. Charmant berger qui ne suscite aucune frayeur panique dans la nuit étoilée. Il est amoureux de la lune. Celle-ci en Diane chasseresse coiffée d’un croissant, nous décrit ce qu’elle voit de là-haut. Vus de la lune les troupeaux « sont d’inquiets golfes de laines / qui dérobent aux cimes leur neige / pour enrichir les vallées ».
« Des astres, des forêts et d’Achéron l’honneur, Diane au monde haut, moyen et bas préside ».
Celle qui est Lune au ciel, Diane sur terre, Hécate aux enfers, objet d’un amoureux sonnet d’Étienne Jodelle en vers rapportés, construit sur le trois qui tourmente son alexandrin, devient entre les mains du poète espagnol le sujet Âme aux trois séjours possibles. Née pour le ciel, elle doit s’exiler sur terre. De là retourner au ciel étoilé, ou bien être réduite en braise.
Véritable coup de force ou coup de génie que la fusion opérée entre l’ancien et le chrétien par un seul mot. Qui donc l’a autorisé ? Le Dieu Pan l’explique à la Nuit :
« Écoute et tu sauras :
L’allégorie n’est rien d’autre
qu’un miroir qui traduit
ce qui est par ce qui n’est pas
et toute son élégance
est que l’image soit si fidèle
à l’original que celui
qui regarde l’une pense
contempler les deux à la fois. »
L’allégorie permet à Calderón de ramener dans son filet la pêche miraculeuse de l’Antiquité. Et Ulysse (LES ENCHANTEMENTS DE LA FAUTE) et Minos (LE LABYRINTHE DU MONDE). De donner place et paix aux mythes les plus beaux et les plus inquiétants. Dans PSYCHÉ ET CUPIDON l’Amour sauve la Foi (Psyché) du doute. Il délivre la Nature Humaine captive dans ANDROMÈDE ET PERSÉE.
Micheline Sauvage nous l’explique : « L’allégorie capte un sens et le livre à l’esprit par les voies de l’image, plus aisées à l’âme débile que celles de la pure idée, parce qu’elles bénéficient de la présence et de l’appui du sensible. Le ressort du théâtre allégorique de Calderón c’est une compréhension symbolique des formes universelles et de leur enchaînement. Les personnages symboliques de l’auto sont des forces, les forces dont le jeu anime la grande, la douloureuse aventure de la Création. La dialectique s’est faite théâtre. L’articulation des idées s’est faite jeu de scène. Et la durée scénique du drame prête son temps à l’autre drame, elle en est la représentation. »
Depuis la classe de philosophie où notre professeur, Micheline Sauvage, Descartes dans une main, Calderón dans l’autre, nous penchait sur l’état de veille et l’état de sommeil, la conscience et le songe, une image me poursuit : celle de l’échange de capes entre le Bien et le Mal qu’elle décrivit un matin. Bien et Mal, deux galants, se disputent. Ils en viennent aux mains et pour mieux lutter jettent à terre leurs capes. Prenant la voix de la Justice, intervient la Malice, qui fait la paix entre eux et tend à chacun sa cape. Sauf qu’étant Malice, elle les a interverties. Et le Bien s’en va dans le monde sous la cape du Mal, le Mal sous la cape du Bien.
« L’idée représentable »
Arrivant à Madrid le jour du Corpus Christi, un berger s’étonne des préparatifs auxquels il assiste, de ces chars qui ressemblent à des tours, et demande à une paysanne de quoi il s’agit. Elle répond :
« De sermons
mis en vers, en idée
représentable, de questions
posées par la théologie
sacrée que mon raisonnement
ne peut expliquer ni saisir
mais dont le but est de réjouir
pour fêter un si grand jour. »
(Grand jour ici à double titre, Calderón ayant composé TRIOMPHER EN MOURANT OU LA SECONDE ÉPOUSE, dont sont extraits ces vers, à l’occasion du second mariage de son roi Philippe IV). Utilisant les Écritures, la Scolastique, les Pères de l’Église, l’auto devient une synthèse de l’histoire théologique de l’humanité, de la Création à la Rédemption par le sacrifice du Pain et du Vin.
Calderón aime à expliciter sa façon de faire au moment même où il le fait. Dans IL Y A DES SONGES QUI SONT VÉRITÉ, où une véritable « épidémie de sommeils » avant la lettre s’abat sur les personnages et où il utilise la science des rêves du meilleur déchiffreur de la Genèse, Joseph (Joseph vendu par ses frères, devenu esclave en Égypte, ayant obstinément refusé de coucher avec la femme de son maître l’officier Putiphar — ce dont elle s’est vengée en prétendant le contraire — est jeté en prison), c’est à la Chasteté qu’il confie l’explication :
« Et puisque le périssable
ne peut comprendre l’éternel
il est besoin d’un expédient
visible pour l’appréhender
qui, palliant nos faibles ressources,
fera du concept imaginé
passer au concept pratique.
Rendons alors représentable
sut tous les théâtres du temps
cette certitude qu’un homme
quand bien même il lutte et peine
pour exercer une vertu
est par elle-même défendu. »
La vertu qu’a exercée Joseph est incarnée par sa récompense. En effet, la Chasteté a pris les traits de la belle Asneth que Pharaon donnera à Joseph pour épouse en remerciement d’avoir interprété ses rêves et sauvé l’Égypte de la famine. Mais si Calderón fait commencer l’acte sacramentel dans la prison où Joseph fut jeté après l’affaire Putiphar, c’est qu’ayant irrité leur maître le chef des panetiers et le chef des échansons s’y trouvent également enfermés (Gen, 40). En livrant la clef de leurs songes à l’officier qui servait le pain et à celui qui servait Le vin de Pharaon, Joseph prépare sa future libération et le pardon de ses frères.
Au pied d’un arbre
LE VRAI DIEU PAN, LES VIGNES DU SEIGNEUR. On ne sait ce qu’on doit admirer le plus de la clarté ou de la complexité des choses. Au pied d’un arbre, un groupe fait la sieste. Des branches de cet arbre pendent divers attributs : un sceptre, une bêche, un miroir, un livre, un bâton, une épée etc. C’est l’arbre de la Fortune mais ce n’est point la déesse Fortune qui va secouer l’arbre. Venue de saint Thomas, la Justice Distributive a pris sa place dans IL N’Y À DE FORTUNE QUE DIEU. C’est elle qui nous réveille (encore !) en faisant tomber sur nos têtes ce qui nous attend. Celui sur qui est tombé le sceptre sera Pouvoir, Labour celui sur qui est tombé la bêche, Beauté celle qui reçoit le miroir. Le livre est tombé sut moi.
« Puisque la métaphore est sûre, courons avec elle » pensait et prouvait Calderón. Aux images de rendre le concept représentable. L’image mentale, fournie par le concept, se fait dramatique par toutes les ressources du théâtre et de la poésie. Décors, positions, couleurs, entrées et sorties, couples antithétiques, octosyllabes et endécasyllabes, constructions à plusieurs, changements de rythme, rimes aiguës pour la terreur, l’horreur, monologues en solitude, avec ou sans musiciens, dans une architecture du texte qui est sa propre mise en scène. D’une image-mère procèdent les personnes du drame et finalement le drame entier. Au seul titre de l’auto vient le sujet, vient la leçon, sortent les personnages, entre le poète.
LE PROCÈS MATRIMONIAL DU CORPS ET DE L’ÂME
Sujet : ils se marient et ne s’entendent pas. Pas les mêmes goûts. De plus, le Péché est tombé amoureux d’elle. Leçon : si le Corps et l’Âme se séparent, leur enfant, qui est la Vie, en mourta. Personnages : le Corps et ses cinq sens, Ouïe, Vue, Goût, Odorat, Toucher, l’Âme et ses trois facultés, Mémoire, Entendement et Volonté, le Péché, la Vie, la Mort. Métaphores matrimoniales et juridiques : dégoût, griefs, disputes, séparation, divorce, procès, jugement.
LE GRAND THÉÂTRE DU MONDE
Sujet : le monde est un théâtre, la vie une comédie, les hommes sont les acteurs, Dieu est l’Auteur. (On le sait depuis Épictète en passant par Sénèque « toréador de la vertu »). Leçon : bien jouer le rôle qui nous a été distribué par l’ Auteur. Personnages : le Roi, le Pauvre, le Riche, le Paysan etc. Métaphores : celles du (grand) jeu dramatique.
LE GRAND MARCHÉ DU MONDE
Sujet : deux frères partent à la foire du monde. Leçon : ne pas dépenser à tort et à travers l’argent ou les dons du père, acheter des vertus, pas des vices. Personnages : le Père, le Bon et le Mauvais Fils, les Vertus, les Vices. Métaphores concernant l’héritage, le troc, la vente et l’achat, l’économie et le gaspillage.
Devant ces trois squelettes dramatiques soudain je frémis comme si je contribuais à désanimer ces œuvres dont le souffle est la poésie. Avant d’être un militant de la Contre-Réforme, un fournisseur en Fête-Dieu ou ce qu’on voudra, Pedro Calderén de la Barca fut un immense poète. Ses métaphores n’interviendraient pas aussi analogiquement à la vérité si elles ne rayonnaient d’une beauté propre. C’est peut-être contre les ténèbres qu’elles ont déployé le plus de lumière. Devant la possible mort de l’esprit personne mieux que lui n’a su faire trembler. Plus proche d’un Valdès Leal (je songe aux grands tableaux qui se trouvent à l’Hôpital de la Charité, à Séville, et particulièrement à une allégorie de la Mort éteignant la Vie « In ictu mendismo oculi ») que du « tremendismo » qu’affectent certains toreros dans l’arène — terribilisme dirions-nous, consistant à prendre des risques inutiles pour donner au public ou au peuple la chair de poule. Non. Quand il se fait terrible, l’art de Calderôn est un « art de trembler » définition possible de la poésie. Voilà pourquoi mon hommage ne s’achèvera pas sur quelque beau chant du pain pétri dans la rosée du ciel, ou de la grappe que la grêle, la bise et la tramontane s’efforceront en vain d’abîmer, mais sur la profération espagnolissime d’une damnation.
grands et il but du vin en leur présence. Puis il fit apporter les vases d’or et d’argent que son père avait enlevés du temple de Jérusalem et lui, ses grands, ses femmes et ses concubines s’en servirent pour boire. Ils burent et ils louèrent les dieux d’or, d’argent, d’airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d’une main d’homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur ; les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l’un contre l’autre. Seul le prophète Daniel put donner au roi l’explication des mots qu’avait tracés la main : Mané, Thécel, Pharès. La nuit même Balthazar mourut et Darius entra dans Babylone. (Daniel V)
LE FESTIN DU ROI BALTHAZAR
À la pensée de ce festin blasphématoire et idolâtre le prophète Daniel se désole. Il se demande qui, qui pourrait bien l’aider à l’interrompre sinon l’empêcher. Quelqu’un va lui répondre : Moi. C’est un jeune premier qui s’avance, portant dague et épée, une cape jetée sur les épaules, une cape couverte de têtes de morts. Il se définit en huitains, tous accentués sur la dernière syllabe, rimes « aiguës » qui confèrent à ce qu’il dit une sonorité funèbre de glas mais sans la monotonie à cause de la vibration des images et aussi parce que cela sonne de plus en plus fort jusqu’au paroxysme de la fin.
« Moi, divin prophète Daniel,
je suis la fin de tout ce qui naît ;
fils de l’envie et du péché
avorté par l’aspic d’un jardin.
La porte du monde Abel me la donna
mais celui qui me l’ouvrit fut Caïn
et mon horreur y est désormais
ministre des colères de Jéhovah.
Né de l’envie et du péché
deux fureurs se partagent mon cœur :
par envie, j’ai infligé la mort
à tous ceux qui voyaient le jour ;
par le péché je suis devenu mort
de l’âme qui, elle aussi, peut périr ;
la mort de la vie étant d’expirer
la mort de l’âme est de pécher.
Quoi d’étonnant à ce que tu trembles ?
En me voyant tremblerait Dieu même
et lorsqu’il naîtra fleur de Jéricho
œillet dans un champ de giroflées
je ferai trembler sa part humaine
aussitôt qu’il me sera livré
les étoiles voileront leur éclat
la lune et le soleil leur visage.
(…)
Aujourd’hui mon rôle est d’obéir
et le tien, Sagesse, de prévenir.
Ordonne car il ne craint pas de tuer
celui qui n’a pas à mourir.
Je suis le bras, tu es la force
à moi de faire, à toi de dire.
Apaise la soif des vies que la colère
des eaux du déluge n’a pas étanchée.
(…)
Le château le plus orgueilleux
défi aux vents qui le convoitent
la plus solide des murailles
bâtie pour résister aux balles
entre mes mains sont peu de chose
de pauvres dépouilles à mes pieds.
J’ai nommé le château, la muraille,
qu’en sera-t-il de la cabane ?
Je brûlerai les champs de Nembroth
je confondrai les gens de Babel
je répandrai les songes de Behémot
je verserai les plaies d’Israël
je teindrai les vignes de Naboth
je courberai le front de Jézabel
je souillerai les tables d’Absalon
de la pourpre ensanglantée d’Amnon.
J’humilierai la majesté d’Achab
traîné ruisselant sur son char de rubis
je profanerai les tentes de Zimni
avec les filles lubriques de Moab
je tirerai les dards de Joab
et si tu me demandes plus encore
j’inonderai les champs de Sennar
du malheureux sang de Balthazar. »
La mort a parlé.