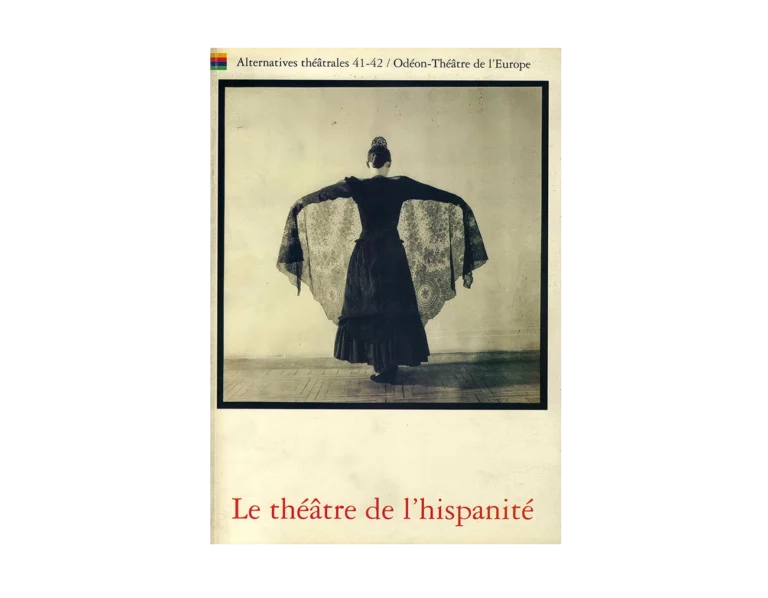IL prophétisa à propos de lui-même qu’«il commettrait des atrocités et des vilenies telles que le nom d’Aguirre retentirait sur la terre entière et jusqu’au neuvième ciel », et qu’‘ainsi son souvenir « resterait gravé pour toujours dans la mémoire des hommes ».
Il ne s’est guère trompé. Plus de quatre siècles ont passé et, des deux côtés de l’Atlantique, sa figure farouche continue de se dresser, provocatrice, inquiétante, polémique. Historiens, psychiatres, idéologues, romanciers et dramaturges n’ont guère ménagé leurs efforts pour que s’accomplisse la prophétie d’Aguirre le Fou, le Traître, le Pèlerin, le Prince de la liberté, le Premier Caudillo de l’Indépendance américaine.
Et l’homme ? Que reste-t-il de lui ? Peu de chose. Un simple crâne, conservé dans une châsse dans une église d’El Tocuyo, au Vénézuela. Figure d’épouvante, relique satanique, masque funèbre ? Masque, en effet : derrière la personne, se profile le personnage. Comme l’a si justement remarqué Caro Baroja, le sourire sinistre de la tête macabre d’El Tocuyo évoque la grimace d’un personnage de grand guignol. Aguirre dut avoir, n’en doutons pas, une vocation d’histrion. Dans les chroniques et les relations de l’époque, nous le voyons surgir avec les gesticulations outrées, Les élans déclamatoires, les effets de manche et les airs farouches d’un matamore sur un tréteau de foire.
Auteur, acteur et metteur en scène d’un guignol tragique, Lope de Aguirre plante en plein cœur de la forêt amazonienne son Grand Théâtre du Monde, sur lequel quelques figurants hébétés, désireux de jouer les premiers rôles, interprètent un drame dont le protagoniste — personne et personnage — est, en réalité, Lope lui-même : le drame éternel de la rébellion manquée, de la Chute de l’ange qui osa impudemment se soulever contre le Pouvoir suprême.
Drame à la fois ancien et moderne que le sien. Sa rébellion, sa guerre, son cabotinage sont d’hier, d’aujourd’hui et de demain. De même que sa foi en la mort, coup de théâtre définitif, ultime recours d’un dramaturge en mal d’imagination, trop souvent utilisé pour être efficace, et que l’usage indiscriminé rend sordide.
Sur ce point, tous les documents dont nous disposons concordent. Ils nous révèlent comment, en recourant à la terreur pour mener sa lutte contre le pouvoir, Aguirre pousse ses propres partisans, ainsi que tous ceux en faveur de qui il prétend agir, à l’abandonner pour chercher refuge dans le giron du Pouvoir, de ce Pouvoir dont les mécanismes de terreur se trouvent masqués et dissimulés dans la machine institutionnelle de l’Empire. Nous voyons ainsi dans l’aventure d’Aguirre quelque chose qui ressemble à la naissance d’un contre-pouvoir, qui se constitue en anéantissant tous ceux qui s’opposent à lui ou ne le soutiennent pas, et qui se crée des ennemis pour disposer de victimes… ou l’inverse.
Cela dit, d’où viennent ces documents ? Quelles sont les sources historiques qui ont conservé pour nous les échos de ce drame vieux de quatre siècles ? Comment ont perduré « dans la mémoire des hommes » le geste et l’image de ce personnage démesuré ? En réalité, nous n’en percevons que le reflet, réfracté et déformé par l’effroi et la haine de ses ennemis, de ceux qui survécurent à sa fureur despotique et à son fanatisme justicier, et tissèrent dans leurs témoignages un discours unanimement détracteur. La figure d’Aguirre qui apparaît dans leurs déclarations, lettres, chroniques et relations, est celle d’un fou sanguinaire, d’un tyran homicide, d’un transgresseur absolu de l’ordre humain et divin.
Dès lors, c’est inévitable, la tentation est grande de le réhabiliter, de lire « à l’envers » ce discours détracteur, et de faire de Lope un héros de la révolte, un saint maudit, un libérateur avant l’heure. C’est ce qu’ont fait bon nombre de nos contemporains, qu’ils soient chercheurs ou créateurs, en revendiquant son nom et son aventure, et en les revêtant de l’aura de l’indépendantisme basque et / ou américain. Les étonnants éclairs de lucidité arrogante qui émaillent sa lettre à Philippe II autorisent et, dans une certaine mesure, légitiment ces tentatives récupératrices.
Ma tentation et ma tentative ont été d’une autre nature lorsque j’ai écrit LOPE DE AGUIRRE, LE TRAÎTRE. Naturellement, je ne prétends pas être resté totalement neutre face à une figure aussi controversée : aucune recherche historique, aucun travail de création, ne saurait se glorifier d’une chimérique impartialité idéologique. Mais je me suis efforcé de résister à tout parti pris schématique, ou tout au moins de l’atténuer, en m’’astreignant à une sévère discipline formelle.
Ayant choisi une structure dramaturgique singulière — neuf monologues mettant en scène neuf personnages, enchâssés dans une composition chorale ambiguë — je me suis vu dans l’obligation de respecter la pluralité des points de vue qui convergent sur Aguirre, mais également sur le Pouvoir qui s’oppose à lui. Neuf personnages, neuf monologues, neuf moments de l’aventure amazonienne, neuf perspectives, relativisées par leur nature subjective, qui s’entrecroisent et s’entrechoquent, et interdisent ainsi tout verdict dogmatique et unilatéral.
Et, au milieu de cette pléthore, un grand vide, une scandaleuse omission : Lope de Aguirre est absent (?) de ce drame qui est Le sien. Sa présence n’est sensible qu’à travers la trace qu’elle a laissée dans chacun des personnages, sa parole n’est audible qu’à travers les fragments de cette lettre que leurs voix transcrivent dans l’air, son ombre plane sur chacun des épisodes qui jalonnent cette aventure insolite. À la fois fond et forme de cette aventure, l’Amérique y palpite également, présente et absente, convoitée et ignorée, dévastée et dévastatrice, poussant à leur paroxysme les rêves, les délires et Les passions des bourreaux et des victimes. Drame à la fois ancien et moderne que le sien.
Traduit par Gérard Richet.