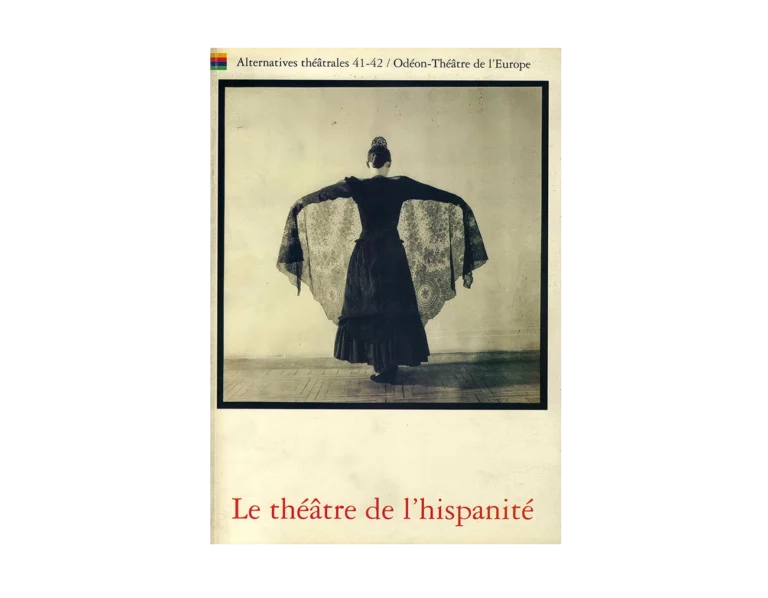J’AI l’impression que tout mon apprentissage théâtral a été une préparation à l’ Amérique latine.
Pour un Européen, le théâtre latino-américain est reconnaissable et inconnu, issu d’une même souche, mais avec une autre histoire. L’ethos qui caractérise Le théâtre latino-américain — c’est-à-dire, l’ensemble des comportements sociaux, politiques, existentiels, communautaires, éthiques — devrait le rendre toujours présent aux yeux de tous ceux qui s’interrogent sur le sens du théâtre, où qu’ils soient.
L’ethos est l’ensemble des réponses-en-action à cette question. Il constitue la troisième dimension du théâtre. Beaucoup pensent le théâtre en deux dimensions, comme si les seules choses dignes d’attention étaient les esthétiques ou les tendances idéolqgiques, les résultats artistiques ou les techniques.
L’ethos est la dimension de la profondeur, des liens avec l’histoire individuelle de chacun et avec l’Histoire.
La vision bidimensionnelle méconnaît la valeur du théâtre latino-américain, non pas à cause de la distance géographique ou culturelle, mais à cause de ce même manque de subtilité dans le raisonnement qui amène à négliger aussi des secteurs entiers du théâtre européen.
Dans un avion en direction de Caracas
— Mais quel sens peut-il y avoir à faire du théâtre, aujourd’hui, en Amérique latine, dans une réalité socio-culturelle si dramatique, où les tensions sont si aiguës et les tragédies si manifestes ?
Nous faisions des discours de ce type pendant une longue nuit d’avion vers Caracas. La réponse semblait évidente, et elle était typique de cette façon sommaire de raisonner qui rend facile le jugement.
— Quel gâchis d’organiser un grand colloque international de théâtre ! N’est-ce pas, peut-être, une manière de fermer les yeux devant des problèmes bien plus graves ?
L’Odin Teatret et moi faisions partie d’un petit groupe d’acteurs, metteurs en scène, auteurs invités au Festival de Caracas dirigé par Carlo Gimenez, et au colloque de l’ ITI sur le futur du théâtre dans le Tiers Monde. C’était au printemps 1976.
— Le futur du théâtre dans le Tiers Monde ? N’est-ce-pas là l’exemple d’un problème futile ?
Derrière ces questions rhétoriques il y avait le préjugé selon lequel le théâtre serait une nourriture destinée uniquement aux peuples rassasiés.
Nous parlions du carnaval, presque complètement perdu pour nous Européens. — Quel sens peut-il y avoir à faire du théâtre, cet art d’importation, dans une terre où vivent des rituels, des fêtes, des manifestations collectives et populaires qui ont une force incommensurablement supérieure à n’importe quel spectacle théâtral avec sa poignée de spectateurs ?
Descendu de l’avion, ce petit groupe d’acteurs, metteurs en scène et auteurs européens s’est dispersé dans la frénésie du Festival. Nous de l’Odin Teatret, avons fait des rencontres particulières qui nous firent rester au Vénézuela plus longtemps que prévu.
Nous avons revu La Candelaria, que nous avions déjà hébergée à Holstebro, au Danemark, en 1973. Nous avons vu leur spectacle GUADALUPE ANOS SIN CUENTA. « Sin cuenta », mais aussi « Cinquenta>, nous expliquaient Santiago Garcia et ses camarades. C’était un fragment d’histoire colombienne non écrite, officiellement censurée, racontée avec rage et ironie, avec un professionnalisme qui faisait jaillir la vie dans ce spectacle qui n’était certainement ni gai ni optimiste. Le spectacle remportait un succès dans le milieu international du Festival, bien qu’il montrât explicitement son ancrage dans une réalité sociale bien précise. Il ne racontait pas seulement une histoire, mais savait aussi évoquer le contexte dans lequel le récit de cette histoire trouvait son vrai sens.
Nous avons rencontré, pour la première fois, Mario Delgado et son groupe des Cuatrotablas de Lima. Un matin, dans la minuscule salle du groupe vénézuélien Contradanza, ils nous ont montré leur nouveau spectacle : LA NOCHE LARGA. C’était le premier pas, disaient-ils, sur une nouvelle route. Ils cherchaient à faire un théâtre peut-être moins spectaculaire que celui qu’ils avaient pratiqué jusqu’alors, mais qui correspondît mieux à leurs rêves, à leurs obsessions individuelles. Nous nous attendions à un spectacle auto-confession. Nous avons vu une méditation en images sur le conflit des cultures dans leur pays. À partir de ce moment-là, s’est créé entre nous un lien que le temps n’a fait que renforcer.
Nous avons rencontré le Teatro Libre de Bahia. Deux ans après, ils hébergèrent pour quelques mois deux de nos acteurs qui étudiaient au Brésil.
Nous avons rencontré le Libre Teatro Libre, trois acteurs seulement, les survivants du groupe important qui s’était rassemblé autour de Maria Escudero. Le Libre Teatro Libre, de Cordoba, en Argentine, avait été célèbre en Amérique latine pour la qualité de ses spectacles et pour son engagement politique. Maintenant, les trois acteurs présentaient EL ROSTRO : ils employaient l’auto-ironie pour évoquer la tragédie. Ils étaient déjà sur le chemin de l’exil.
En nous invitant à Caracas, Carlo Gimenez a permis à l’‘Odin Teatret de faire une expérience qui, pour nous, a constitué un tournant. Il a soutenu notre désir de bouger en dehors des frontières du Festival. Nous avons « troqué » des spectacles dans les quartiers populaires de Caracas, dans les régions de culture noire du Barlovento, dans des centres où agissaient des petits groupes culturels ou théâtraux pour qui notre présence devenait une incitation à se définir face à des étrangers.
Une coopérative cinématographique, Kurare, et certains anthropologues nous ont menés au fond de l’Amazonie vénézuélienne, dans un shæbono Yanomami, où nous avons été accueillis selon le rituel.
Là, nous avons présenté tous nos spectacles, même ceux que nous ne faisons que dans des lieux intimes, devant un nombre restreint de spectateurs.
— C’est une entreprise insensée, avons-nous dit aux anthropologues quand ils nous ont proposé d’y aller. Pour les Yanomami notre théâtre ne veut rien dire. Il n’y a aucune possibilité de communiquer. Ils nous ont répondu : — Ils n’ont vu que des missionnaires, des anthropologues et des fonctionnaires du gouvernement. Nous voulons leur montrer un visage inconnu de l’homme blanc.
Là, le théâtre a rencontré le rituel. Ce fut le « troc » le plus déchirant : les exposants d’une culture qui croit au Progrès face à une communauté au bord d’une destruction définitive.
Avant d’arriver à Caracas, je croyais posséder beaucoup d’informations sur le théâtre latinoaméricain. J’étais abonné à « Conjunto », je connaissais les groupes et les personnalités dont parlaient les revues internationales, j’avais vu les spectacles qui arrivaient à participer aux festivals européens. Je pensais qu’ils étaient les nombreuses exceptions d’une réalité à basse densité (et à basse nécessité) théâtrale. Mais, dès les premières rencontres avec des collègues latino-américains, je me suis rendu compte que le phénomène que je croyais typiquement européen — la myriade de groupes éparpillés partout, têtus, ignorés par les critiques, poussés par leurs nécessités personnelles et sociales à s’inventer leur propre théâtre — était un phénomène répandu en Amérique latine également.
Il y avait une densité théâtrale étonnante et souterraine. La réalité européenne équivalente du théâtre de groupe était tout aussi invisible aux yeux du théâtre bidimensionnel.
Je me suis rendu compte qu’il existait une troisième dimension du théâtre, un Tiers Théâtre.
Tiers théâtre
Mon expérience théâtrale s’est développée au début des années soixante dans un isolement presque total. L’Odin Teatret campait hors des murs du théâtre. Nous n’avions pas choisi cette position. Nous ne partagions pas les polémiques d’avant-garde contre le soit-disant « théâtre traditionnel ». Nous avions été obligés par les circonstances. Parfois, quelqu’un venait nous rendre visite. D’autres fois, on nous invitait à l’intérieur et on nous félicitait pour notre différence.
Nous avions été précédés par des frères aînés. Nous avions le sentiment d’appartenir à la même mutation biologique du théâtre par où étaient passés ou passaient le Living Theater, le TeatrLaboratorium de Grotowski, l’Open Theater, le Bread and Puppet Theater, le Teatro Campesino. D’autres nous parlaient à travers leurs livres. Craig, Stanislavski, Vakhtangov, Copeau, Artaud, Meyerhold, Decroux, Brecht, Sulerzhiski, Osterwa s’étaient aussi mis ou avaient été mis en dehors.
En 1968, un grand acteur satirique italien a participé à un de nos séminaires, à Holstebro. Il remportait un grand succès dans le cadre du théâtre commercial de son pays. Lui aussi, Dario Fo, était en train de se mettre en dehors. Il abandonnait l’organisation théâtrale et choisissait l’organisation politique des groupes de la gauche la plus radicale.
Dans le courant des années soixante-dix, le paysage hors les murs du théâtre commença à se peupler. C’étaient des groupes. Souvent ce n’étaient pas des personnes intéressées au « vrai » théâtre qui se faisait dans les murs. Ils voulaient former leur propre groupe et faire leur propre théâtre. Que cherchaientils ? Ils n’avaient pas une culture théâtrale sophistiquée. Ils ne prétendaient pas faire un théâtre d’avant-garde. Souvent, ils avaient vu les spectacles du Living Theater ou avaient lu le livre de Grotowski, ils avaient vu nos spectacles ou en avaient entendu parler.
Peu après avoir été à Caracas, l’UNESCO et le BITEF de Belgrade, Théâtre des Nations, m’ont donné l’occasion d’organiser une rencontre sur Le « théâtre de recherche », à l’automne 1976.
Recherche : de nouvelles formes ? De nouveaux langages ? Ou alors d’un nouveau sens du théâtre ?
Le souvenir récent de Caracas s’est entrelacé avec ce que je savais des théâtres de groupe européens. Il n’était plus question d’Europe ou d’Amérique latine. Il fallait faire constater l’existence d’un niveau méconnu du théâtre qui faisait fi des frontières géographiques.
J’ai invité à Belgrade des groupes de théâtre européens et latino-américains. Les organisateurs professionnels n’avaient jamais entendu parler d’aucun d’entre eux : c’étaient des groupes qui ne faisaient pas un « théâtre traditionnel », mais pas un « théâtre d’avant-garde » non plus.
Dans le cadre du festival, ils risquaient d’apparaître comme les représentants d’un théâtre « mineur » ou marginal. Ils ne l’étaient pas. Pour le démontrer, nous avons conclu la rencontre avec un spectacle collectif qui a duré une journée entière, de l’aube au coucher du soleil, dans le centre de Belgrade. Pour le présenter, j’ai parlé, pour la première fois, de Tiers Théâtre.
Tiers Théâtre n’indique pas la ligne d’une tendance artistique, une « école » ou un style. Cela indique une manière de donner du sens au théâtre. Depuis le début du siècle, qui va se terminer d’ici peu, beaucoup se sont demandé et continuent à se demander si le théâtre peut encore avoir un sens à l’époque actuelle. La question me semble mal posée. Ce n’est pas Le problème du « théâtre ». Est-ce lui peut-être — le « théâtre », ce sujet abstrait — qui tantôt possède et tantôt perd du sens, comme on possède et on perd de l’argent ? C’est seulement notre problème à nous, gens de théâtre. Les réponses doivent être individuelles, traduites en actions qui nous appartiennent : sommes-nous en mesure de donner un sens à ce que nous faisons ?
Recherche, donc, mais recherche du sens. Comment définir autrement le travail de groupes presque toujours autodidactes, qui ne sont pas d’emblée marqués par ce respect qui entoure celui qui entre d’une manière reconnaissable dans l’art théâtral, de groupes qui souvent vivent comme des émigrants, qui réussissent à grand peine à imposer leur propre droit à l’existence ?
Après le festival de Caracas, en 1976, l’Amérique latine est devenue un repère essentiel pour tenir en éveil les questions sur le sens de mon activité théâtrale.
Ainsi l’Odin Teatret est allé au Pérou en 1978 ; en Colombie en 1983 ; au Pérou, en Colombie et au Mexique en 1984 ; en Argentine et en Uruguay en 1985 ; de nouveau en Argentine et en Uruguay en 1986 ; en Argentine, en Uruguay, au Brésil et au Mexique en 1987. Outre ces séjours d’une durée de deux ou trois mois, avec des spectacles et des « trocs », je suis allé de nombreuses autres fois tout seul en Amérique latine, pour rencontrer des groupes, tenir des séminaires, voyager pour connaître et apprendre.
En 1988, dans une maison en dehors de Chicxulub, sur la côte du Yucatan, l’Odin Teatret s’est retiré plusieurs mois pour préparer son spectacle TALABOT.
Une collègue cubaine m’a dit : en réalité tu es un Latino-Américain né en exil.
Y‑avait-il une vérité dans ce compliment ? Je crois que oui.
J’ai grandi dans l’Italie du Sud. Je suis devenu adulte en Norvège, en tant qu’émigrant. En tant qu’homme de théâtre je me suis formé en Pologne. Le théâtre que j’ai fondé est danois. Mais parmi les groupes d’Amérique latine, je me sens chez moi.
En Europe et dans le nord de l’Amérique prédominent les théâtres-coquilles, les théâtres en pierre, édifices et institutions où l’on recrute des personnes à chaque fois différentes selon les exigences des différents spectacles, où se succèdent directeurs et metteurs en scène sans que le nom change, où la continuité est donnée par la structure organisatrice, par les statuts, par les règlements et par la reconnaissance légale. En Amérique latine, prédominent les théâtres-groupes d’hommes. Ce théâtre qui ailleurs n’est que minorité, occupe ici presque tout le paysage. En dehors de quelques métropoles comme Mexico, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, l’univers théâtral latinoaméricain est caractérisé par des groupes.
Les différences entre les groupes latinoaméricains et européens sont importantes autant que les analogies. En Europe, on donne une grande importance aux tendances, aux modes. Certains voient le Tiers Théâtre comme un courant plus ou moins à la mode, une « nouveauté » qui est transformée en « genre ».
Les théâtres latino-américains n’ont jamais joui des vagues favorables de la mode. Ils sont beaucoup moins sujets à ses flux et reflux.
En généralisant on pourrait dire : le Tiers Théâtre européen est aussi un choix existentiel qui réagit à la satiété, à l’indifférence, à des stimulations artistiques si surabondantes qu’elles ont des difficultés à transmettre le sens de leur urgence et de leur nécessité.
Le Tiers Théâtre latino-américain est lui aussi un choix existentiel, mais il réagit à une situation de pénurie.
En Europe, beaucoup risquent de se laisser séduire par une sécurité apparente.
Nous sommes les citoyens des démocraties du bien-être. Nous devons avoir recours à notre conscience historique et existentielle pour conserver le sens de la précarité dans laquelle nous vivons, et pas seulement en tant que professionnels du théâtre.
En Amérique latine, il faudrait être aveugle et sourd pour l’oublier.
Pâques 1987
À la fin des années soixante-dix, j’ai reçu une lettre de Bahia Blanca en Argentine. Coral et Dardo Aguirre, avec leur groupe Teatro Alianza, racontaient leur travail, la précarité, l’importance de notre existence. « Ne nous oubliez pas, vous qui vivez dans une situation privilégiée ». Leur théâtre fut attaqué, ils furent battus, une de leurs comédiennes séquestrée, violée et tuée. Dardo et Coral furent emprisonnés. Ils ont réussi à se sauver par le chemin déjà pris par tant d’autres : l’exil. Ils ont trouvé un travail, comme violonistes, à l’Orchestre symphonique de Turin. Ils y sont restés un peu plus d’un an. À Turin et en Italie il y avait la violence de la « guerre contre l’État » menée par des groupes armés. « Violence pour violence, il vaut mieux retrouver la nôtre ».
Coral et Dardo sont rentrés clandestinement en Argentine en 1981. En 1986, à Bahia Blanca, grâce à un travail qui tient du miracle, ils ont donné une suite à ces rencontres de théâtres de groupe qui, à partir de 1976, s’étaient tenues à Belgrade, Bergame, Madrid-Leiketio, Ayacucho (Pérou) et Zacatecas (Mexique). Cette sixième rencontre à Bahia Blanca, ils l’ont appelée : Rencontre de théâtre anthropologique.
Ils ont invité des groupes mexicains et chiliens, uruguayens et brésiliens, argentins et des Indiens mapuche. Ils ont invité aussi l’Odin Teatret. À la fin de la Rencontre, nous sommes allés à Buenos Aires pour donner des spectacles et faire des « trocs » de théâtre.
Là, il y avait eu une révolte de quelques militaires. Pendant trois jours, on a craint que la majorité des forces armées ne s’unisse à eux. L’ombre du coup d’État revenait sur le pays.
Le jour de Pâques nous étions tous sur la Plaza de Mayo. L’Odin Teatret était une partie de cette foule. Il y a des situations qui font que l’on ne se sent plus étranger.
Après ces trois jours de menace et d’angoisse, il y a eu une profonde euphorie, presque une ébriété car nous vivions une heure historique pendant laquelle on avait le sentiment de participer à un acte de justice : la démocratie prévalait sur les armes.
Le lendemain, les journaux nous ont fait comprendre que nous avions vécu une apparence, une farce : cette victoire avait eu lieu à leurs conditions.
Ainsi, d’un jour à l’autre, tout changeait. Tout pouvait changer d’un jour à l’autre. Le fléchissement s’était produit au moment même où l’on exultait en croyant vaincre. On avait la sensation que notre propre action n’avait aucune valeur, que nousmênfès, en tant qu’individus, n’avions pas de poids. La précarité devenait une expérience existentielle qui se nichait au sein de notre conscience et non plus une situation politique.
À quel point un théâtre a‑t-il besoin de patrie ?
Hans Meyer croyait être allemand. Ses compatriotes lui ont dit qu’il était juif. Il a émigré. Il a été rattrapé par les armées et la police de « son » pays ». Il a été interné à Auschwitz. Il a survécu. Il est devenu écrivain. Il a traduit son nom, et l’a transformé en l’anagramme Jean Améry. Dès lors, il s’appelait comme les hommes de la Provence française, la terre des poètes et des hérétiques du Moyen-Âge exterminés au début du XIII siècle par les armées catholiques qui transformaient la France en une nation.
Jean Améry a consacré son activité d’écrivain à rappeler : « Tout cela est arrivé, donc cela peut encore arriver ». Il continuait à le rappeler alors que grandissait le nombre de ceux qui piaffaient d’impatience en entendant encore parler d’Auschwitz et des tragédies désormais définitivement ensevelies. Alors que, déjà, quelques historiens commençaient à utiliser la méthode scientifique pour démontrer que le nazisme, au fond, n’avait pas été si différent d’autres régimes de notre époque et qu’il méritait une considération plus « équitable », Jean Améry a publié INTELLECTUEL À AUSCHWITZ. En 1978 il s’est suicidé.
Un chapitre de son livre s’intitule : « À quel point un homme a‑t-il besoin de patrie ? » La langue allemande possède deux mots pour traduire « patrie » : Vaterland et Heimat, la « mère-patrie » et « ma maison », le lieu particulier d’où je viens. Effectivement, il s’agit de deux réalités différentes et pas seulement de deux mots différents.
En Amérique latine j’ai souvent entendu répéter : qu’est-ce que cela veut dire être Argentin ? Péruvien ? Colombien ? Vénézuélien ?.. Qu’est-ce que cela veut dire être Latino-Américain ?
À quel point avons-nous besoin de patrie ? Essayons d’être plus précis : À quel point avons-nous besoin de Vaterland ? Ou de Heimat ?
Raisonnons maintenant en termes de théâtre.
La conscience de la précarité, l’insécurité dans la définition de notre propre identité culturelle à l’horizon de l’Histoire menacent l’âme. Dans de nombreuses cultures, on affirme que l’âme risque toujours de s’envoler. Les hommes se sentent continuellement menacés par une « crise de la présence ». Quelque chose de semblable nous arrive : la source de notre créativité semble se tarir quand elle ne reflète pas une histoire et des valeurs à accepter et auxquelles nous pouvons nous identifier.
De plus, nous voulons découvrir notre identité non seulement comme individus, mais comme parties d’une communauté. La découvrir, en réalité, veut dire reconstruire et restaurer un passé qu’il soit possible d’appeler nôtre et en parcourir de nouveau les chemins multiples. Mais pour aller où ?
Cette question nous met face à deux problèmes. Tout d’abord elle nous met en garde. Le chemin qui revient en arrière n’est qu’une face de la médaille. Les racines, à elles seules, ne garantissent rien même quand elles ne sont pas le fruit d’une illusion. Le deuxième problème est justement celui de l’illusion.
Il est vrai qu’il existe des « illusions vitales ». Mais à quel point et quand sont-elles vitales ? Il est certain que, plus souvent encore, les illusions sont mortelles. Beaucoup de celles que nous appelons du noble mot de « traditions anciennes » sont des illusions. Elles sont une route jonchée de ruines archéologiques. Elles peuvent nous aider énormément parce qu’elles conservent la trace du savoir de nombreuses générations. Mais du sens et de la direction, c’est nous qui devons décider. Et surtout : ce ne sont pas les traditions qui nous choisissent, c’est nous qui les choisissons : un Français peut devenir musulman et un Indien un très bon directeur d’orchestre de musique classique européenne. Le fait d’être né sur une certaine terre etde certains pères ne veut pas dire que notre identité doive être forcément cherchée sur cette terre et parmi ces pères.
À quel point avons-nous besoin de patrie ? (Vaterland ? Heimat ?) Mais aussi : de quelle capacité à être ou devenir étranger avons-nous besoin ?
Qu’est-ce que cela signifie être Bolivien, Brésilien, Uruguayen, Latino-Américain ? Mais aussi : qu’est-ce que cela signifie ne pas être seslement Latino-Américain, Italien, Danois ?
J’avoue éprouver un grand respect, parfois une grande tendresse, toujours une certaine crainte, quand je vois un groupe de théâtre courir vers les « traditions de sa terre », vers les Incas, les Mayas, les Aztèques, les cultures indiennes …
En Europe, vers les traditions basques, groënlandaises, galloises …
Atahualpa del Cioppo et la tradition-en-vie
À l’automne 1974, un metteur en scène uruguayen est venu étudier quelques mois à l’‘Odin Teatret. Son comportement me frappa : c’était celui de quelqu’un qui avait rencontré un maître. Ainsi, pour la première fois, j’ai entendu parler d’Atahualpa del Cioppo. Plus tard, j’ai rencontré ses traces où que j’aille en Amérique latine. Avant de le connaître, je l’associais mentalement à Bertolt Brecht, également pour un fait biographique : l’exil.
Je l’ai rencontré dix ans plus tard, au Mexique. Il avait dépassé les quatre-vingts ans.
C’est un nomade, et il a travaillé longtemps dans de nombreux pays. Il voyage encore continuellement.
Malgré tout ce qu’il a dû voir, malgré tous ceux qui lui ont tourné le dos, il ne cède pas à la méfiance du genre humain. Malgré la fermeté avec laquelle il tient à ses idées, il est curieux et ouvert aux choix d’autrui.
Beaucoup de maîtres, en Inde ou au Japon, affirment que la tradition n’existe pas : « la tradition c’est moi, avec moi elle vit et avec moi elle meurt ».
Atahualpa del Cioppo est un maître parce qu’il est une tradition-en-vie. Il témoigne de la manière dont il est possible de donner un sens et une Heimat à son propre théâtre.
En 1987, l’UNESCO avait organisé à Lima une rencontre sur la « Dramaturgie de l’ Amérique latine et des Caraïbes ». Un soir, les hôtes péruviens ont conduit Les délégués voir un spectacle à Villa Salvador, le grand barrio autogéré hors de Lima. Ce que ses habitants ont réussi à réaliser leur a valu de nombreuses reconnaissances internationales et une mention pour le Nobel de la Paix.
Les maisons de Villa Salvador sont construites sur le sable. Le barrio s’élève en direction des dunes le long de la mer. Après le spectacle en plein air, sur le sable, Cesar Escuza, le metteur en scène du groupe, nous a invités à boire un verre. Avec une voix émue, il s’est adressé à Enrique Buenaventura et lui a dit : « Notre spectacle t’est dédié, parce que tes écrits et ton exemple ont été nos maîtres ».
Les maîtres servent seulement à ce que chacun trouve son chemin et que se réalise la multiplicité de la tradition-en-vie.
Une maison à deux portes
La recherche d’une identité, dans le théâtre latino-américain, se fait dans l’absence relative d’un théâtre qui représente la continuité avec le passé.
Dans le théâtre européen existent des niches différentes. L’une d’elles est celle du théâtre soi-disant traditionnel. Elle transmet et développe le théâtre européen des siècles passés.
Les artistes et Les intellectuels qui œuvrent dans la niche du théâtre soi-disant traditionnel se réfèrent à Molière ou à la commedia dell’arte, à Racine ou à Shakespeare, à Tchekhov ou à Beckett comme aux réprésentants, différents dans le temps, d’une continuité théâtrale ininterrompue.
Cette continuité n’existe pas dans. la niche des théâtres de groupe. Mais, alors que les théâtres de groupe européens peuvent aussi se définir par ce qui les sépare du « théâtre traditionnel », ceux d’Amérique latine, en général, ne peuvent se distancer de rien. Pour cela, les uns et les autres sont entre eux semblables et différents. Semblables parce que les conditions de leur travail présentent des caractères analogues. Différents parce que leur horizon est différent.
D’un côté, en toile de fond, il y a les murs du théâtre (les transfuges et les fatigués peuvent toujours tenter d’y entrer). De l’autre, non.
Les groupes européens peuvent se définir en se limitant à indiquer le théâtre qu’ils ne font pas et qu’ils ne veulent pas faire. Les groupes latinoaméricains sont obligés de se définir uniquement sur la base de ce qu’ils font et veulent faire.
Mais ce n’est pas cela qui entrave la recherche d’une identité pour ceux qui font du théâtre en Amérique latine.
Ce qui est plus grave est l’isolement de la maison des ancêtres, des réflexions et des témoignages de nos prédécesseurs. Ce qui ne signifie pas qu’en Amérique latine manque la réflexion sur le théâtre.
Au contraire : il suffit de penser à Enrique Buenaventura ou à Augusto Boal et aussi à leur présence dans un secteur important du théâtre européen. Mais un ensemble de circonstances ont entraîné un cruel manque de livres. Les textes de Dullin, de Delsarte, de Taïrov et de Eisenstein, même de Stanislavski et de Meyerhold, d’Appia, de Craig, de Vakhtangov, de Copeau, de Zeami.. n’ont pas été publiés ou ne circulent pas assez.
Le travail pratique et créatif doit s’accompagner d’un savoir qui tienne compte de ceux qui nous ont précédés. Conscient de cette nécessité, à Mexico, un jeune metteur en scène a interrompu à ses débuts son activité artistique pour se transformer en éditeur. Edgar Ceballos lutte contre l’ignorance forcée qui enlève au présent le souffle du passé. Il a fondé la maison d’édition Gaceta / Escenologia qui publie des livres sur l’histoire et la pratique du théâtre. Il publie la revue « Mascara » qui reprend fidèlement le titre (« The Mask ») avec lequel Gordon Craig, dans les années vingt, quand le théâtre était identifié presque exclusivement aux textes dramatiques, a affronté le vide culturel concernant les arts et l’histoire du spectacle européen et asiatique.
Une solide connaissance de notre histoire ( la nôtre en tant qu’hommes de théâtre, non pas en tant que Latino-Américains ou Européens) nous est d’autant plus nécessaire que nos créations et nos techniques de travail ne résistent dans le temps que comme mémoire et ont besoin de se rattacher à une « mémoire professionnelle ».
Il y a une vingtaine d’années, la Comuna Baires a commencé son expérience en Argentine, dans la capitale, mais en restant en dehors de toute organisation théâtrale. À côté de son travail artistique elle s’est occupée de la publication d’une revue, « Teatro 70 », qui ne contenait pas des comptes rendus de spectacles, qui ne se consacrait pas à l’actualité, mais à la diffusion de la connaissance théorique et pratique du théâtre. Pendant ces années-là, j’ai rencontré beaucoup de collègues qui vivent en Amérique latine, ou ont émigré ou se sont exilés en Europe ; ils se souviennent encore aujourd’hui que ce fut cette revue qui leur fit découvrir les mondes possibles du théâtre.
Notre identité d’un côté est individuelle, elle découle de notre biographie, de l’espace et du temps dans lequel nous vivons. De l’autre, elle doit être une identité professionnelle qui nous relie aux gens de notre profession au-delà des limites du temps et de l’espace. Il s’agit de deux pôles, très différents l’un de l’autre.
L’un ne peut pas exister sans l’autre.
Nous pouvons les concevoir comme les deux portes d’une maison, portes pour entrer, mais aussi pour sortir quand les limites de la maison commencent à être trop étroites. Un poème de Brecht rappelle une maxime qui appartient à la sagesse de l’exil : prends garde que ta maison ait toujours deux portes. Elle se réfère aux fugues imprévues (quand matériellement la police pouvait arriver), donc au fait de devoir sauvegarder l’obligation de résister. Ce poème a d’autres implications pour qui fait du théâtre en recherchant le sens et n’accepte pas le monde (celui du théâtre également) comme il est.
« La noche larga »
En 1986, au festival de Montevideo, j’ai vu LO QUE ESTA EN EL AIRE, du groupe Ictus de Santiago. « Ictus » veut dire « poisson » en grec. C’est le signe du Messie que les persécutés échangeaient en secret pour se reconnaître. Le poisson est aussi un signe de la vie qui bouge dans la profondeur. LO QUE ESTA EN EL AIRE était un spectacle réaliste et paradoxal. Une histoire métaphorique qui représentait une réalité étouffante, et qui malgré tout défendait la possibilité d’un espoir au-delà de la tragédie.
L’acteur et metteur en scène Hector Noguera, chilien, a répondu une fois à mes questions. Les explicites : comment est-il possible que la dictature permette ce type de théâtre ? Et les implicites : cela a‑t-il un sens ? Il m’a expliqué que leur théâtre ne représentait certes pas un danger pour le régime. Et que son caractère inoffensif ne menaçait pas le sens qu’ils donnaient à leur travail. Nous — disait-il — nous ne faisons pas de théâtre contre æ Chili. Nous travaillons pour le Chili parallèle. J’ai été frappé par le fait qu’il ne parlait pas en termes de temps, en pensant au futur, mais en termes d’espace, en pensant à une réalité parallèle à celle à laquelle il faut rester étranger.
C’est peut-être pour cela que Roberto Parada refusa de suspendre le spectacle le soir où on lui annonça, pendant l’entracte, que son fils avait été assassiné par les tueurs d’Accion Pacificadora. En ce temps-là, Amnesty International diffusait la nouvelle qu’au Chili, les membres du groupe Ictus, et de nombreux autres professionnels du spectacle, étaient menacés de mort s’ils n’abandonnaient pas le pays. Ils sont restés dans la noche larga.
LA NOCHE LARGA était le titre du spectacle des péruviens Cuatrotablas que nous avons vus à Caracas en 1976, quand le théâtre latino-américain a fait irruption dans la vie de l’Odin Teatret. Nous étions avec les Cuatrotablas, en 1978, quand ils ont organisé la rencontre des théâtres de groupe à Ayacucho, dans les Andes. Les mesures du gouvernement militaire sur l’augmentation des prix avaient provoqué des émeutes dans les villes andines et ces jours-là précisément on avait instauré Le couvre-feu. La précarité explosait. Mais les Cuatrotablas ne se laissèrent pas mettre au pas. Le couvre-feu n’a pas étouffé la rencontre des groupes latino-américains, ni la possibilité de présenter leurs travaux au grand jour.
Les temps ont changé — pas en mieux. Au sein du théâtre bidimensionnel, de nombreuses modes se sont succédées. Quelques nouvelles pistes de recherche se sont ouvertes pour moi et pour l’Odin Teatret. Nous avons fondé l’ISTA (International School of Theatre Anthropology) et ceci a fait croire à ceux qui pensent que la vie s’écoule par phases que, pour nous de l’Odin Teatret, la phase du Tiers Théâtre était finie. Alors que son sens est resté intact tout au long des années. C’est pour cela que nous étions aux côtés des Cuatrotablas à Huampani, dix ans après, pour une nouvelle rencontre de groupes latino-américains, organisée en 1988 dans le Pérou déchiré d’aujourd’hui.
Et tous les ans, l’Odin Teatret cherche la rencontre et le « troc » au Chili ou au Brésil, au Mexique ou en Uruguay.
Quand on parle d’influences
J’imagine certains lecteurs : ils penseront à une nouvelle influence de la culture européenne sur le théâtre latino-américain, cette fois sous la forme d’«odinisme ». C’est ainsi que fonctionnent les automatismes de la pensée bidimensionnelle sur le théâtre, avec son culte pour la soi-disant originalité.
J’étais déjà allé en Amérique latine en 1973, mais je ne m’étais pas occupé de théâtre. J’avais voyagé seul en autobus de Cochabamba, à travers les Andes jusqu’à la forêt, à Iquitos, Leticia, en continuant par Barranquilla sur les Caraïbes, jusqu’à Panama et, encore en autobus, à travers l’Amérique centrale jusqu’au Mexique.
Beaucoup d’ expériences de ce voyage, les moments d’effroi et d’indignation, ont de nouveau affleuré dans le spectacle de l’‘Odin Teatret VIENS ! ET LE JOUR SERA À NOUS qui a été présenté pour la première fois à Caracas en 1976. Il parlait de la rencontre entre les émigrés européens et les indigènes de l’Amérique du Nord.
Pendant ce voyage loin du théâtre, je réfléchissais aux deux espagnols, Gonzalo Guerrero et Jeronimo de Aguilar qui, en 1511, ont fait naufrage sur les côtes du Yucatan et ont été capturés par les Mayas, auxquels ils se sont intégrés en devenant des chefs militaires et des notables. À l’arrivée de Cortéz, Jeronimo de Aguilar a enfin pu se joindre à ses compatriotes en leur fournissant des informations décisives sur la langue et les habitudes des populations locales. Gonzalo Guerrero s’est comporté de manière opposée : il a préféré la seconde de ses patries, il est resté avec sa femme maya et avec ses enfants qui étaient les premiers d’une nouvelle race. Il est mort d’un tir d’arquebuse espagnol en 1536, en luttant contre les soldats qui avaient la même culture d’origine et les mêmes racines que lui. Gonzalo Guerrero et Jeronimo de Aguilar représentent les deux alternatives qui traversent l’esprit chaque fois qu’on pense à la rencontre entre des hommes qui viennent de terres éloignées : conquête ou assimilation.
Et pourtant, qui pourrait voir l’Odin Teatret comme un groupe qui s’est assimilé au théâtre latino-américain ? Malgré cela, en Amérique latine, les personnes que nous avons rencontrées, les groupes de théâtre avec qui nous nous sommes liés, leur histoire, leurs spectacles et leur contexte historique et culturel nous ont profondément marqués et ont marqué nos spectacles. LE MILLION aussi, comme VIENS ! ET LE JOUR SERA À NOUS, était tressé de souvenirs et d’expériences latino-américaines. CENDRES DE BRECHT était une réflexion sur l’histoire européenne récente, sur un intellectuel en exil. Cette réflexion était également nourrie d’angoisses provenant des pays latino-américains. L’ÉVANGILE D’OXYRHINCUS (Oxyrhincus est l’ancien nom de la ville égyptienne où ont été découverts d’importants textes gnostiques) était construit avec notre perception de la révolte populaire de Canudo, avec les images du sertao brésilien, de ses hors-la-loi, avec les visions de Guimaraes Rosa, de la prose méticuleuse de Euclides da Cunha, de la GUERRA DEL FIN DEL MONDO de Vargas Llosa. D’autres présences latino-américaines dans notre théâtre sont plus techniques, liées au travail pratique des acteurs, beaucoup plus concrètes et donc beaucoup plus difficiles à définir avec des mots. Je citerai seulement la samba telle que nous l’avons vue remodelée par un acteur du Teatro Libre de Bahia, et qui a inspiré notre training.
Si cela avait vraiment un sens de parler en termes d’«influences », je devrais reconnaître que l’Odin Teatret, dans sa rencontre avec le théâtre latino-américain, a été plus influencé qu’il n’a influencé.
Mais c’est une manière de penser que je trouve fausse.
Gonzalo Guerrero et Jeronimo de Aguilar ne sont pas les seules alternatives possibles. Par la seconde porte de la maison, celle qui est professionnelle, passe une identité qui est commune, d’où la difficulté de dire ce qui est à l’un ou à l’autre, et, surtout, l’impossibilité de distinguer entre ce qui vient de sa propre culture et ce qui vient de l’extérieur. Tout ce qui se fait au théâtre appartient à notre Heimat professionnelle, au lieu où nous, hommes de théâtre, sommes chez nous.
Les Cuatrotablas n’avaient pas encore vu notre spectacle VIENS ! ET LE JOUR SERA À NOUS quand ils nous ont invités à voir leur spectacle à Caracas. Ils avaient travaillé à Lima, nous à Holstebro. Leurs acteurs étaient péruviens, les nôtres scandinaves, plus une italienne. Et pourtant dans LA NOCHE LARGA nous avons trouvé beaucoup d’éléments concrets, en tout point semblables à ceux de notre spectacle. Deux ou trois de nos solutions les plus originales caractérisaient également l’originalité des Cuatrotablas. Si les faits établis n’avaient pas prouvé le contraire, quiconque aurait juré que l’un s’était inspiré du spectacle de l’autre et avait été influencé au point d’en citer des fragments entiers.
Quand certains caractères d’un théâtre sont ressemblants à ceux d’un autre, immédiatement les critiques et les experts commencent à chuchoter. Il y a, dans l’air, des mots comme « déjà vu », « copie », « mauvaise copie », « influence », « imitation », « acculturation ». Parfois les chuchotis deviennent jugements et condamnations. Alors, la vie des théâtres est sérieusement menacée.
Il ne peut exister un théâtre latino-américain, brésilien, européen, danois, florentin, madrilène pur ; ce n’est pas la pureté qui garantit l’identité propre et l’originalité culturelle. D’autre part, l’identité professionnelle a son caractère unique et ineffaçable : sa « transculturalité ».
Quand on parle d’influences je voudrais faire remarquer ceci : ne vous inquiétez pas si, en avançant, l’un s’appuie momentanément sur l’autre. Leurs routes ne pourront pas ne pas se séparer. Ne vous inquiétez pas si vous remarquez des ressemblances. Cela appartient au flux de la vie. Mais tout ce qui est vivant finit par se distinguer. Ne bloquez pas la vie du théâtre avec des épouvantails qui ne tiennent pas compte de la dimension de l’ethos. Seuls les morts se ressemblent définitivement.
Traduit par Marina de Carolis.