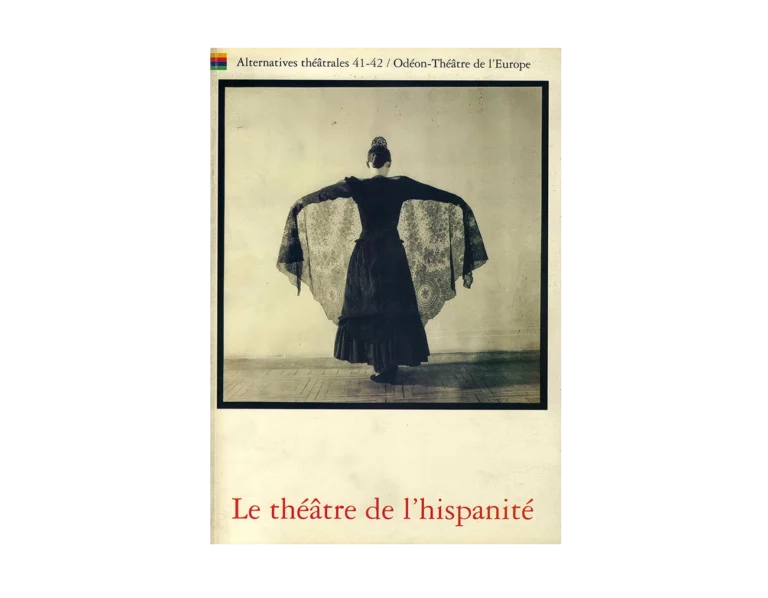Chère Alicia,
VINGT ans déjà… pour parler comme Gaev, je dirais que nous sommes de la génération qui fête « les vingt ans ». Les vingt ans du Théâtre du Soleil, les vingt ans des Bouffes du Nord, les vingt ans du Festival d’Automne, les vingt ans d’Art Press.
«Après vingt ans », le titre du roman de Dumas résonne autrement. Il y a vingt ans, tu quittais Bucarest accompagnée par nous tous, amis et professeurs aujourd’hui dispersés dans le monde. Depuis vingt ans aussi, nous avons pris le chemin de l’exil comme Brecht dont tu avais monté au Conservatoire GRAND’PEUR ET MISÈRE DU IIIÈ REICH. Alors, nous avions expurgé ensemble Le texte de ce qui risquait d’apparaître comme allusion trop directe à l’actualité, afin que tu puisses le mettre en scène. Quelques années plus tard, même cette ruse aurait échoué car tout en Roumanie avait fini en « grand’peur et misère ». Ce fut le fascisme au quotidien sous la houlette de celui qui osa se faire appeler Conducator, ce qui en traduction ne donne ni plus ni moins que Führer. C’est son délire que nous avons fui, laissant derrière amis, parents, livres, projets. Et parmi eux la traduction abandonnée sur un bureau de la Télévision de cette belle pièce péruvienne LA TRAVERSÉE DU NIAGARA d’Alonso Alegria que nous avions faite à deux voix. Elle vient d’être donnée à Paris « vingt ans plus tard ». Dans la victoire sur la cascade du vieil acrobate qui porte sur ses épaules un jeune garçon exalté, quelqu’un avait lu la réussite à laquelle peut conduire l’alliance entre la force de la pensée concrète et l’imagination de la pensée utopique. Belle interprétation qui nous avait échappé… Aujourd’hui, n’avons-nous pas besoin d’un jeune homme afin de réveiller ce qui menace de s’éteindre ? Aujourd’hui où, comme me disait Peter Stein, « personne ne peut plus hisser de drapeaux », nous sommes pareils au funambule censé traverser le Niagara sur un fil car, comme lui, nous avançons audessus d’un gouffre dont les profondeurs agitées évoquent le chaos des eaux de la terrible cataracte. Comment traverser le chaos sans guide ni aide ? Où trouver le jeune adolescent confiant ?
Un jour, on m’appela du bureau de Peter Brook afin que je reçoive un artiste péruvien. J’ai donné tout de suite mon accord car je l’ai assimilé à un messager qui pouvait raconter, témoigner, m’informer sur ton théâtre et celui de Lima. Il n’a jamais deviné les motifs de mon extrême sollicitude à son égard. Jorge Chiarella-Krüger vint me voir à Chaillot, ensuite parla dans un de mes cours à l’Université où il expliqua les principes de son théâtre inspirés par la convention propre aux jeux des enfants : elle exige, insiste-t-il, un respect intransigeant pendant la durée et dans l’espace de l’activité ludique, respect qui cesse brusquement dès que le participant se retire. Nous sommes allés ensemble au stage de Brook. Il devint mon autre ami péruvien.
Quand Tereza Wagner me proposa de participer au colloque Unesco sur le théâtre latinoaméricain qu’elle dirigeait à Lima, je n’hésitai pas un instant. Mais bien que je me réjouisse de la chance offerte, je craignais nos retrouvailles. J’avais changé et, inquiet, je me disais que tu n’allais pas me reconnaître. « Impossible, me rassurait Anne Kokkos, ton regard est le même. C’est à l’aune des yeux que l’on identifie des amis, fût-ce après de très longues séparations ». Depuis, je surveille avec minutie le regard des acteurs car dès lors je sais à quel point il donne à lire les défaites ou les accomplissements par delà l’âge et l’histoire confondus.
J’ai vite appris que tu allais être absente de Lima. Maintenant, des années plus tard, je réunis mes souvenirs pour te raconter les découvertes et les troubles de ma visite à Lima. Mais surtout pour te dire d’emblée qu’elle m’a poussé à te donner raison, cat à Bucarest où la censure frappait durement, personne, ni moi non plus, ne se résignait à croire tout à fait ce que tu racontais sur l’ampleur des difficultés du théâtre péruvien. Les artistes de l’Est se pensaient comme étant les plus sanctionnés dans l’exercice de leur art. Le passage à Lima allait corriger cette conviction.
Dès les premiers jours je fus frappé par l’impossibilité criante de pratiquer le « théâtre d’art » qui alors, en France, regagnait de plus en plus droit de cité. Le théâtre où le plaisir vient de l’exploration d’un texte de jadis, de la découverte d’un personnage, d’un bonheur scénographique ou de la réussite d’un costume. Le théâtre qui développe ses ressources pour entraîner son public vers la connaissance subtile de soi tout en lui offrant la délectation propre à une scène bien maîtrisée. Non, au Pérou, cette hypothèse est inaccessible car la situation exige le choix entre une corruption et une radicalité, entre le théâtre de boulevard et le tiers théâtre.
L’évidence de ce constat devint certitude flagrante lorsque je me rendis dans les lieux de l’Université catholique de Lima, université au nom chargé de résonances magiques pour ces isolés du monde que nous étions en Roumanie lors de ton long séjour à Bucarest. Une salle aux murs lépreux abritait l’exposition du théâtre français et les photos gondolées, de travers, évoquaient à des milliers de kilomètres des spectacles si étrangers. à Lima, l’immense PEER GYNT de Chéreau m’apparaissait comme un temple somptuaire d’un autre monde, audelà des mers, un Bourobodur mythologique. Cette exposition, que pouvait-elle raconter aux artistes péruviens, me demandais-je avec amertume ? Rien, je le crains. En revanche elle me révélait à moi le fossé profond, infranchissable, qui sépare les deux théâtres. Désormais, me suis-je dit, il fallait passer pour quelques jours sur l’autre rive, sans plus retourner le regard. Oublier la France, plonger dans le Pérou. Je passai dans la salle voisine. Salle aux gradins improvisés, médiocrement éclairée par quelques vieux projecteurs délabrés. C’était la salle où tu as donné LA MOUERE… Tant d’absence de moyens me faisait mal. Comment peut-on y travailler ? Jorge Chiarella-Krüger présentait avec son groupe Alondra AMEN, un texte de Juan Rivera Saavedra. As-tu vu cette parabole biblique imprégnée de références au monde actuel ? Les acteurs vêtus de blanc se livrent corps et Âme au jeu, ils montrent leur joie d’oublier le monde pour faire du théâtre et une actrice, l’interprète de Marie, séduit par sa fraîcheur et La brillance du regard. C’est la femme de Chiarella.… ils font ensemble du théâtre, mais en même temps lui est journaliste et elle travaille auprès des jeunes dans une banlieue autour de Lima. Son courage de s’aventurer quotidiennement là-bas, de s’engager dans cette expérience périlleuse au nom d’une exigence éthique personnelle n’est sans doute pas étranger au rayonnement de son visage. Elle s’appelle Céleste.
Comme toi, Jorge manque de livres, d’informations, d’échanges. Une nuit, comme dans une confession, il s’avoue frustré de cette possibilité de dialogue sans laquelle la culture, et le théâtre en particulier, est menacée d’enfermement sur soi. Voire même d’épuisement. S’il a assisté à des séances de Lee Strasberg à l’Actor’s Studio, l’accès aux textes ou le dialogue avec d’autres témoins lui est interdit. « La solitude est difficile à supporter. Elle n’aide pas à avancer », constate-t-il amèrement. À Paris il a rencontré Brook et a participé à ses stages, mais nul film ou vidéo n’est parvenu jusqu’à Lima. Sans cet air de l’extérieur Chiarella se sent guetté par l’asphyxie imminente propre à tout milieu clos. D’ailleurs, depuis ma visite, il a abandonné, semble- t‑il, le théâtre. Comme toi, m’a‑t-on dit. Le Pérou ne satisfait pas la soif de savoir des metteurs en scène intellectuels.
C’est en pensant à vous deux que j’ai adhéré à l’initiative de Mary Ann Vargas qui se bat en Europe pour son Centre de Recherches à Lima. Ce qui ici peut être perçu comme une courageuse initiative culturelle, s’érige là-bas, je le sais maintenant, en véritable opération de survie : les documents aident car ils entretiennent et parfois même engendrent l’imaginaire théâtral. Te souviens-tu de la lecture que nous faisions à Bucarest des études sur LE PRINCE CONSTANT de Grotowski ou sur ANTIGONE de Julian Beck ? Nous les découvrions par la voix des livres.
Connais-tu un autre Jorge ? Jorge Guerra qui vit aux États-Unis et travaille pour une revue de théâtre. À Lima, il apportait un savoir raffiné, une disponibilité et une attention particulière pour la mise en scène. Sans qu’il n’avoue rien, sans intimité aucune, ses exigences intellectuelles par leur simple formulation expliquaient implicitement son exil volontaire. De même qu’une artiste comme toi est venue se former dans cette haute école de théâtre qu’était alors le Conservatoire de Bucarest, Jorge Guerra cherche ailleurs des espaces de travail. Lorsqu’on étouffe il faut toujours partir. Sans pour autant écarter toute hypothèse de retour. Ce qui nous a manqué à nous, les exilés roumains, ce fut justement la chance de ce retour virtuel, retour toujours possible. Aujourd’hui, tardivement, nous accédons enfin à cette situation. mais n’est-elle pas dangereuse, car dès lors que les frontières de l’espace cessent d’être étanches, il faut puiser en nous la force d’une identité apte à résister au voyage entre le pays de choix et le pays natal. Savoir retourner périodiquement comme Jorge Guerra ou Mary Ann Vargas — voilà ce que nous devons apprendre aujourd’hui. Eugenio Barba parle, lui, de « la maison à deux portes ».
À Lima, où ta présence me manquait, j’ai vu des spectacles. En assistant au travail de Mario Delgado avec son groupe historique Cuatrotablas, j’ai reconnu l’influence trop évidente du théâtre de recherche européen, de Barba en particulier. J’ai regretté cette imprégnation mais ensuite, je Me suis rappelé que Delgado fut un pionnier : il a les mérites et les défauts des défricheurs. Après le sentiment de réserve, j’ai éprouvé un véritable émerveillement face au spectacle du groupe Yuyachkani1, ENCUENTRO DE ZORROS. Nous arrivâmes dans un jardin décoré avec ce goût festif dont seule l’Amérique latine détient encore Le secret. Miguel Rubio avait adapté un roman célèbre, roman racontant le passage de la campagne à la ville d’une jeune femme. Alors, dans cette salle d’une maison privée, j’ai vécu l’expérience théâtrale d’un univers immémorial qui remonte à la lumière du jour, l’univers d’un Pérou archaïque que la protagoniste amenait de la montagne et que la vie en ville devait phagocyter. Les corps et les jeux, les accessoires et les lamentations, le deuil et la polychromie, les paysans et les divinités, le naturel et le surnaturel révélaient ensemble l’identité d’une culture incarnée grâce à la pratique exemplaire d’un groupe. Yuyachkani… ma passion ! Existe-t-il encore ce « grupo cultural », comme il aimait à se présenter, le seul à même de réaliser l’union heureuse entre l’héritage péruvien et l’influence « barbienne » ?
Un matin on me présenta Cesar Escuza, jeune homme frêle marqué par cette malformation courante au Pérou due au mauvais maniement du forceps : la hanche accrochée, il marchait en claudiquant. Cesar travaillait à Villa Salvador, une de ces banlieues à l’écart de la ville où comme dans l’‘ENCUENTRO DE ZORROS, la population venue de la campagne s’installa et constitua une véritable communauté autarcique. Nulle part le sentiment communautaire sur fond de paupérisation extrême ne m’apparut avec plus de violence ; cette paupérisation que tu nous décrivais à Bucarest et dans laquelle nous voyions un excès dû à tes options idéologiques. Elle existe, je l’ai rencontrée et, une fois encore, je te donne raison.
À Villa Salvador, Escuza nous a présenté un spectacle réalisé par les habitants du quartier, inspiré et nourri par leur vie, leurs douleurs et leurs rires. Il procurait l’émotion d’un théâtre authentiquement naïf où les gens guidés par un jeune homme moral théâtralisaient l’existence à Villa Salvador. Le spectacle, vu là-bas sur place, je l’ai perçu comme un vrai et admirable autoportrait de groupe. Si tu rencontres un jour Cesar Escuza qui lui aussi a abandonné, dis-lui que je n’ai pas oublié la soirée à Villa Salvador… Tant d’abandons !
Faute de place, je n’ai pu entrer à l’Institut Français de Lima, seul lieu de rendez-vous pour tous les groupes du tiers théâtre. En revanche, j’ai passé une soirée avec quelques-unes de tes anciennes comédiennes qui venaient de se lancer dans l’aventure d’un théâtre féministe. Là-bas, le théâtre doit servir, comme il a servi à Boal que tu as accompagné dans la grande campagne d’alphabétisation. Elles m’ont parlé de toi, de ta vie, de ton courage, car faire du théâtre au Pérou, c’est d’abord se battre. Au nom d’une nécessité. D’un besoin inéluctable. D’un refus de l’iniquité.
Tu m’avais persuadé de ne rater sous aucun prétexte le voyage à Cuzco. Je ne t’ai jamais remerciée, j’en profite maintenant car, grâce à ton conseil, j’ai pu assister le vendredi saint à l’une des plus extravagantes cérémonies théâtrales de ma vie. Cérémonie hétérogène, laïque et profane où le maire défilait à côté de l’évêque et les soldats accompagnaient les dépouilles du Christ pleuré par les Indiens autant que par les blancs. Le cortège s’achevait avec l’ambulance et la voiture des pompiers : la ville toute entière se consacrait à la cérémonie pascale ! Dans la foule de Cuzco, ce spectacle où les fonctions, les rites et les ethnies s’enlaçaient indistinctement, j’ai éprouvé le vertige de ce que devait être l’envoûtement suscité par les Mystères du Moyen-Âge.
À Cuzco aussi, j’ai fait la connaissance d’un jeune homme épris de théâtre qui vint à ma rencontre et à celle d’un ami brésilien avec lequel je faisais le voyage. Cet être renfermé, secret, profond, nous sommes-nous dit, devait avoir plus que des sympathies pour Le Sentier lumineux. Lui aussi considérait le théâtre comme un moyen de combat, combat qui, cette fois-ci, devait s’ajouter à l’autre combat, militaire, car « nous sommes en état de guerre » conclut-il avant de nous quitter en longeant une de ces rues de Cuzco où les maisons aux décorations espagnoles intègrent les immenses pierres des Incas.
Madeleine Zuniga m’a montré Lima et ses statues, m’a parlé des Incas et des conquistadors qui ont transformé en lingots leurs superbes parures, Jorge Chiarella m’a accompagné sur l’allée des princesses, tes amis m’ont fait découvrir le théâtre du Pérou. Maintenant, des années après, j’ai voulu évoquer ce que j’ai découvert alors que tu étais absente. Alors seulement j’ai compris réellement la justesse d’une de tes phrases que je n’oublie pas : « Vivre à Lima sera toujours une épreuve terrible pour tout Européen voué au théâtre ». Ton conseil m’a peut-être sauvé.
À quand ?
Georges
PS. À Bucarest, Ovidiu Moldovan qui a joué merveilleusement Don Perlimplin de Lorca sous ta direction fait un triomphe avec Lopakhine. Pour lui tu restes l’unique preuve de ce lointain théâtre péruvien qu’il n’a jamais rencontré. Penciulescu devait revenir au Conservatoire. Après vingt ans.
- Yuyachkani veut dire : « je me souviens en me souvenant ». Le mot réunit trois sens : « je suis en train de penser, de me souvenir, de méditer ». ↩︎