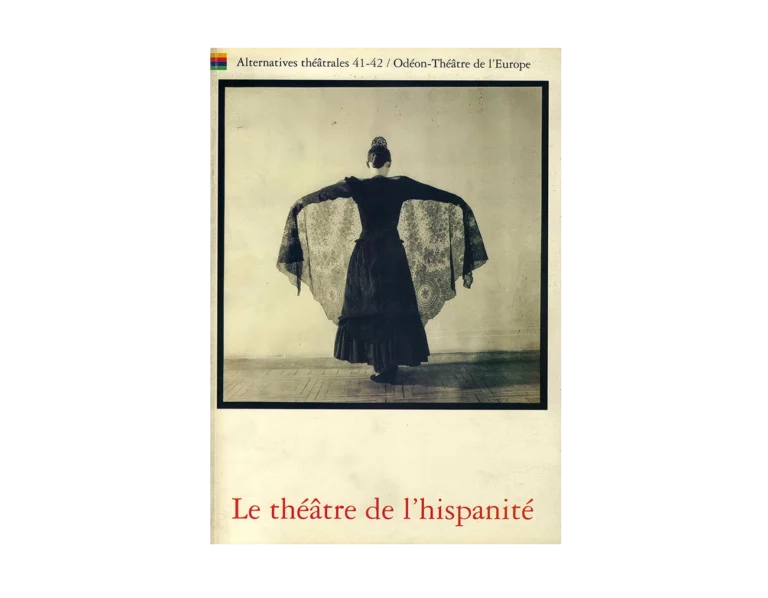TENTER d’éclairer, d’élucider, comme disait fréquemment Borges en conversation — pour lui, très souvent, quelque chose était « objet d’élucidation » — les rapports ambigus et quelque peu obturés de la France avec l’Espagne. Je propose à cet effet une méthode très simple, mais très utile, celle utilisée depuis Saussure et qui consiste tout simplement à ne pas envisager un terme en soi, mais à le confronter, à l’opposer ou l’«homologiser » avec un autre. Soit donc d’un côté la relation de la France avec l’Italie, et de l’autre la relation de la France avec l’Espagne. Une telle paire de significations facilite grandement la compréhension.
Les relations entre la France et l’Italie, disons depuis la Renaissance, pour ne pas jouer les archéologues de la relation et du savoir, ont été parfaites. Les deux pays se sont fécondés l’un l’autre. Sans être historien, je pense certes aux guerres d’Italie qui ont mêlé les deux pays, et je rappellera, même s’il s’agit presque d’une boutade, que Leonardo da Vinci a fini ses jours ici en France, à Amboise, en 1519. Mais l’essentiel n’est pas là ; l’essentiel est une homogénéité culturelle profonde, un même enracinement dans la romanité — celle de l’antiquité et celle du pape — et rien qu’elle. Tout s’ensuit alors naturellement. L’école de Fontainebleau, par exemple. La représentation italienne a profondément marqué la représentation française, le sfumato, introduit à ce moment-là ; mais avant, toute la perception française a été évidemment influencée par la découverte de la perspective italienne.
Et Blois répétant Urbino. Les Français de la Renaissance rencontraient en Italie une autre façon de vivre, mais qui ne se fondait sur rien qui leur soit radicalement étranger. Qu’ils pouvaient donc assimiler sans problème. (Cela n’est pas toujours resté vrai dans la suite, mais comme une obscurité secondaire.) Une relation très affectueuse donc ; je dirais amoureuse.
L’autre terme de la comparaison, la relation de la France avec l’Espagne, a toujours été une relation non seulement trouble, mais proprement une relation basée sur l’incompréhension, celle qui engendre des stéréotypes. Quand deux personnes ne se comprennent pas, aucune ne l’avoue, mais chacune émet sur l’autre des stéréotypes pour créer autour d’elle une espèce d’écran conceptuel. Telle a été, et je dirais presque jusqu’à nos jours, la relation entre la France et l’Espagne. Je ne cite pas Le cliché Le plus soutenu, le plus parcouru : Mérimée et autres. Claudel échappe peut-être à ce catalogue de lieux communs.
Il y a là comme un dialogue qui n’arriverait pas à s’amorcer. Qu’est-ce qui a pu, dans l’entité de l’Espagne, créer cette espèce d’opacité, ce point infranchissable, quelque chose d’’illisible et d’indicible ? Il me semble qu’il faut chercher ce point d’opacité dans la constitution même du pays, dans son être, et non dans une quelconque contingence. Quel est l’être du pays, jusqu’à la découverte ? Il y a des chrétiens, il y en a même beaucoup, mais il y a aussi de nombreux musulmans et juifs, et qui tous trois jouent un rôle égal dans la constitution tant de la vie institutionnelle que du savoir. On me dira qu’il y avait aussi quelques petites colonies juives ou musulmanes en Italie, mais cela est sans commune mesure avec Grenade, par exemple. Et je soutiens que Grenade ou Cordoue sont ce qu’il y a de plus important dans l’histoire, non seulement de l’Espagne, mais de l’Islam. L’Islam, du Coran jusqu’à nos jours, a produit, comme apothéose et comme fleur, Cordoue. Je crois qu’une part du non vu, du non perçu en France se situe du côté de cette relation à trois, constituante de l’Espagne éternelle ; à la fois chrétienne, juive et musulmane.
Par exemple, il n’y a rien qui en France (et en Italie) s’approche de la mystique espagnole. Mais Saint Jean de la Croix ne serait pas compréhensible sans la double relation au Nuage d’inconnaissance hébraïque sépharade et aux textes canoniques iraniens.
Plus quotidiennement, la hauteur susceptible du gentilhomme espagnol — stéréotype pour Le regard critique des Français sur l’Espagne — est manifestement de tradition maghrébine : c’est le sens de la grandeur de l’homme du désert. Et il faut peut-être passer par la Kabbale, née en Espagne, et Suarez, passer par cette interrogation obsédante de la lettre, pour saisir la majesté du son chez Géngora, et le triomphe de la agudeza chez Graciän. (En passant, il faudrait se demander pourquoi les jésuites ont pu se répandre en France sans y transporter l’esprit espagnol.)
Le baroque, élément essentiel lui aussi de l’Espagne et de l’hispanité, constitue, à mon avis, une autre part de cet indicible, tandis que le baroque italien a pu être adapté, assagi, rendu classique en France. La France a toujours été un pays de gens économes, un pays austère, un pays de personnages souvent liés aux affaires. Je dirais que ce tableau du Louvre, un tableau fabuleux vraiment, qui représente un peseur de monnaie et sa femme, est un tableau de l’entité française, bien qu’il soit l’œuvre d’un peintre flamand. Ce pays sévère, austère ne pouvait tolérer ce que représente, idéologiquement mais surtout psychanalytiquement la dépense démesurée du baroque espagnol, celle du rococo ou de Churriguerra (1665 – 1725), un mouvement proprement ibérique qui représente en quelque sorte l’apothéose du baroque. Le sommet de cet art est peut-être la chapelle de Burgos, bien que sa construction soit beaucoup plus tardive, ou encore la fenêtre du couvent du Christ à Tomar, au Portugal, un chef d’œuvre de l’art manuelin. Il y a là un point de clivage très marqué.
Deux petites notes analytiques. Première note : dans l’échange de savoir entre la France et l’Italie, n’oublions pas que la partie fondatrice de l’œuvre lacanienne s’est prononcée à Rome. Lacan, parlant de l’Italie, de la scène italienne, disait que c’était « l’autre scène » . Mais il le disait en pensant justement au versant le plus baroque de l’art italien. Et de fait, s’il est un penseur d’ici qui n’a pas été fermé à la culture espagnole — Suarez, Gräcian, Saint Jean, Velasquez —, c’est bien Lacan. Seconde note : on peut se demander pourquoi ce refus français de l’or, pourquoi ce refus du gaspillage, en situant bien entendu la question au-delà de l’économie française, du savoir de contrôle français. La réponse, je crois, se trouve déjà chez Freud, le refus provenant tout simplement de ce que l’or est vécu peut-être comme séminal, sûrement comme excrémentiel. La France, pays propre, net, sans bavure, si j’ose dire, ne pouvait tolérer pareille dépense.
Or, qu’est-ce que l’Espagne une fois qu’elle s’est — ou croit s’être — privée, castrée de deux cultures qui la constituaient ? D’un côté, elle est devenue (sinistrement) papale, une grande organisation régentant une foule de peuples. C’est la revanche de la latinité. Et on oublie souvent ici que la cour de Madrid s’est constituée comme un ritespectacle avant Versailles, a servi de modèle à Versailles.
Il y a un livre réellement lumineux qui « élucide » la vie de Velasquez, un livre qui m’a bouleversé par son savoir, c’est la biographie de Jonathan Brown. On en apprend sur le peintre des vertes et des pas mûres. Contrairement à Shakespeare (pour appliquer encore ce système binaire), dont on ne sait presque rien, de Velasquez on sait tout. Première opposition. Mais surtout, quel homme d’entreprise, quel manigancier, quel promoteur, quel diplomate, quel carriériste que cet homme de cour ! On a le sentiment de quelqu’un qui est avide seulement de recevoir des décorations et d’acquérir du pouvoir. Velasquez est peut-être mon peintre préféré, LES MÉNINES constituent pour l’exilé cubain que je suis une famille. Je vais Les voir de temps en temps comme on va voir sa famille. La biographie de Brown m’a absolument secoué, lorsqu’elle m’a révélé quel était le personnage de Velasquez, un véritable homme d’affaires, un diplomate au mauvais sens du terme, il se peut même que son mariage ait obéi à ce désir de promotion. On découvre là une contradiction vertigineuse entre la vie d’un être et ce que cet être peut produire.
Mais cela dit, que fait Velasquez quand il peint ? Il retrouve le jeu de miroirs d’une société qui n’est pas une, qui se sent regardée par son autre. Le baroque espagnol, c’est le règne du double retourné.
Mon opinion sur LES MÉNINES m’a valu d’être régulièrement insulté, et cela dès mon arrivée en Espagne, au musée du Prado où j’ai travaillé plusieurs mois sur ce tableau. Ce que je pense des MÉNINES, évidemment, ne saurait être prouvé. Je suis pourtant convaincu que cela est vrai. Au Prado, j’ai tenté d’obtenir une photographie du châssis du tableau. Je soupçonne que le châssis du tableau correspond exactement au châssis qu’on voit au premier plan à gauche. Ce qui signifierait que le tableau dont on ne voit que l’envers dans LES MÉNINES devant Velasquez n’est pas un portrait du roi et de la reine restés à la place du spectateur et reflétés dans le miroir du fond. On ne connaît d’ailleurs aucun tableau de Velasquez représentant les deux souverains, une telle œuvre ne figure pas au catalogue (très précis) de son œuvre. De plus, le protocole interdisait que le roi et la reine apparaissent ensemble. Si je considère en outre la distance à laquelle serait posé le modèle, il serait impossible qu’il se reflète dans le miroir du fond. Il est vrai que Velasquez connaissait Van Eyck et le tableau des ÉPOUX ARNOLFINI, qui avait passé par la collection du Prado. Mais je soutiens que le tableau que Velasquez peint là, et ce n’est pas pour céder à la fascination de la tautologie, ce sont LES MÉNINES.
On m’a souvent demandé, surtout en Espagne, de prouver cette assertion. En voici une espèce de preuve, où l’on revient (par quel détour !) à la littérature baroque : au début de la seconde partie du QUICHOTTE, Cervantes, et non Don Quichotte, se promène dans Tolède. Il flâne et découvre une librairie. Il y entre, évidemment, et trouve un livre en arabe. Cervantes ne comprend pas l’arabe, mais quelque chose le frappe : dans le manuscrit arabe, on nomme une certaine Dulcinée du Toboso. On dit même à propos de la belle une chose très curieuse, qu’elle a une main magnifique pour saler Le porc. Cervantes trouve tout à fait bizarre que l’on parle de porc dans un manuscrit arabe, le porc est un plat interdit chez les juifs et les musulmans. Il veut savoir ce qu’est son étrange découverte et se met à la recherche de ce qu’on appelle un aljamiado, un musulman qui connaît l’espagnol. La traduction révèle qu’il s’agit du QUICHOTTE, du QUICHOTTE en arabe à l’intérieur du QUICHOTTE en espagnol, c’està-dire inversé, puisque l’arabe se lit de droite à gauche et l’espagnol de gauche à droite. Comment ne serait-ce pas dès lors, cher monsieur le Conservateur du Prado et d’autres musées du monde entier, LES MÉNINES, inversées, qui sont représentées dans LES MÉNINES ?
Un autre trait de la culture espagnole qui plonge les Français dans la perplexité est le recours à un expressionnisme grinçant, celui que Valle-[nclän a désigné comme esperpento, soit à peu près la référence à un épouvantail de tradition goyesque. De fait, l’art espagnol, de Goya surtout jusqu’à ValleInclén, n’a‑t-il pas été un art esperpentico ? Velasquez était un peintre esperpentico, il suffit de voir sa collection de nains et de pieds-bots. Or, au-delà de cette expression et de cette démesure, je crois qu’il y a comme une secousse plus centrale, au niveau du sujet. Pour se reconnaître dans une figure grimaçante ou monstrueuse, ou déchirée, il faut que le sujet se soit découvert excentré : non présent de part en part à lui-même. Certains systèmes astronomiques commençaient à l’époque à décentrer le cosmos, à le décentrer d’abord de la terre, à le décentrer ensuite du soleil et enfin de l’homme. Plus exactement, l’homme s’est trouvé tout à fait mis à l’écart par le bouleversement des nouvelles connaissances astronomiques. L’Espagne, qui ne possédait pas à cette époque de grands théoriciens de l’astronomie (j’allais dire de la cosmologie), qui ne possédait pas un Képler pour contredire Galilée et le cercle des orbites planétaires, s’est tournée vers une excentration du sujet. Donnant moins à la science mais plus à la psychologie.
À ce point, il me faut tout de même parler de l’Amérique du Sud. Baroque encore, dans ses expressions parfois les plus réussies, comme le baroque mexicain, ou l’œuvre du sculpteur brésilien Aleijadinho (1738 – 1814). Jusqu’à présent, et surtout dans l’œuvre d’Eugenio D’Ofrs, on cherchait un fondement naturel à ce baroque. D’Ors dit que « le baroque est un parc portugais à l’heure de la sieste », Carpentier (qu’il ne faut pas oublier si l’on parle du baroque), que « c’est la descente de l’Orénoque ». C’est la forêt, la jungle, l’exubérance. Les grands exégètes du baroque trouvaient donc son fondement dans la nature. Élève de Roland Barthes, et par làmême de la tradition saussurienne, pour qui la langue n’est pas motivée, mais arbitraire, j’ai tenté de voir le baroque comme un artifice de plus. La base en est peut-être naturelle, mais ce qui m’intéresse dans le baroque, c’est la greffe, le fait qu’‘Aleijadinho, qui signifie le petit paralysé ou le petit tordu, incrustait dans la façade portugaise des éléments qu’il tirait de la mine. Aleijadinho était un mulâtre, un homme du métissage. Plus que l’‘homologie avec la nature, plus que l’image de la nature, c’est le métissage des langues et des peaux, cette artificialisation qui a donné naissance au baroque sud-américain. La langue espagnole, au sens architectural du mot langue, est venue se mêler à d’autres. Il en a résulté une espèce de patchwork, un nouveau baroque, où chaque fois plusieurs cultures — indigènes, noires, coloniales — se mêlent sous un quatrième signe : la démesure de l’espace, la fragilité des hommes au regard d’une immensité où ils semblent toujours destinés à disparaître.
Propos recueillis par Jean B. Torrent.