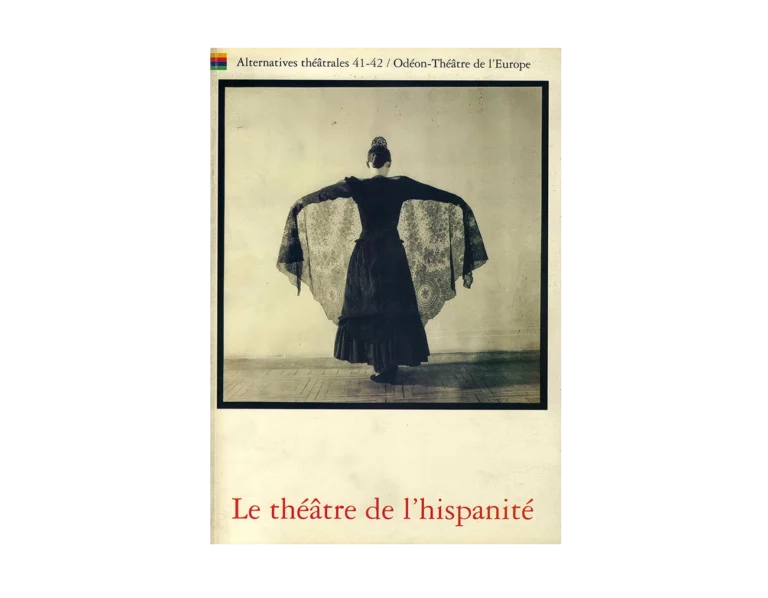GÉRARD RICHET : Au cours des dernières années, vous avez monté trois pièces espagnoles. Qu’est-ce qui, à un moment donné, a motivé votre intérêt pour le théâtre espagnol ?
Jacques Nichet : Quand je suis arrivé à Montpellier, il m’est apparu comme une évidence qu’il fallait s’ouvrir au théâtre espagnol, parce que Montpellier a été une ville espagnole, parce que je rêvais que tous les dimanches je serais sur les Ramblas de Barcelone, et parce que je pensais que les contacts entre les deux pays seraient très faciles. Il me semblait aussi qu’un rééquilibrage était nécessaire. Nous autres, metteurs en scène français, avions fait la part belle au théâtre allemand et au théâtre nordique, et le Sud était relativement peu représenté, mise à part l’Italie. L’Espagne avait vraiment été oubliée. Je m’empresse de dire que je ne parle pas l’espagnol. Mon désir était de découvrir quelque chose que j’ignorais totalement. Et je me disais que ce que moi j’avais découvert, je pouvais Le faire découvrir aux autres. J’ajoute qu’il y avait aussi en moi un désir de découvrir ma propre culture. Je me sens profondément méridional : c’était un peu une manière de découvrir mes voisins, et ce désir m’anime toujours aujourd’hui.
G.R. : Comment avez-vous procédé pour mener à bien cette entreprise de découverte ?
J.N. : Ma démarche est à la fois. volontariste et hasardeuse. Je ne me fonde pas sur une culture préalable. Ma culture naît chaque fois d’une envie de découvrir justement ce que je ne connais pas. J’essaie à un moment donné de me donner un champ d’action, une découpe. À l’Aquarium, on travaillait déjà de cette manière. On disait, par exemple : on va faire une pièce sur la maladie. On polarisait toute notre attention sur ce thème de la maladie. C’est comme cela que j’ai rencontré Ferdinando Camon et LA MALADIE HUMAINE et qu’on a eu l’idée de l’adapter. En ce qui concerne l’Espagne, les choses se sont passées de cette façon. À un moment donné, on va vers ce qu’on ne connaît pas, vers ce qu’on a envie de connaître. Le reste est un peu mystérieux : il y a des milliers de pièces, et on n’en choisit que deux ou trois.
Avec Jean-Jacques Préau, j’ai lu ou relu des pièces de Garcia Lorca. J’avais choisi Garcia Lorca comme un point de repère très connu du public français, en me disant qu’il constituerait pour moi une porte d’entrée qui me permettrait ensuite de découvrir d’autres choses en Espagne. J’ai tout de suite été séduit par LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE. Ensuite, l’enchaînement s’est fait presque tout seul. Grâce à Lorca, j’ai découvert LE MAGICIEN PRODIGIEUX , puisque LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE est un jeu de mots à partir du titre de la pièce de Calderón. Mon attention étant concentrée sur l’Espagne, je suis tombé en arrêt sur le roman de Tomeo, MONSTRE AIMÉ, et j’en ai monté l’adaptation.
G.R. : Avez-vous l’intention de poursuivre votre exploration du théâtre espagnol ?
J.N. : Pourquoi pas ? JeanJacques Préau, qui est le responsable du comité espagnol au sein de la Maison Antoine Vitez, me fera rencontrer vraisemblablement de nouveaux textes. Grâce aux lectures de pièces espagnoles contemporaines qui sont prévues au Théâtre de la Colline et au Théâtre de l’Europe, j’en rencontrerai d’autres. Mais, pour le moment, je n’essaie plus de ratisser systématiquement l’Espagne. Actuellement, je m’intéresse à l’Italie. Dans un premier temps, cela a été l’Espagne et, de fil en aiguille, par une sorte de glissement naturel, maintenant j’essaie de découvrir davantage l’Italie, avec des pièces d’Eduardo de Filippo et une adaptation d’un texte de Giovanni Macchia. Cela n’était pas clair dans ma tête lorsque j’ai décidé de monter LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE, mais maintenant j’ai envie de voyager autour de la Méditerranée et de faire escale dans différentes villes : Naples, Rome, bientôt Marseille, et pourquoi pas le Liban, Tunis, l’Algérie. En même temps, je ne veux pas m’emprisonner dans une image figée, du type Nichet = Méditerranée. Je suis prêt à monter un auteur suisse où allemand. Je ne veux pas non plus donner l’impression de ne m’occuper que des auteurs étrangers. Je vais aussi monter des auteurs français contemporains. Prochainement, je vais mettre en scène une pièce de Serge Valetti, et cela me touche particulièrement parce que sa pièce se situe à Marseille, qui est, au même titre que Naples, une des grandes villes du bassin méditerranéen. En tout cas, ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de faire découvrir un théâtre très grand public, qui, paradoxalement, est pratiquement inconnu du grand public : c’est le cas des deux pièces de De Filippo. Il y a donc un travail tout à fait humble de découverte et d’inventaire à faire, et 1 j’aimerais poursuivre ce travail.
G.R. : Votre mise en scène de LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE a donc été le point de départ de votre cheminement. Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce texte ?
J.N. : J’ai monté LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE comme un manifeste. C’était à la fois une ouverture sur l’Espagne et un manifeste esthétique : celui de la légèreté contre l’argent, de la rapidité contre la longueur, du court métrage contre le long métrage, de l’art de la miniature contre la fresque, de la nouvelle contre le roman. Je m’intéresse beaucoup à la forme brève. Je trouve qu’on a trop privilégié les chefs-d’œuvre, les œuvres immenses. Trop de MISANTHROPE, trop de HAMLET ont écrasé les choses légères. II me paraît intéressant — j’ai essayé de le montrer avec Eduardo de Filippo — de remettre au goût du jour le lever de rideau, de faire en sorte que ne disparaisse pas l’intérêt profond pour les courts métrages avant les longsmétrages, de préserver la variété à l’intérieur même du spectacle. Je trouve qu’il y a un penchant trop grave à faire des trilogies massives. Je ne suis pas contre cela, mais je voudrais aussi que l’on réserve une place à la légèreté des petites formes. Je crois qu’il faut rester plus simple. D’une certaine manière, cette lourdeur écrase, et la culture devient lourde. Il faut que le spectacle soit un divertissement et, à mes yeux, le divertissement doit rester léger. Tout .cela, on l’apprend par LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE, par l’esperpento de Valle-Inclán.
G.R. : Avez-vous repéré dans les pièces espagnoles que vous avez montées des traits singuliers, spécifiques, qui seraient, en définitive, ceux de l’hispanité ?
J.N. : Je ne sais pas s’il y a un théâtre hispanique. Je crois qu’il y a un théâtre en Espagne. Ce n’est pas tout à fait pareil. Le théâtre peut échapper à l’Espagne. Il y a un exil intérieur des auteurs. L’auteur est d’un pays et en même temps c’est un exilé intérieur. La peur que j’ai avec le théâtre hispanique, c’est qu’on essaie d’emprisonner l’auteur dans une langue, alors que tout auteur cherche à échapper à sa langue. C’est cette tension qui est intéressante. En tout cas, la question que je me pose au moment où je monte une pièce est : qu’est-ce que m’apporte cette pièce, à moi ? Et, en ce qui concerne les pièces espagnoles, il ne s’agit sans doute pas d’une découverte de l’hispanité.
Si je devais relever un trait commun entre ces trois pièces très différentes, qui n’ont rien à voir entre elles, ce serait celui de l’immaturité. Ce sont des œuvres qui nous racontent l’immaturité. L’immaturité du savetier, qui est totalement infantile, et celle de la savetière, qui l’est encore plus que lui. Toute la correspondance de Lorca que j’ai pu lire me fait beaucoup penser à Flaubert. On y voit un être qui se sentait mort avant de naître et qui a cherché à naître. Je pense à cette magnifique lettre de Lorca : « Je ne suis pas encore né ». C’est cela qui m’a vraiment intéressé. On a plaqué sur Lorca une image espagnole, celle des murs blancs et des femmes en noir qui pleurent. Et tout à coup on s’aperçoit qu’en fait il s’agit de choses très légères, mais qui parlent du mal à être, du mal à vivre, du mal à éclore. Tomeo, qui représente l’Espagne moderne, celle qui essaie de s’arracher ces oripeaux, ne fait que se moquer de Lorca, qu’il considère comme un auteur folklorique, trop espagnol. Pourtant, il existe un lien très net entre Tomeo et LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE, c’est celui de l’immaturité. L’immaturité de Juan D., qui est resté trente ans dans les jupes de sa mère, comme s’il y avait difficulté à naître une seconde fois. Et je dirai que LE MAGICIEN PRODIGIEUX nous raconte la vocation de quelqu’un qui veut être un intellectuel, un savant, un philosophe, qui va découvrir l’amour, puis le martyre, et qui va naître à autre chose, à une autre vie, qui va lui aussi trouver sa maturité par l’immaturité. Vous voyez qu’on est loin d’une sorte d’étiquette espagnole qu’on pourrait attribuer à ces œuvres. Ce sont ces constantes-là qui m’intéressent. Mais je ne saurais faire le tri entre ce qui appartient à l’Espagne et ce qui m’appartient à moi. C’est peut-être moi qui veux les lire de cette façon.
G.R. : Les titres des trois pièces espagnoles que vous avez montées contiennent les mots prodige, magie, monstre. Est-ce ainsi que vous voyez l’Espagne ?
J.N. : C’est comme cela que je vois le théâtre, pas l’Espagne. L’Espagne me permet d’alimenter, grâce à ces pièces, quelque chose qui est loin du théâtre. Là, je rejoins Vitez lorsqu’il dit que le théâtre est de l’ordre du miracle. On joue la création du monde, on joue la transsubstantiation de l’homme en dieu, du dieu en animal ; on va en enfer, on peut raconter le miracle, la vie est un miracle. On joue. LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE raconte cela, elle raconte le prodige du théâtre, qui va faire que le savetier, revenant comme montreur d’images, va pouvoir essayer de se venger de sa femme, de se rapprocher d’elle, grâce aux déguisements, aux costumes, au jeu.
Le théâtre est aussi Le lieu où on s’interroge. Qu’est-ce qu’un homme normal ? Qu’est-ce qu’un homme monstrueux ? Shakespeare s’interroge sur les monstres. Le théâtre pose la question de la norme et du monstrueux. Ce qui m’a intéressé dans le texte de Tomeo, c’est de voir comment la monstruosité n’est faite que de banalité. C’est là que réside la force esthétique de Tomeo : il montre comment, à force de petites banalités, de petits coups d’épingle, on crée un monstre, comment la société, dans sa banalité, crée un monstre à l’intérieur d’un bureau ordinaire, d’une banque ordinaire. C’est tout à fait passionnant. LE MAGICIEN PRODIGIEUX, c’est aussi cela. Qu’est-ce qu’un miracle, qu’est-ce qu’une émotion qui oblige l’homme à se dépasser lui-même, qu’est-ce que Dieu, qu’est-ce que le diable, surtout ? Pourquoi y a‑t-il le mal sur terre, pourquoi les sacrifices, etc.
L’Espagne n’est là qu’un réservoir pour alimenter quelque chose qui permet de revivifier le théâtre. Encore une fois, ce n’est pas du tout du théâtre espagnol, c’est l’Espagne au service du théâtre, c’est l’Espagne théâtrale plutôt que le théâtre espagnol.
G.R. : Parmi les idées reçues concernant l’Espagne, il en est une qui consiste à attribuer un profond sens tragique à l’âme espagnole. Un ouvrage célèbre de Unamuno semble d’ailleurs corroborer — de l’intérieur — cette assertion. Cette dimension est-elle sensible dans les pièces que vous avez montées ?

J.N. : Les trois pièces que j’ai montées sont des fils ténus entre la comédie et la tragédie, mais ne virent jamais dans la tragédie. LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE se termine par le triomphe du mariage de la réalité et de l’illusion. Elle raconte le mystère de la vie humaine partagée entre le désir d’un ailleurs toujours impossible à atteindre et le quotidien, représenté par ces chaussures qui s’usent jour après jour. Ce mariage impossible est toujours en danger, mais ce n’est pas tragique, c’est la vie, c’est la condition humaine, faite de bonheur et de malheur, de tragique et decomique. Cette fable est extraordinaire et elle n’est pas espagnole. Lorca dit lui-même que sa pièce n’est pas andalouse, bien qu’il y ait des guitares, qu’il a écrit une fable métaphysique, comme Platon. Il ajoute que Les Eskimos pourraient monter cette pièce. MONSTRE AIMÉ non plus n’est pas tragique. Le quotidien et la société craignent le monstrueux, mais on vit avec, tout le monde est un peu monstrueux, et on s’en accommode. La pièce de Calderón n’a rien de tragique non plus, puisqu’elle montre qu’il y a des valeurs qui dépassent la mort, qui transforment la mort, lorsque le martyr entre dans le lieu de la rédemption, du dépassement de soi. S’il y a un théâtre qui n’est pas tragique, c’est bien celui de Calderón.
Je dirai donc qu’on tire de l’Espagne des forces d’espoir et de générosité, qui nous éloignent du tragique. Il est vrai que l’on voit très souvent l’Espagne à travers le sang et l’or des courses de taureaux, mais ce n’est pas ce que moi j’ai perçu à travers ces pièces.
G.R. : Quelle est votre attitude face à la traduction ou à l’adaptation des pièces étrangères que vous montez ?
J.N. : Je ne connais pas la langue, mais je travaille beaucoup avec le traducteur ou l’adaptateur. Avec eux, j’essaie d’avoir toujours un regard sur le texte original. Et je n’ai jamais coupé l’original. Dès qu’il y a une difficulté de mise en scène, on revient au texte original pour essayer de comprendre vraiment l’intention de l’auteur et les effets stylistiques attendus. Quel est le mot qui finit la phrase, quelle est la scansion, quel est le rythme ?
Le travail sur le plateau rejaillit aussi sur la traduction. C’est ce qui s’est passé avec le texte de De Filippo, qui pose un problème de mélange de langues. Un personnage parle napolitain et l’autre parle italien, avec des fautes de grammaire. C’est intraduisible. On s’est amusé à essayer de trouver des équivalences. On s’y est mis à beaucoup. Plusieurs versions ont été faites. Avec les comédiens, on a testé, on a cherché des solutions.
G.R. : Vous décrivez comme un glissement naturel votre migration de l’Espagne à Naples, comme si les deux étaient liées par une connivence évidente. Pouvez-vous expliciter le lien qui les unit ?
J.N. : Si pour monter LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE et Eduardo de Filippo je fais appel à la même comédienne, c’est parce qu’il s’agit du même répertoire. J’y vois un théâtre que j’aime et qui me parle, qui est, je crois, ce théâtre de la légèreté et du mélange des genres dont je parlais tout à l’heure, ce théâtre rapide, domestique, violent. Et je n’ai pas l’impression que les Napolitains et les Espagnols soient différents. Je crois qu’il y a un lien très fort entre Eduardo de Filippo et les auteurs espagnols dont j’ai monté les pièces : c’est le jeu de l’illusion et du réel. La vie est un songe. Ne sommes-nous pas en train de rêver le réel ? Qu’est-ce qu’une apparence ? Qu’est-ce qu’une image ? Qu’est-ce qu’une idole ? On voit à travers ce jeu, qui est un jeu de théâtre, que ces pays ont bien compris ce qu’est Le théâtre et qu’ils alimentent, avec leur humour et leurs variations propres, quelque chose qui les rapproche. Je ne suis pas sûr qu’Ibsen et Strindberg parlent de l’illusion et de la réalité comme en parlent Lorca et de Filippo. On rencontre peut-être là quelque chose qui est au-delà de l’hispanité, quelque chose qui appartient à notre berceau méditerranéen, cette idée que la vie est un songe.
G.R. : Vous n’avez pas rencontré l’hispanité, mais il semble, en revanche, que la Méditerranée renvoie à vos yeux une image d’unité. Y a‑t-il un chemin ininterrompu qui court tout autour du bassin méditerranéen ?
J.N. : On ne peut nier qu’il existe un berceau culturel commun, malgré des siècles de séparation. Je pense qu’il y a un esprit du Sud, différent de celui du Nord. On sent bien que Strindberg et Ibsen, ce n’est pas le Sud. Et Tchekhov non plus. Le bassin méditerranéen existe, il est un lieu qui nous réunit, et en même temps il est divisé, déchiré. C’est peut-être au carrefour de ce désir d’union et de cette désunion tellement évidente que le théâtre peut essayer de voir et de faire voir quelles sont ces fractures, quel est ce désir d’être ensemble dans cette Méditerranée, qui est notre berceau commun.
Cela dit, il ne faut pas essayer de créer un consensus qui n’existe pas. Je crois qu’il y a une particularité de chacun d’entre nous, de par notre existence historique, de par la définition de nos choix, que nous sommes ancrés dans un pays — cela, je le crois vraiment —, mais il faut savoir dépasser cela. C’est pour cette raison que j’ai pris Le nom de Treize Vents pour mon théâtre, pour bien montrer que je ne vais pas m’enraciner et que l’attachement au sol se fait par le vent. On parle d’un endroit donné, c’est entendu, mais il faut parler à tout le monde.
Dans cet ordre d’idée, j’ai actuellement un beau projet, auquel sont associés Jean-Jacques Préau, l’Institut du Théâtre Méditerranéen et le Centre de Recherche sur l’Europe, qui consiste à réaliser un recueil de farces de chaque pays de la Méditerranée depuis 1900 à aujourd’hui. Il s’agit de trouver dans chaque pays une ou deux farces caractéristiques, afin de montrer les mille nuances de l’humour méditerranéen. Est-ce que cela existe ? Qu’est-ce que la farce ? On revient ici à l’idée de forme brève dont je vous parlais tout à l’heure. Ce sera une manière de rencontrer les poètes. Je ne connais pas les poètes libanais, syriens, israéliens ou algériens. Ce sera aussi une manière de faire un inventaire de la variété de nos différences et de nos désunions. Encore une démarche à la fois volontariste et hasardeuse.
Entretien réalisé par Gérard Richet