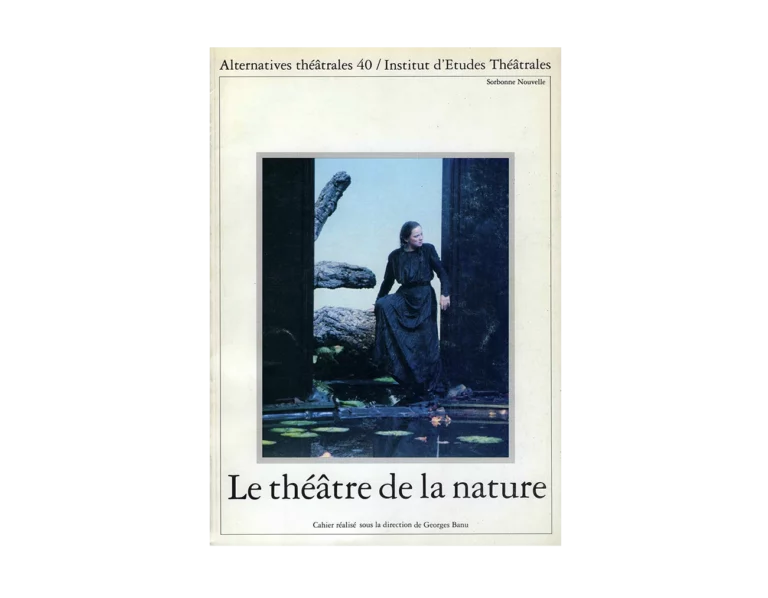« Nature immense, impénétrable et fière ! »
LA DAMNATION DE FAUST, Berlioz
SUR l’infranchissable scène d’un théâtre, que celui-ci soit ou non un lieu entièrement fermé, imperméable aux bruits et à la lumière du monde, la nature foisonnante et imprévisible — la nature libre — sera toujours exclue. Du moins une telle « entité » figure-t-elle comme l’antonyme absolu du théâtre. Au premier la maîtrise et la concentration du monde, à la seconde l’infini et l’immensité de l’immafñtrisable. L’un se pose par rapport à l’autre, et la rejette aux bornes du théâtre. Rebelle à l’histoire, à l’intrigue, force immémoriale et indifférente, incompressible dans la durée ou l’espace du théâtre, et qui se contente d’être, foncièrement non dramatique, la nature se voit renvoyée par le théâtre dans un intouchable ailleurs, dans un espace ambivalent de répétition et de chaos, de désordre, de désarmante stabilité. La représentation de la nature se révèle donc comme l’une des figures les plus claires des contradictions nées de l’illusion théâtrale. À la fois signe et référent du monde réel, l’élément naturel sur une scène, ravalé au rang d’objet scénique étroit et ambigu, potentiellement entaché de fausseté, montre combien la représentation de la nature peut devenir l’obstacle scénique irréductible.
Sur le théâtre celle-ci ne sera qu’une pièce rapportée, un fragment-signe de cet ailleurs définitivement exclu. En scène et à condition qu’elle soit minoritaire, qu’elle trouve sa place dans un ensemble de figures, la vraie nature, celle de l’eau qui mouille et de la terre qui salit, celle des fleurs que l’on flétrit et du sable où l’on se roule, apparaît ainsi comme un facteur immédiat de nostalgie. Par elle nous saisissons qu’une dimension nous a échappé, parce que nous l’avons bannie du théâtre, mais au même instant, elle nous est rendue, brièvement, d’autant plus désirable et pourtant dérisoire. Car un élément naturel convoque avec lui l’ensemble du réel, dont il ne peut être séparé. La nature est alors réminiscence. Au contraire, omniprésente, largement utilisée, cette vraie nature fera basculer l’effet scénique en sens inverse. La nostalgie aura fait place à des effets de réel, entravant le processus de l’illusion théâtrale, et nous renvoyant brutalement au monde. La nature peut bien être récurrente dans un texte dramatique, comme référence à un décor, à des matières, à la respiration du temps, un metteur en scène se révélera grandement à travers ses choix, sa volonté de montrer telle quelle la vraie nature, ou de la figurer par d’autres moyens.
À l’origine des arts, chacun le sait, la nature se dresse, telle une divinité jalouse et protectrice : elle est le mot d’ordre et la légitimité, le matériau, l’objet fondateur et fondamental, puisque la nature, certes, ne se peut égaler, mais toujours s’offre à l’imitation. Or, qu’est-ce donc que la nature à l’opéra, au sein d’un art traversé par le double dogme de l’artificialité et de la naturalité du chant ? Car d’une part l’opéra affiche la convention d’un genre où l’on ne parle pas mais où l’on chante, en opposition à l’idée la plus immédiate du naturel, mais d’autre part la mise en avant du corps à travers le chant participe inévitablement d’une consécration de la nature. En outre, la musique entrant difficilement dans le système esthétique classique, qui repose sur la théorie de l’imitation, il lui est traditionnellement confié la tâche non pas d’imiter la nature, mais les effets de la nature sur les hommes, autrement dit les passions. En cela la théorie classique de la musique multiplie les intermédiaires entre la nature et l’objet musical, mais en pratique, cette théorie rapproche considérablement la nature du moi. Par la musique, la nature cesse d’être un objet extérieur, un décor plus ou moins lointain dans lequel nous serions immergés, pour se confondre avec le sujet lui-même. Autrement dit la musique installe la nature au cœur de l’intimité, avec tout ce que cela suppose d’indicible ou d’informulé. Aussi bien la nature ne se pense-t-elle pas, à l’opéra, sans son inverse, sans la convention, la rhétorique, l’implicite représentation codée ou analogique, qui suppléent à la nébuleuse nature, transfigurée par les passions.
La nature sur une scène d’opéra n’a donc pas exactement la même portée qu’au théâtre. Étant en continuité manifeste ef en opposition radicale avec la naturalité artificielle du chant, tellement plus évidente que celle incarnée par Le corps de l’acteur, elle s’y trouve dans une position à la fois centrale et critique, au cœur de tous les débats. La question de la représentation de la nature à l’opéra est plus qu’un point assez épineux de mise en scène. C’est une véritable obsession théorique, qui voue l’opéra à l’irreprésentable. L’opéra nourri des théories classiques s’acharnera sur cet objet scénique, obstinément. De même que l’ordre du monde, cette superbe illusion où nous sommes plongés de par la faiblesse de nos sens et de notre raison, se donne à lire comme un grand livre de signes, de même la scène d’opéra, cette vaste chimère de nature et d’illusion, proposera de la nature une vision codée, grandiose et insistante, que le discours musical parfois nous aidera à décrypter. Couleurs instrumentales, associations des timbre, tonalités, rythmes, mesures, chaque époque aura sa propre codification. Et que l’on admette ou non que la musique ait une force descriptive, qu’elle puisse donner à voir, et cela sans limitation spatiale, ne change pas grand chose, puisque des habitudes, des associations empiriques, se sont constituées au travers de l’opéra, qui par la dramaturgie, associe toujours du sens et du sensible, et que la valeur représentative d’un art reste, somme toute, non pas absolue, mais relative. Seul varie le degré de relativité. Des « coincoins » dans les marécages dans PLATÉE de Rameau, à la brise marine de COSI FAN TUTTE, si impalpable, si immatérielle, y a‑t-il si grande distance d’un point de vue théorique ? Rien n’est moins sûr, puisque cette nature d’opéra reste indissociable du contexte dramatique, et donc potentiellement scénique, dans lequel elle a été conçue. Présente-absente, idéalisée par la musique, la nature à l’opéra devient la figure même de l’impossible. Mais d’un impossible que l’on ne cesse de vouloir saisir.
Certes la nature, la vraie, est bannie de l’opéra, surtout depuis que s’est répandu, pour sa valeur symbolique autant que pour ses qualités acoustiques, le modèle clos de la salle à l’italienne, fondamentalement urbain. Mais dans le même temps, ce théâtre à la fois propice à la musique et fermé au monde extérieur, ce théâtre du repli et de l’intériorité, étouffant de théâtralité, présente à l’imaginaire une perméabilité secrète à la nature, comme s’il lui fallait une issue dérobée sur le monde.
Ainsi en est-il du San Carlo de Naples, siège de la musique dramatique la plus abstraite et codifiée, véritable symbole de la musique italienne, et dont la construction en 1737 frappe les contemporains par son luxe, ses proportions, ses effets de lumière et de reflets. Le Président de Brosses, qui dans son voyage en Italie, le découvre peu de temps après l’inauguration, en fait une description détaillée. Et subitement, dans la relation du narrateur français, l’immense confinement de cet espace, où scène et salle se regardent en jouant des multiples techniques de l’illusion, fait place à l’ouverture possible, presque fantasmée, sur la profondeur infinie et le plein air. Le théâtre n’est plus séparé du monde par un mur, mais par une simple cloison :
«Soyez bien certain », écrit-il, « que le théâtre proprement dit de la salle de Naples est plus grand que toute la salle de l’opéra de Paris, et large à proportion ; et voilà ce qu’il faut pour déployer des décorations ; encore m’’a‑t-on dit que le fond du théâtre n’était fermé que par une simple cloison qui donne sur les jardins du palais ; et dans les cas où l’on veut donner des fêtes de très grand appareil, on enlève cette cloison et l’on prolonge la décoration tout le long des jardins. Jugez quel effet de perspective cela doit faire ; c’est en cet article que les peintres italiens excellent aujourd’hui autant que jamais ; et je ne puis me lasser d’admirer le goût exquis et la variété avec laquelle ils en font usage pour le théâtre ; du reste, la peinture est entièrement déchue. »1
La nature ne peut entrer directement à l’opéra, si différent en cela de la tragédie grecque, qui pourtant lui a servi de modèle originel. Mais néanmoins, elle lui est nécessaire, vitale. Il faut donc la placer au plus près du théâtre, au moins symboliquement. Aussi, comme s’il était nécessaire de poser dès Le départ les bornes du genre, de très nombreux opéras des XVIIÈ et XVIIIè siècles vont jusqu’à placer en tête de l’œuvre des prologues peuplés d’allégories de la nature (sous la forme des saisons, des fleuves, des dieux et déesses de l’antiquité…) et développent de nombreuses allusions au climat, à la floraison, aux moissons.… Ainsi le prologue d’ATYS met en scène « le Temps », « les Heures du jour et de la nuit », la déesse Flore, « un Zéphir ». Représentée pour la première fois un 10 janvier, l’œuvre de Lully et Quinault ménage entre l’illusion théâtrale et la réalité ces passages obligés qu’autorisent les prologues, véritables sas des opéras :
« La saison des frimas peut-elle nous offrir
Les fleurs que nous voyons paraître
Quel dieu les fait renaître,
Lorsque l’hiver les fait mourir ?
Le froid cruel règne encore ;
Tout est glacé dans les champs :
D’où vient que Flore
Devance le printemps ? »
De même, le prologue d’Alceste place sur le théâtre les nymphes de la Seine, de la Marne, des Tuileries. Quand la première a frémi des horreurs de la guerre, et gémi sur la tristesse de ses bords ( « on ne voit plus de fleurs qui naissent sous nos pas »), quand La Gloire lui a annoncé le retour du héros, la didascalie précise : « les arbres s’ouvrent et font voir les divinités champêtres qui jouent de différents instruments, et les fontaines se changent en naïades, qui chantent ». La nymphe des Tuileries rappelle alors que l’opéra ne serait rien sans l’alliance originelle de la nature, de la musique et du sentiment :
« L’art d’accord avec la nature,
Sert l’amour dans ces lieux charmants :
Ces eaux, qui font rêver par un si doux murmure ;
Ces tapis, où les fleurs forment tant d’ornements ;
Ces gazons, ces lits de verdure,
Tout n’est fait que pour les amants. »
Jardins, ruisseaux, prairies, sources, grottes, nuages, fleuves, montagnes, volcans, mers, océans, nul décor n’est assez grand pour l’opéra, auquel l’abstraction du discours musical a comme donné des ailes, et cela en dépit de l’aspiration scénique opposée, tendue vers le concret. Et tous ces lieux, par eux-mêmes déjà si considérables, se voient investis par le souffle puissant de la nature : tempêtes, éclairs, pluie, neige, éruptions, embrasements, écroulements, témoignent que la nature parfois sort de sa plate routine et ravale au rang de misérables petits événements toutes Les envolées tragiques de l’histoire humaine. Il ne faudrait pas croire que seuls les opéras baroques présentent cette démesure. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler quelques-uns de ces décors naturels, quelle qu’en soit par ailleurs la signification dramatique : la mer du VAISSEAU FANTÔME, de TRISTAN, de PETER GRIMES, BILLY BUDD, et plus indirectement d’OTHELLO, de SAPHO, les tempêtes de PORGY AND BESS, RIGOLETTO, LA WALKYRIE, des TROYENS, la forêt du FREISCHÜTZ, de DON CARLOS, de SIEGFRIED, PELLÉAS, FALSTAFF, le Rhin de la Tétralogie, le Nil d’AïDA, la Volga de KATIA KABANOVA, le désert de la Crau de MIREILLE, la montagne sauvage de CARMEN, le désert américain de MANON LESCAUT, la campagne au clair de lune de WOZZECK… Les exemples surabondent.
Mais la scène d’opéra est-elle pour autant plus sophistiquée, plus disposée à faire sienne cette immensité naturelle ? Non, bien sûr, même si Les innovations techniques majeures de la scénographie ont pratiquement toujours trouvé leur source dans cette disparité, plus criante à l’opéra qu’au théâtre. N’est-il pas significatif que Wagner ait été à La fois l’instigateur de la mise en scène moderne et le promoteur, au théâtre, de la nature originelle
Quiconque, plus que lui, a‑t-il osé mettre sur le théâtre la nature vivante et destructrice, avec ses flots, ses feux, ses chevaux, ses oiseaux, prenant le risque des indications scéniques les plus folles ? Comment imaginer que le créateur d’un théâtre, le théoricien de l’art de la scène, ait pu écrire de telles didascalies, par exemple la toute première de L’OR DU RHIN, ou encore l’avant-dernière du CRÉPUSCULE DES DIEUX :
« Pénombre verdâtre, lumineuse vers le haut, obscure vers le bas. Tout le haut du décor représente un flot ondoyant, coulant inlassablement de droite à gauche. Dans les profondeurs, les flots se transforment en un brouillard humide, de plus en plus léger ; ainsi, tout en bas, jusqu’à hauteur” d’homme, l’eau semble absente de l’espace scénique, celle-ci s’écoulant sur le fond ténébreux comme un cortège de nuages. Des rochers escarpés se dressent un peu partout, émergeant des profondeurs et délimitant l’espace scénique ; le sol entier, hérissé en tous sens de pierres pointues est de ce fait partout inégal ;il laisse supposer des gorges profondes, présentes de tous côtés dans l’épaisse obscurité. L’une des filles du Rhin nage en cercles gracieux autour d’un récif qui occupe le milieu de la scène et dresse sa pointe élancée jusqu’aux flots plus denses, dont les reflets sont plus clairs. »
« Elle est montée sur le cheval et s’apprête à s’élancer avec lui. Elle le fait sauter d’un bond dans le bûcher ardent. Aussitôt de hautes flammes s’élèvent en crépitant. (…) En même temps le Rhin a débordé largement sur ses rives et déversé ses flots sur les lieux de l’incendie. Les trois filles du Rhin, sur les vagues, s’approchent en nageant et apparaissent maintenant là où était le brasier. »2
Certes, il est toujours possible d’expliquer historiquement les contradictions de Wagner. Il n’en reste pas moins que là se trouve l’un des paradoxes les plus saisissants de l’opéra, aussi démuni face à la matérialité scénique qu’ambitieux dans ses aspirations et prodigue d’évocations grandioses. Alors, la nature à l’opéra, image même de l’utopie dévastatrice du genre ? Peut-être, mais de son idéal créateur, assurément.