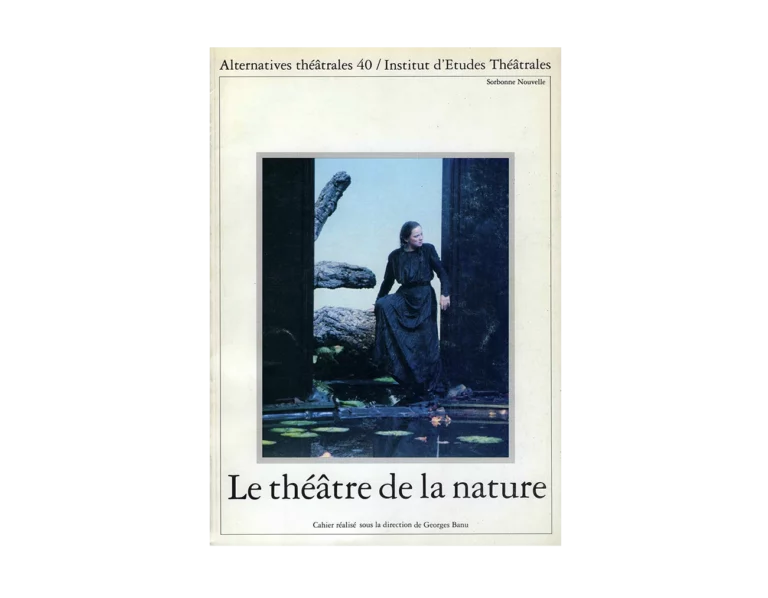IL y a des seuils que la scène ne peut franchir. La montagne la déborde et la neige y fond… limites techniques ! Mais si l’on abandonne le dedans, tout reste possible, voire même plausible. Nombreux sont aujourd’hui les spectacles donnés dans la montagne car si sur un plateau le théâtre ne peut que la re-présenter, rien ne l’empêche de s’y rendre et d’y entraîner des spectateurs captivés par l’expérience du spectacle comme aventure postrousseauiste, comme événement personnel. Si la neige augmente les difficultés d’intégration dans un spectacle — prévisibilité de sa présence, épreuve thermique pour les participants — rien ne l’interdit dans un dehors hivernal. Dedans, en revanche, le théâtre n’a qu’à s’épuiser dans la recherche de ses meilleures transpositions. Si la montagne lance à la scène le pari de sa transfiguration plastique, la neige appelle la transfiguration poétique. Comme dans ces inoubliables vingt minutes du SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ mis en scène par Pétrilka Ionesco où la neige se dresse en congères. ou dans IL CAMPIELLO où les flocons deviennent confetti dé même que dans LA MOUETTE de Pintilié : la neige est signe théâtral du bonheur. Vassiliev lorsqu’il présentait à Berlin des scènes de L’IDIOT éprouvait aussi l’envie de ponctuer la soirée par des chutes de flocons bleus. Flocons en papier. Grüber, au terme de l’AMPHYTRION de Kleist faisait tomber quelques flocons dans les paumes d’Alcmène juste avant qu’elle lance son ultime, célèbre hélas qui ne dure justement que le temps d’un flocon qui fond.
Et le sang alors ? Ce sang dont les tragédies débordent. Il confronte le théâtre à une autre limite, d’une nature différente. Si le rituel fait appel au sang, sang réel, nullement trafiqué, sang animal, le théâtre ne peut l’intégrer tel quel dans la représentation. À moins d’en faire un événement unique, irrépétable, événement étranger à son fonctionnement habituel. Dans sa quête de matériaux vrais qui font irruption sur Le plateau Le théâtre s’arrête au seuil symbolique du sang. C’est pourquoi, ici, tout sang sera à jamais rattaché au faux. Mais les metteurs en scène l’admettent, et la scène éprouve le besoin de sang, le réclame même. Non seulement le sang que les mots évoquent, mais aussi Le sang que l’on voit.
Dans les Shakespeare, Ariane Mnouchkine adopte le mode le plus explicite, emprunté au Kabuki, de figurer le sang : de fin rubans rouges pendent de la bouche des personnages assassinés. On accepte de montrer le sang, mais entièrement intégré dans le code de la convention régnante du spectacle. Ce qui est poétique c’est l’écart. écart exercé sur fond d’envie de ne pas occulter le sang que l’on théâtralise avec jubilation. Mais ne serait-ce pas ce comble du faux, affirmé matériellement, qui pousse Le spectateur à opérer une reconversion mentale ? Sans doute, car, par delà le plaisir, les spirales des rubans se muent dans l’imaginaire du public en vomissements ensanglantés.
D’autres metteurs en scène réfutent pareil exploit au profit d’une expérience matérielle du sang comme fluide qui jaillit abondamment sur le plateau, l’envahit et le salit. Dans L’ORESTIE mise en scène par Peter Stein le sang de Clytemnestre se répand sur le plateau en venant de derrière le mur où l’assassinat fut accompli. À la fin d’‘ELECTRE Antoine Vitez faisait aussi arriver sur la scène le sang de la mère tuée. Le sang de la tragédie. Si selon la logique classique On n’assiste pas à l’exécution de l’acte, la mise en scène moderne se charge de nous faire prendre Concrètement conscience du meurtre : le sang en est la preuve. Et ainsi ce qui tenait de l’expérience Justiciaire mentale s’érige en expérience visible, perceptible, guère médiatisée.
Ici une distinction importante intervient. La distinction entre la matérialité et la vérité. La première fonctionne parce qu’elle pallie le soupçon à l’égard du sang authentique par l’excès quantitatif, excès qui n’est que l’autre versant de l’écart que Mnouchkine développait à l’aide d’une théâtralisation évidente. Aux rubans répondent les litres déversés ! D’un côté le remplacement du concret, de l’autre son exaspération. Mais toujours, irrémédiablement, sur fond de faux car le théâtre, on l’a dit, s’arrête au seuil du sang. C’est pourquoi l’abondance de sang peut conduire à des effets grandguignol ! Sans la caution du vrai le risque de produire des réactions comiques est grand. Comme pour le suicide d’Ajax dans le récent spectacle de Schiaretti.
Dans LE MAHABHARATA, pour le suicide de Drona, le général émérite, Peter Brook adopte une solution ambivalente. Entre Ja convention mnouchkienne et la matérialité steinienne… le héros qui doit mourir renverse sur lui-même une cruche de sang. Ce sang qui rougit la chemise du général et mouille ses cheveux précède l’acte de Ja décapitation ; elle ne sera que simulacre scénique, car le sang a déjà dit la mort. Ici il n’y a guère d’illusion !
Le sang tient de la limite symbolique. Le SpeCtateur saura toujours qu’il s’agit d’une fabrication, d’une dissimulation, d’une stratégie théâtrale. Mais il saura ainsi que le théâtre qui n’est que le double de la vie a tenté d’aller jusqu’au bout. La vérité des matériaux s’arrête là. Tout acteur qui saigne sur scène cesse de jouer pour devenir insupportablement vivant et par là suspendre la représentation. La fiction ne Pourra jamais faire appel au sang : il lui est interdit. On ne saigne pas au théâtre.
«Jamais, de lui-même, Ajax n’a pu s'égarer au point de se ruer sur des troupeaux.Ce mal lui vient des dieux.…