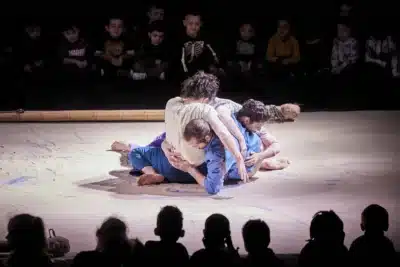« J’ai choisi le point comme étant la matière minimale. Donc le point dans l’espace. Cela rejoint mon travail sur le cirque que je définis comme un espace de point de vue. Une architecture de l’attroupement autour d’un focus. Un focus qui intéresse les hommes de manière commune et qui est capable de créer l’attroupement. »1
Visibles ou cachées, intégrées ou démonstratives, les techniques et nouvelles technologies qui ont investi nos scènes de spectacle ces dernières années rendent compte d’une porosité évidente entre les arts plastiques, la performance et le cirque d’aujourd’hui.
Si la notion de progrès n’est pas pertinente en matière d’art, l’histoire du cirque, comme celle du théâtre ou de la danse, sont toujours liées au progrès techniques et à leurs capacités à renforcer ou non un effet. En les intégrant, les artistes de cirque d’aujourd’hui y associent une inventivité à toute épreuve dans la proposition de nouveaux agrès de jeu à la fois poétiques et fonctionnels, outils performatifs à même de repousser les limites d’une figure connue du public.
Pour exemple, les capacités de régler, au plus près des exigences artistiques d’une scène, la vitesse et l’indice de rebondissement d’une balle ont révolutionné les numéros de jonglage. Il en est de même pour les savoureux alliages entre éclairage, son et numéro de trampoline.
Johann Le Guillerm ne dissocie pas son activité d’artiste de cirque de celle de plasticien et ses agrès sont des créations à même d’être exposées ou expérimentées sur une scène. Les deux univers conçus dans une dialectique toujours dynamique où lieu d’exposition et plateau se font écho.
Ses spectacles Secret 1 et Secret 2 ont donné naissance à des objets actifs aux potentialités vives, prototypes sans conséquences immédiates, si ce n’est l’extraordinaire effet insolite et poétique qu’ils exercent sur le spectateur. Malléables et maniés à vue sur le plateau, leur beauté est aussi indissociable du geste effectué pour les transformer. Ils suscitent de nouvelles possibilités de jeu, alliance entre le corps et la matière qui s’unissent ou s’affrontent, évoluent in situ, se lancent des défis plastiques comme ces longues tiges métalliques qu’il modifie à vue pour leur donner une forme hélicoïdale, forme que l’on retrouve, en plus petit, lors du spectacle- conférence Le pas grand-chose, à travers des tortellini étalés sur le bureau de travail.
Ce sont aussi des défis architecturaux comme l’échafaudage de planche de bois qu’il construit comme un tour de force dans Secret 1. Figures circulaires, toile d’araignée en tour de Babel perméable à tous les points de vue, chevauchement de planches qu’il attache et gravit aux limites de l’équilibre renforçant la tension dramatique avec l’idée d’une chute possible.
C’est aussi ce nuage de poussière, dans Secret, qui par le jeu d’une douche de lumière fascine le regard comme un courant impétueux et immuable. C’est enfin ce bureau qui à la fin du spectacle Le pas grand-chose est transformé en charriot à roues semi-circulaires que l’artiste va faire avancer en le chevauchant et en se déhanchant dessus comme dans un rodéo.
Ces propositions définissent une « esthétique relationnelle » déjà identifiée par Nicolas Bourriaud pour les arts plastique2. Une esthétique qui, en interrogeant les limites insondables du point de vue, ne cesse de solliciter notre activité de spectateur.
Si ces prototypes nous fascinent, c’est que leur fonction plastique suscite toujours une expérience esthétique, une mise en jeu du corps et de l’objet à dompter pour en exhumer des possibilités inattendues. Ici l’expérience est insécable d’une fonction dynamique du corps qui associe son expressivité à celle de l’objet et exalte à nouveau la multiplicité des points de vue.
Voici un cirque où la matière est aussi condensée que la figure, où la performance est bien là mais toujours au profit d’une émotion à laquelle nous ne pouvons pas toujours donner de nom, et c’est tant mieux. C’est la bibliothèque imaginaire qu’il construit dans Secret 1 en figure romane, son corps constituant la clé de voute finale nécessaire à l’équilibre des livres disposés. C’est l’affrontement entre les hommes et les animaux propres au cirque traditionnel qui est remplacé par l’association entre l’homme et des machines aux vertus motrices insoupçonnées. Le fouet que manipule Johann Le Guillerm dans Secret 1 rappelle le cirque traditionnel, sauf, qu’ici, ce sont des objets que l’on dresse, figures protéiformes qui se déplient, mues par une énergie minimale.
Ce que l’artiste tord, plie et déplie sur le plateau constitue une cartographie imaginaire, pensée analogique et sans fin où les objets se mettent parfois en mouvement de façon autonome comme pour nous rappeler que le monde pourrait bien se passer de nous.
Son projet Attraction, engagé en 2001, l’a conduit à aborder la performance, l’installation, la conférence pataphysique dans des spectacles où les objets proposés n’existent pas dans le monde courant. Il s’agit justement d’exposer les mouvements lents des choses, inviter notre regard à s’y arrêter pour regarder un monde du possible. L’un de ces objets, faisant partie d’une catégorie nommée les imperceptibles, le
« tractochiche » est conçu comme un véhicule à moteur apparemment à explosion. Cependant, il avance par des pistons remplis de pois chiches humidifiés à explosion lente. La trajectoire du « tractochiche » une fois définie, il avance tellement lentement qu’il faudrait rester 24 heures devant pour en mesurer l’évolution qui sera comptabilisé au jour le jour.
L’univers de Johann Le Guillerm est fait de ces petits riens qui gagnent en force d’évocation et de puissance sur scène. Machines évolutives qui nous font voyager du point de fuite d’une trajectoire à l’équilibre périlleux d’une banane. Reste le personnage que construit dans ses spectacles Johann Le Guillerm, bateleur de cirque serti de chausson en métal au bout pointu pour Secret, équilibriste, jongleur de sabre, lanceur de hachoir. Personnage qui nous fascine et nous effraie comme un anti-héros qui ne manquerait pas pour autant de vaillance.