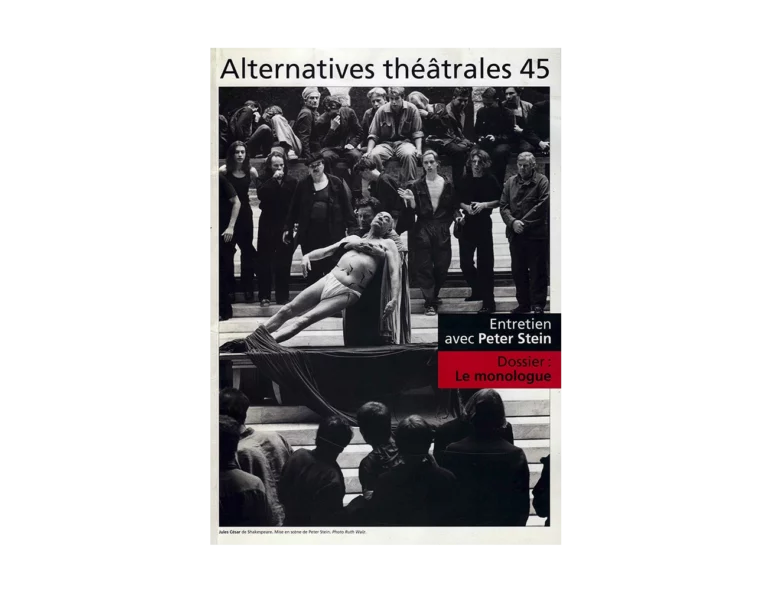Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que Bernard Dort vient de nous quitter. Georges Banu esquisse ici le portrait de ce critique et professeur qui, à partir des années 50, marque profondément la vie théâtrale…
De BRECHT, Bernard aimait surtout Galilée. Se reconnaissait-il une parenté avec la clarté galiléenne et une sympathie pour on inaptitude héroïque ? Sans doute. La mort nous autorise à repérer du biographique là où, par pudeur, nous ne voyions que du savoir. Bernard défendait la pensée et aimait la chair. Cela le rendait intransigeant autant que vulnérable et son humanité, comme chez Galilée, en était le produit mathématique. Il avait imposé non seulement une silhouette avec sa démarche légèrement maladroite, mais aussi des coutumes et des gestes, voire même des rites personnels.
Rites qui nous étaient précieux parce que rites de consommation et jamais rites de conservation. Il ne pratiquait pas la gestion prudente du corps. À force de réfléchir et de jouir, Bernard s’était constitué un personnage, suprême accomplissement pour celui qui fut surtout un « spectateur intéressé ».
Un soir, lorsque je l’accompagnai la première fois au théâtre, Kantor donnait une cape noire à certains spectateurs pour les intégrer dans son spectacle-happening Les mignons et les guenons. Bernard s’y prit les pieds, trébucha et par sa gaucherie créa le petit événement que recherchait Kantor. Il fut aussi Tretiakov, l’ami de Brecht, dans Les apprentis sorciers de Lars Kleberg, à Avignon, où il fumait sans cesse, signe « politique ». Mais il joua surtout le duc dans Asyouli keit et nous le reconnaissions tel qu’en lui même lorsque, sourire aux lèvres, bras ouverts et voix chaude, il s’adressait aux convives et à la salle : « Venez dîner ». Toute sa socialité heureuse dans une parole !
Il a enseigné. Enseignement jamais dogmatique ou rassuré, enseignement libre où ne disparaissaient jamais ni ses lectures, ni ses souvenirs. Bernard savait être personnel, mais jamais envahissant. Toujours là, content de donner et de recevoir car enseigner, il le disait, « c’est aussi dialoguer ». Sa parole n’avait rien de monologal. Pour les remercier du travail accompli ensemble n’a-t-il pas dédié un bel article sur Corneille à ses élèves du Conservatoire ? N’a-t-il pas réuni les essais de certains de ses étudiants de Censier dans un livre ? Et n’a-t-il pas accepté d’enseigner aussi dans cette école pas comme les autres qu’était l’école d’Antoine Vitez à Ivry ? Il fut professeur à Louvain, à Rome ou Rio, mais sans jamais adopter les tics de la profession. Enseigner c’était pour lui un appel à l’échange et une invitation à penser concrètement le théâtre.
En Afrique, un beau proverbe dit que « lorsqu’un vieillard meurt c’est une bibliothèque qui brûle ». Pour le théâtre, si proche de !‘oralité africaine, la mort de Bernard prend le sens d’un même désastre. Ses écrits ne pourront jamais nous consoler de ses récits où bonheurs de la scène et surprises du voyage se confondaient, comme lors de cette traversée de l’Allemagne dans les années 50 où, parti à la recherche d’un spectacle, il se réveilla un matin clair dans une gare dont le panneau indiquait Dachau. Avec la mort de Bernard part en fumée — et vu sa passion « brechtienne » pour les cigares, l’expression convient — tout un pan de l’histoire vécue du théâtre : l’exaspération de Grassi avant les retards de la première de Galilée et le souci maniaque de Strehler pour un éclairage, les nuits berlinoises et les aventures vénitiennes, les combats du théâtre toujours indissociables des joies de vivre. Au lieu d’attendre qu’il écrivît son Journal, pourquoi personne n’eut-il l’idée de le lui faire « dire » ? Bernard était un conteur.
Au théâtre, art de la présence, acteurs et spectateurs vieillissent ensemble. Lui appartenir se paye à ce prix. Et Bernard, malgré des promesses réitérées à chaque début de saison, ne parvenait jamaisà espacer ses sorties, à économiser son temps, à maîtriser ses déplacements. Il dépensa sans précaution ses énergies. Même si parfois il sommeillait un peu, mais le sommeil n’est-il pas aussi un plaisir que l’on ne doit pas se refuser ? « Le pire spectacle c’est celui qui empêche de dormir », avons-nous conclu un jour après une terrible expérience partagée. Oui, Bernard, quarante ans durant, a répondu présent. Ici ou ailleurs. N’a-t-il pas circulé inlassablement dans le triangle de la mise en scène que forment l’Allemagne, la France et l’Italie ? Il fut un grand spectateur européen.
Il a eu des aveuglements et des illuminations car, pour découvrir Brecht, il faut peut-être rater Beckett, de même qu’avoir la révélation de Strehler s’accompagne du silence sur Brook ou des réserves sur Wilson. Plus tard, tout en modulant et corrigeant ses choix, Bernard n’a jamais renié ses premières amours. Il n’a pas abandonné sa jeunesse sur l’autel des anciennes valeurs sacrifiées. Ne disait-il pas dans un cours « je resterai pour toujours sartrien » et ne répondait-il pas à un metteur en scène agressif au début des années 80 « Brecht, j’aime bien ça » ? Il ne nous apparaissait alors ni comme un crucifié, ni comme un Judas, ni agressivement obstiné, ni déserteur. Bernard a épousé le cours du temps sans procéder à ces autodafés spectaculaires auxquels nous assistâmes la décennie passée. Il ne s’est pas senti coupable et il n’a pas réclamé de pardon. Au troisième chant du coq, il n’a pas trahi… Dans sa dernière intervention universitaire, pour présenter un livre symptomatique, Brecht, après la chute, il fut plus loquace qu’à l’accoutumée pour assumer le passé et se réjouir du retour… Bernard a représenté pour nous une instance morale, mais sans rien de despotique. Il n’a jamais posé en ascète ni agi en procureur. Il y avait toujours chez lui un zeste galiléen.
Dialecticien, socratique ou brechtien, peu importe, Bernard s’est placé au cœur des contraires. Cette indécision toujours irrésolue, mais ayant l’amour du théâtre comme principale pulsion, explique sans doute l’ouverture de son approche qui n’est pas unique, comme certains l’ont laissé croire, mais prismatique. Ainsi il a également cultivé Brecht et adoré l’opéra italien, admiré Antoine, le naturaliste, et défendu la filiation de la théâtralité — Marivaux, Pirandello, Genet — qu’il fut le premier à désigner. Un dénominateur commun peut être pourtant décelé : son goût pour la construction car, répétait-il, « le théâtre ne va pas de soi ». Le monde non plus… Une élaboration intellectuelle lui a semblé toujours indispensable ; il exécrait l’organique qu’il assimilait à une duperie et cherchait cette première vérité brechtienne qui consiste à reconnaître le théâtre dans son travail de production. Bernard a sans cesse interrogé et contesté le théâtre tout en y plongeant. Un jour, après Iphigénie Hôtel de Vinaver dans la mise en scène de·Vitez, il m’avoua : « Cela vous réconcilie avec le théâtre. Et pour moi ce n’est pas chose facile ». De ce conflit-là, il en sortit vainqueur.
La pensée théâtrale de Bernard se forma sous l’impact des spectacles et des prestations charismatiques : la découverte de Vilar, le choc de Brecht et la séduction de Strehler. Des spectacles exemplaires ont engendré la parole de Bernard, parole affirmative qui s’épanouissait lorsqu’elle pouvait témoigner, plus tard, de ce bonheur des origines retrouvé chez Mnouchkine ou Dario Fo, chez Grüber ou Langhoff… toujours au sein du même triangle de la mise en scène.
Bernard n’a pas soutenu une cohérence critique, mais a cherché à délimiter un champ traversé par les forces de l’histoire et agité par les courants individuels. Il y a une géographie dortienne. Elle n’a rien de paisible.
Bernard ne s’est pas refusé, les plaisirs de l’amateur, interdits par une spécialisation tant cultivée aujourd’hui. Cela lui permettait de commenter avec aisance l’art d’un chef peu connu ou de témoigner des performances des chanteurs hors-pair qu’il avait entendus depuis les années 50. Il déambulait dans le territoire des arts du corps afin de ne pas rater le Woyzeck de Chéreau au Châtelet ou de goûter le dernier Wenders. Mais s’il ne passait pas les soirées chez lui, c’était aussi parce qu’il aimait se retrouver parmi les autres. Sa passion du théâtre n’est pas étrangère à son affection pour l’assemblée sociale dont l’agitation l’enivrait. N’a-t-il pas défendu l’entracte au nom du cigare et de la conversation ? Ne prolongeait-il pas les premières tard dans la nuit pour mieux profiter de l’interstice entre le théâtre et la vie quand son discours critique devenait plus fin que jamais car ni intimidé ni précautionneux ? Bernard adorait la liberté désinvolte des passages qui, sur fond d’excitation de groupe, lui permettaient de briller et d’être bref. Vertus cardinales.
Si Bernard a aimé voir et raconter le théâtre, il n’a pas cessé non plus de nous inviter à le comprendre en écrivant. « Un spectacle, on ne le saisit jamais mieux que lorsqu’on écrit sur lui ». Par delà ses textes, véritableschapitres d’un panorama théâtral européen, les notes dont il noircissait des cahiers entiers ne cherchaient pas tant à combler les défaillances virtuelles de la mémoire qu’à approcher les enjeux secrets de la scène au travail. Ces radiographies se trouvent aujourd’hui dans les tiroirs de son bureau qui ne doivent pas rester trop longtemps fermés. Qu’on les ouvre, au plus vite !
Le nom de Bernard est inséparable des revues, auxquelles il voua sa passion, et des luttes autour du « théâtre populaire » et du « théâtre public », des « teatri stabili » et du « travail théâtral ». Mais il publia ensuite Le théâtre en jeu et ensuite La représentation émancipée car son itinéraire l’a conduit progressivement de la vocation pédagogique à la dimension ludique et de l’exemplarité de certains modèles à l’accord avec une pluralité de pratiques. N’a-t-il pas érigé Sur la grand-route de Tchekhov dans la mise en scène de Grüber en spectacle emblématique des années 80 et ne l’ai-je pas entendu faire l’éloge de ce spectacle aux antipodes qui lui tenait à cœur ces mois-ci : Les trois sœurs de Langhoff. Il le vit deux fois. Et, comme s’il devait achever son parcours sous le signe de Tchekhov, sa dernière sortie fut pour La Cerisaie. L’œuvre de la fin pour sa propre fin.
Lorsqu’un jour, Antoine Vitez m’invita à déjeuner dans une pizzeria au coin de la rue des Boulangers où Bernard habitait au 34, il me dit en riant : « Nous sommes ici sur la Dortstrasse ». Combien de fois ne suis-je pas passé là ?
Ils partent, les amis.