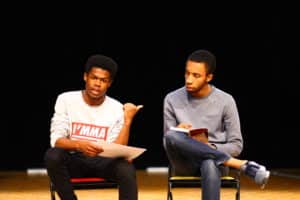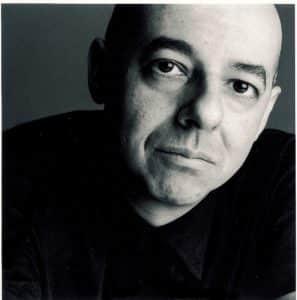Dans l’espace confiné d’une cuisine, trois femmes font le récit de leurs vies. Mahraz est veuve de guerre d’un héros national, Shola, la maîtresse (jugée indigne) d’un footballeur connu. Leyla, pourtant élevée dans la tradition, s’est affranchie en découvrant l’alpinisme. En s’intéressant aux parcours intimes de ces trois femmes iraniennes — qui ont vraiment existé — l’auteure Mahin SADRI et la metteuse en scène Afsaneh MÂHIAN balaient environ trente ans d’Histoire persane (1981 – 2013). Quoiqu’absents du plateau, les hommes, dont ces femmes parlent tant, semblent omniprésents.
S. M.-L. : Dans Chaque jour un peu plus, vous faites le portrait de trois femmes qui vivent des expériences très variées à des époques différentes. Qu’est-ce qui vous a donné envie de les rapprocher, et de les faire dialoguer ?
M. S. : La vie des « vraies » gens me passionne. Je peux m’asseoir pendant des heures à les écouter parler. Un jour, avec une de mes amies, j’ai vu un documentaire sur la vie d’un de mes personnages, qui, dans la vraie vie, était tombée amoureuse d’un footballeur quand elle avait 14 ans. Quelques années plus tard, elle a été soupçonnée d’avoir tué la femme du footballeur. On la voyait au tribunal, accusée de meurtre et parlant avec beaucoup de naturel des détails de la vie de tous les jours… On pouvait sentir la force qui l’habitait, son enthousiasme et sa soif de vie. Je me suis ensuite documentée sur elle, et son personnage m’a semblé de plus en plus intéressant. Plus tard, et tout à fait par hasard, j’ai vu un autre film sur l’histoire d’une alpiniste, qui m’a également intriguée. Il m’a semblé que ces deux histoires vraies, jointes à celle d’une troisième femme, qui fut la veuve d’un martyr de guerre, pourraient bien dialoguer. Ces trois parcours de vie couvrent une trentaine d’années d’Histoire de notre pays. J’ai, par ailleurs, beaucoup d’affinités avec ces trois personnes. D’une certaine manière, je porte une partie de chacune d’elle en moi. Nous avons vécu des choses semblables au cours de nos jeunesses respectives et je retrouve des points communs avec chacune. L’une était très traditionnelle, l’autre moderne, et la troisième entre les deux, avec un destin plus amer et triste que les précédentes… Mais elles ont toutes en commun d’avoir un homme absent dans leur vie.
S. M.-L. : Votre pièce s’inspire de la vie réelle de ces trois femmes, sans relever du théâtre documentaire. Pouvez-vous expliquer votre processus d’écriture ?
M. S. : À vrai dire, je voulais écrire une pièce de théâtre, et, comme tous les écrivains, j’ai eu très peur de la page blanche. Alors j’ai commencé avec la page noire… Une page pleine d’informations sur les personnages. J’ai tout jeté sur le papier, et, progressivement, je me suis mise à étudier les dates et les événements importants dans l’existence de chacune, puis à en effacer une partie et à en inventer d’autres. Mon travail de création relève de plusieurs méthodes : monter un film, faire de la poésie, faire une sorte de psychanalyse, résoudre un problème mathématique… D’après ce que je sais, le théâtre-documentaire a souvent des visées politiques ou économiques, est très nourri de nombreux détails et chiffres précis. Ma pièce n’est pas documentaire parce qu’on parle de quelque chose de très personnel et qu’il est impossible de mesurer : l’amour.
Je connaissais donc les grandes lignes de la vie de ces femmes, mais j’ai inventé la manière dont ça s’est passé. Deux des personnages étant déjà morts, je n’avais aucune possibilité de vérification. Pour parvenir à écrire sur les moments les plus privés de leurs vies, j’essayais de me mettre à leur place et de m’imaginer dans des situations semblables. Par la suite, j’ai découvert que j’avais souvent eu de bonnes intuitions, par exemple, une des chansons qu’un de mes personnages chante dans la pièce, est la même que celle que chantait la femme dont je me suis inspirée…
S. M.-L. : À ceux qui vous disent que vous avez écrit une pièce sur les femmes, vous répondez : « Mais non, c’est une pièce sur les hommes »… Avez-vous le sentiment d’être une auteure féministe, et plus largement quelle est la place des femmes de théâtre en Iran aujourd’hui ?
M. S. : Oui, les personnages sont des femmes, mais chacune d’entre elles parle de l’homme de sa vie, en s’attachant à toutes sortes de détails, à ce qu’il aimait manger ou faire, à sa manière de s’habiller ou de parler… Elles parlent tout le temps de leur vie et de leur relation, avec trois hommes absents mais plus présents par leur absence que s’ils étaient vraiment là. Je ne pense pas qu’un artiste ait la responsabilité ou l’obligation de développer une idéologie. Je pense que l’art se forme dans un endroit où la conscience n’est probablement pas si présente. Je ne me considère pas comme une auteure féministe. J’ai des sensibilités comme n’importe qui dans la vie, et le droit des femmes en fait partie. Leurs droits ont été tellement malmenés pendant des siècles… Aujourd’hui, on peut dire que les femmes qui sont actives dans le théâtre iranien, le sont plus que les hommes. À Téhéran, 80% des galeries sont dirigées par des femmes, la directrice de la plus grande société publicitaire est une femme. Les meilleurs restaurants et cafés sont dirigés par des femmes. Il y a plus d’étudiantes que d’étudiants. On a des cinéastes femmes très connues, y compris parmi celles qui ont immigré à l’étranger. La personne qui a dessiné un pont sur l’autoroute — le symbole de Téhéran- est une fille de vingt-sept ans… L’avenir en Iran est entre les mains des femmes et c’est un fait contre lequel on ne peut pas lutter. Où qu’on aille, il est impossible de ne pas les voir ou de ne pas en tenir compte.
S. M.-L. : Le titre de votre pièce en persan (Ham-Havayi) signifie « Acclimatation ». Pourquoi a‑t-il glissé vers « Chaque jour un peu plus » ?
M. S. : Ham-Havayi, est un terme très poétique qui contient l’idée de l’adaptation mais il était difficile de trouver un équivalent en français : « Chaque jour un peu plus » communique mieux le chemin parcouru par ces femmes. Elles cherchent à s’adapter à ce qui leur arrive, elles cherchent quelque chose de meilleur… et comme l’alpiniste dans la montagne, elles rêvent de s’élever, de franchir des paliers, chaque jour un peu plus.
S. M.-L. : Votre pièce est très référencée. Elle se situe en Iran et commence avec la guerre Iran-Irak (1980 – 1988). Comment pensez-vous que les publics parisiens, belges ou européens vont recevoir ce spectacle ?
M. S. : Il est vrai que dans cette pièce, on parle de la guerre, d’un meurtre et de l’alpinisme… Mais le sujet le plus important, ce n’est pas spécialement le contexte historique ou politique. On parle de peur et de solitude, du manque, du fait d’avoir un enfant ou pas, du vieillissement et de l’humiliation, de la volonté de vengeance. Il s’agit de sentiments humains, qu’on éprouve tous dans nos vies. On parle des relations des humains entre eux, c’est-à-dire de sujets universels.

S. M.-L. : Pour représenter le destin particulier de ces trois femmes qui vivent à des périodes historiques différentes, vous avez choisi de les réunir dans le décor « ordinaire » d’une cuisine. Elles y accomplissent des gestes du quotidien et leurs récits s’enchevêtrent dans une unité de temps et de lieu. Pourquoi avoir choisi cet espace ?
Afsaneh Mahian : Pour parler de la vie de ces femmes, nous avions besoin de symboles susceptibles de représenter la féminité, la vie. La cuisine (comme lieu et activité) était le meilleur symbole que je puisse trouver. Toute femme, quelle que soit sa place dans la société, garde sa féminité. On peut dire la même chose de la cuisine parce que c’est un endroit où tous les détails sont mélangés, avec la féminité et l’amour. Pour nous, la cuisine a été un symbole de la maison, de la famille et de l’amour pour la vie. Le résultat, c’est les repas qu’on va manger et partager. Même le choix des repas de chacune de ces femmes est, en quelque sorte, un symbole de leur choix de vie. Chacune a choisi une recette qui lui correspond profondément.
S. M.-L. : Derrière chacune de ces destinées, derrière chacun de ces récits intimes, l’on imagine le poids de l’histoire et de la religion. Sans jamais faire sortir vos trois comédiennes de l’espace clos de la cuisine, vous parvenez à suggérer le contexte extérieur par le son et la lumière, notamment. Pouvez-vous expliquer ce traitement scénographique ?
A. M. : Pour moi, le plus important dans la mise en scène était de trouver le bon équilibre entre les différents éléments scéniques. Au début, j’ai commencé à chercher l’atmosphère en fonction du texte. Je souhaitais que le spectateur se retrouve dans un endroit qui lui était familier, et en même temps lointain, mélanger la réalité et le rêve. C’est pourquoi les symboles ont une place très importante. Il y a la maison, la cuisine et trois femmes en train de faire la cuisine avec des gestes très particuliers et précis. J’aurais pu utiliser des éléments beaucoup plus réalistes mais j’ai préféré le minimalisme et l’usage de symboles. Il en va de même pour le choix de la musique et des sons, de la lumière et des costumes…
S. M.-L. : Ces femmes ont en commun de vivre des destins tragiques. Pourtant, sur scène, vos comédiennes les incarnent avec élégance, force et dignité. Comment avez-vous dirigé les actrices ?
A. M. : Il est vrai que le destin de ces femmes est tragique, mais je n’avais pas envie de montrer ce côté triste et larmoyant sur scène. On raconte la vie de ces femmes de leur adolescence à aujourd’hui, c’est-à-dire qu’on voit en même temps leur espoir dans l’avenir, leur enthousiasme, leur amour, leurs efforts pour une meilleure vie. Il fallait que cette énergie soit palpable ! Les actrices jouent les différents moments de vie de leur personnage, jusqu’à la dernière étape, la mort. Un des enjeux était de faire ressentir ces différentes formes d’énergie à chaque étape. Leur jeu suit ce chemin naturel. Je ne voulais pas que ces personnages s’apitoient sur leur sort, que les actrices portent le fardeau des personnages qu’elles interprètent. Pour cela, il fallait que les actrices comprennent bien les personnages et les rôles, leur classe sociale, leur culture…, qu’elles cherchent à s’inspirer des personnes réelles sans jamais chercher à les imiter. L’attention s’est plus portée sur les ressentis que sur les ressemblances. Pour moi, jouer des monologues comme elles le font, c’est-à-dire sans avoir directement quelqu’un en face d’elle, c’est ce qu’il y a de plus difficile à faire…
S. M.-L. : Comment ce spectacle écrit, mis en scène et interprété par des femmes, est-il perçu par le public (féminin et masculin) aujourd’hui en Iran ?
A. M. : Le fait qu’une pièce soit signée par plusieurs femmes n’étonne pas le public iranien aujourd’hui, car la femme iranienne est très présente dans la société et à tous les échelons. Le fait que plusieurs femmes soient impliquées dans cette pièce peut vous paraître étonnant, mais pour moi, le sujet que l’on traite, c’est beaucoup plus important que la composition de l’équipe. Aujourd’hui, le public en Iran est assez exigeant. Il veut voir des spectacles de qualité dont il se sent proche. Et c’est le cas ici car les spectateurs connaissent bien tous ces personnages qui ont vraiment existé. Ceci dit, certains spectateurs nous ont demandé d’imaginer une suite avec des hommes…
Chaque jour un peu plus IRAN, 2014 (programmé au Théâtre de la Ville à Paris, en novembre 2015 et au Bozar à Bruxelles, en juin 2016) Mise en scène : Afsaneh MÂHIAN Texte original : Mahin SADRI Décor, Lumière et costume: Manouchehr SHOJÂ Musique : Mohammad Rézâ JADIDI Avec : Sétâreh ESKANDARI, Elhâm KORDÂ, Bârân KOSARI Cette pièce a remporté les prix « meilleur texte original » et « meilleures actrices » au Festival de théâtre de Téhéran (Fajr), en janvier 2015. À VOIR Mahin Sadri joue dans Hearing, Festival d’Avignon 2016 et Théâtre de la Bastille, octobre 2016, mise en scène AMIR REZA KOOHESTANI. La place des femmes au théâtre iranien | ARTE Info 23/01/16 : Dispositif minimal, jeux de lumière et utilisation de la vidéo pour évoquer à demi-mot des sujets tabous en Iran : avec sa pièce Hearing, le metteur en scène Amir Reza Koohestani nous livre un aperçu de la scène théâtrale iranienne mais aussi de la condition des femmes dans un pays encore très conservateur. info.arte.tv/fr/hearing-apercu-de-la-scene-theatrale-iranienne