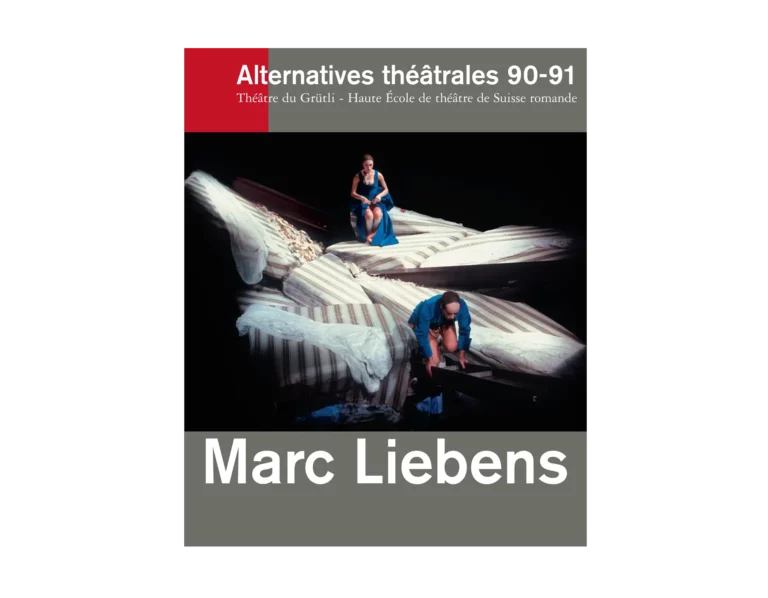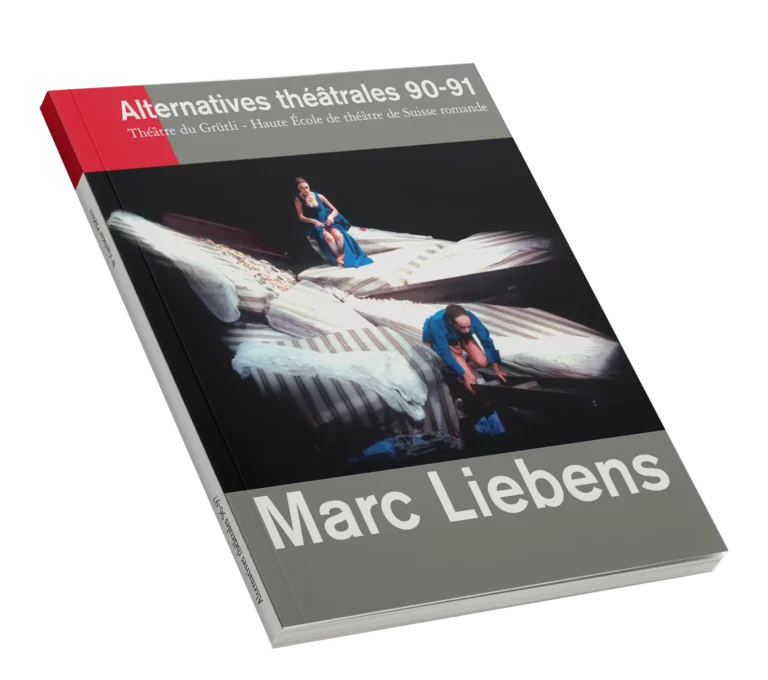Entre seize et dix-sept ans, j’écrivais ma première pièce de théâtre, sans trop savoir ce qu’est une pièce ni même ce qu’est le théâtre. Or, quand mon maître de classe, l’ayant lue, observa : « Mais dis-moi, il y a autant de cadavres que dans Hamlet, c’est une vraie tragédie », ma fierté ne connut plus de bornes. Ainsi donc, j’avais écrit une tragédie. Vous voyez qu’on n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans. Pourtant, je suis encore loin de mon conte, car ce manque de sérieux, il m’a fallu enseigner à l’Université pendant huit ans pour m’apercevoir à quel point il n’était pas l’apanage d’un adolescent spécialement innocent. En réalité, les contre-vérités, la méconnaissance et l’imposture intellectuelle concernant la tragédie y abondent. Pour commencer, j’aimerais donc partager avec vous mon indignation devant cet état de fait. La tâche sera d’autant plus aisée qu’à peine étais-je installé à cette table d’où je vous parle, je remarquai le livre de Steiner, La mort de la tragédie. Jetant un coup d’œil que je voulais distrait à son quatrième de couverture, je me retrouvai aussitôt au cœur du débat : « définir la vision tragique du monde », peut-on y lire. Car George Steiner pose qu’il y a une « vision tragique du monde » et qu’on l’a perdue. Mais qu’il y ait quelque chose comme une vision tragique du monde, il ne vous échappera pas qu’il faille une bonne dose d’anhistoricisme pour le soutenir. L’anachronisme auquel on s’expose en faisant ainsi fi de l’histoire est d’ailleurs la conséquence d’un ethnocentrisme mal dissimulé sous la bannière universalisante de l’humanisme. Or, dans le droit fil de cette méconnaissance arrogante et délibérée au fondement de tout humanisme se situe une conception qui rassemble sous le même vocable de « tragédie » les tragédies antiques, le drame élisabéthain et la tragédie classique à la française. Autrement dit, on réunit sous le concept d’un même genre des pièces comme Œdipe roi, Hamlet ou Phèdre, paresse intellectuelle et facilité de pensée, simplification qu’on ne doit pas s’étonner de voir à l’œuvre auprès de professeurs qui semblent aller à l’école de leurs étudiants, proclamant volontiers : « Surtout, ne te prends pas la tête ». Or, nous vivons avec cette imposture. Les choses vont si loin que pas plus tard qu’hier, on commémorait un événement prétendu tragique, à savoir la tragédie du 11 septembre 2001. Mais comment peut-on seulement parler de tragédie alors que 2 700 personnes sont mortes sans savoir ni pourquoi ni par qui ? On le voit, la langue des journalistes n’hésite plus à emboîter le pas des discours politiques. Aussi voit-on fréquemment aujourd’hui qualifier de tragédie le stade terminal du cancer de tel acteur, la rupture de fiançailles de tel baron, une catastrophe ferroviaire ou le passage d’un ouragan sur une ville. Mais de tout cela, je n’affecte ici de me plaindre qu’afin de mieux m’en gausser. Car ce processus d’érosion du sens, rien ne saurait l’arrêter, si tant est qu’il est inhérent au verbe. Je veux dire qu’il commence avec l’origine. La tragédie, il faut bien comprendre sa mort comme quelque chose de toujours déjà là. Au point qu’avancer sans précautions qu’Eschyle et Euripide relèvent du même genre peut paraître hasardeux : la tragédie est une forme, comme telle vouée à l’incessant procès de ce qui la transforme. Va-t-on à l’origine du mot, la tragôdia désigne un « chant de satyres ». C’est dire qu’au départ, il y a un rite dionysiaque qui aurait donné lieu à ce qui devient la tragédie. Et dans ce rite, il y a du chant, de la danse et un texte, une narration. De tout cela va naître la tragédie, à travers une première trahison de cette origine, une première mort de la tragédie. Autrement dit, la dimension esthétique naît de trahir le religieux qui l’engendre et la sustente. À partir de là, on produira des textes qui, de l’avis même des contemporains, ne concernent plus guère Dionysos, prenant pour héros Héraclès, Ajax ou Antigone. On s’est ainsi peu à peu déporté d’une origine mystico-religieuse de la tragédie, et ça n’a fait que s’aggraver par la suite. Vous connaissez l’histoire d’Eschyle qui, à l’acteur solitaire dialoguant avec le chœur, en ajoute un second. Quant à Sophocle, on lui devrait le troisième. En somme, la tragédie n’existe vraiment qu’à travers une succession d’innovations et de reniements : son origine même est un déni d’origine. C’est la première chose que je voulais poser.
Maintenant, il n’y a pas que de la religion dont la tragédie aurait eu à s’émanciper. Il y a aussi, déjà, de la littérature. Dans un très beau texte, Jean-Christophe Bailly distingue opportunément l’épopée et la tragédie. Il démontre qu’il importe d’en bien séparer les écritures respectives. Et en effet, George Steiner a beau essayer de nous faire croire que nous pouvons voir dans l’Iliade « les premiers éléments de la tragédie », ça n’a aucun rapport. Ce que Jean-Christophe Bailly suggère d’une manière absolument convaincante, c’est que dans le chant épique, vous avez quelque chose qui est la mise de la mort au service de la vie. C’est-à-dire qu’on subsume le malheur et la souffrance sous une cause honorable et grandiloquente, qui finit toujours par l’emporter. Comprenez en ce sens que les commémorations auxquelles la prétendue tragédie du 11 septembre donne lieu font partie d’un mécanisme foncièrement épique. Tel est l’épos de la grandeur américaine : nous avons été victimes, mais nous nous sommes redressés et nous avons fini par vaincre ; il y a eu Pearl Harbor, mais ensuite Hiroshima. On subsume la mort de tous ces innocents qui n’en peuvent rien mais dans une grande croisade patriotique imposant sa justice et son ordre aux méchants. Il ne s’agit évidemment pas d’une conscience tragique, qui au contraire prend la mesure d’une perte que rien ne peut compenser, d’un mal enduré que rien ne vient racheter. Dès le départ en revanche, avec Les Perses d’Eschyle nommément, c’est-à-dire une des plus anciennes tragédies, nous avons quelque chose de proprement inimaginable pour une conscience patriotique épique. Vous me suivrez sans peine si j’avance que l’administration Bush ne saurait même envisager la production d’un drame consacré à la défaite de l’Islam vaincu par l’Amérique, a fortiori diffusé à une heure de grande écoute sur les chaînes de télévision nationales. Ce dont témoignent au contraire les réalisations artistiques majoritaires qui ont les faveurs du grand public américain, c’est le devenir épique d’une nation qui ne cesse de chanter ses triomphes et sa gloire en face de l’adversité. Or, la grande différence entre l’épique et le tragique, c’est que la tragédie n’essaie pas de subsumer la mort des victimes dans un chant de vie triomphant, mais au contraire ramène la grande cause irrésistible de la vie à la mort et à la catastrophe. Je dis catastrophe, parce qu’Œdipe par exemple ne meurt pas à proprement parler, mais la fin d’Œdipe roi — le héros qui se crève les yeux et part en exil — c’est quand même une mort, sociale à tout le moins. Ainsi, la tragédie réhabilite la mort comme quelque chose d’indépassable, c’est du moins ce que j’entends dans le texte de Jean-Christophe Bailly. Alors, quand je lis sous la plume de Steiner qu’il s’agit dans la tragédie de « représenter les angoisses d’une conscience privée en public », je suis évidemment troublé. Qui a jamais vu une conscience privée chez un auteur tragique grec ? George Steiner a l’air de croire — et c’est précisément ce qu’on appelle un anachronisme — qu’il y a une conscience privée qui serait une donnée universelle incontournable, s’exprimant à travers les monologues d’un Hamlet ou d’une Phèdre, et qu’il suffit de la projeter rétroactivement sur les héros grecs. Mais il n’y a rien de tel. La tragédie, c’est avant tout un dispositif scénique où le chœur est partie prenante. Or, si je fais si grand cas du texte de Bailly, c’est qu’il y souligne que ce chœur tragique, le théâtre qui va lui succéder va s’empresser de l’oublier. Et en effet, le drame élisabéthain, par exemple, fera l’économie du chœur. Mais de quoi s’agit-il alors dans ce grand refoulé de l’histoire théâtrale qu’est le chœur, lequel semble effectuer un retour en force sur les scènes contemporaines ? Bailly relève une espèce de coïncidence ou de simultanéité de l’apparition du chœur sur la scène tragique avec l’apparition de la démocratie. Il met en rapport « l’invention de l’espace démocratique » avec « l’invention de l’espace tragique » comme « problématisation » d’enjeux désormais voués à un « débat civique ». C’est une hypothèse d’autant plus attrayante qu’on sait qu’Eschyle a dix-huit ans quand la démocratie fait ses premiers pas à Athènes. Une telle co-occurrence n’est donc probablement pas fortuite. Maintenant, il ne faudrait pas non plus se méprendre à son sujet. Bailly définit l’invention de l’espace démocratique comme celle d’un débat civique. Mais y a‑t-il débat civique à proprement parler dans la tragédie ? Permettez-moi d’en douter, ou à tout le moins de poser la question. Parce qu’après tout, ce chœur, qu’est-ce que c’est ? Les plus avisés d’entre les hellénistes — je parle de Jean-Pierre Vernant, de Marcel Detienne, de Pierre Vidal-Naquet — nous préviennent que le chœur n’est ni ne représente le peuple, au sens du dêmos de la démocratie. Et en effet : je me suis amusé, en préparant cette causerie, à examiner la composition des chœurs de nos trois grands tragiques. On y trouve énormément de femmes ou de jeunes filles, c’est-à-dire des êtres qui n’ont littéralement pas voix au chapitre dans la société grecque, qui en aucun cas ne peuvent participer à quelque débat que ce soit, civique ou non. Il y a aussi des vieillards — certes des hommes — mais pour ainsi dire à la retraite, déjà hors de l’espace de l’action civile, évacués dans la position de témoins. Ensuite, il y a aussi des esclaves ou des prisonniers de guerre, c’est-à-dire encore une fois des gens qui en rien ne participent d’un espace civique, d’un espace de dialogue démocratique. Enfin, il y a même des étrangers, puisque Eschyle nous livre un chœur de Perses dans sa pièce éponyme. Et je vous épargne les chœurs de divinités, comme les Euménides. En bref, le chœur convoque des êtres qui ne participent pas pleinement, c’est le moins qu’on puisse dire, au débat de la cité.
Retranscription d’une intervention donnée en ouverture des Débats logos (Théâtre du Grütli, du 12 au 15 septembre 2006).
Pour la saison logos du Grütli, Bernard Schlurick a mis sur pied un observatoire dramaturgique régulièrement ouvert au public et centré sur la tragédie grecque.