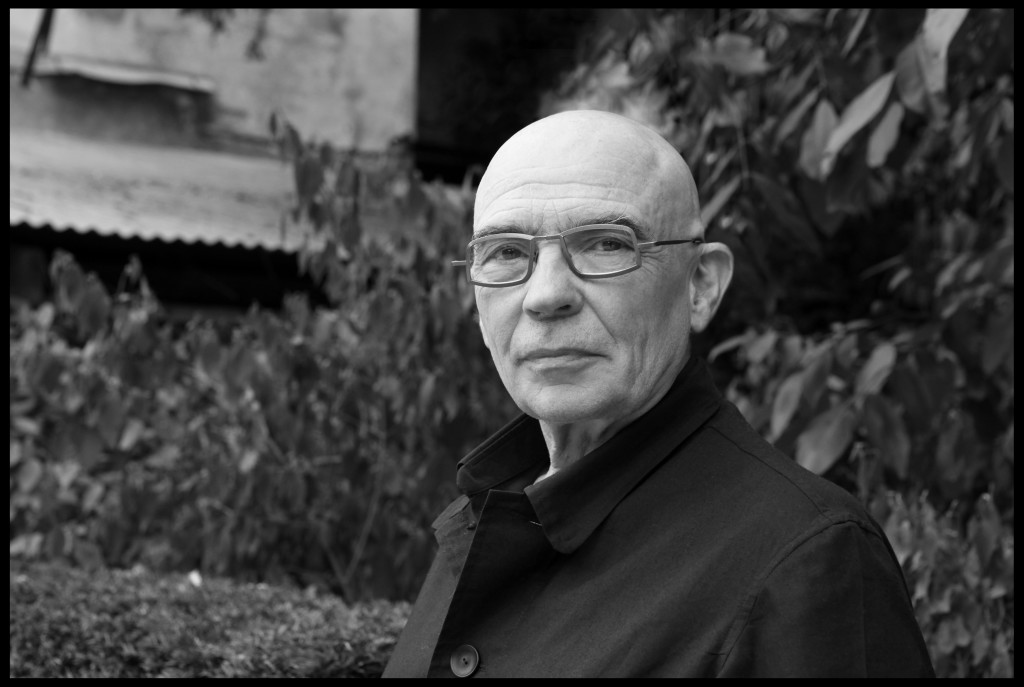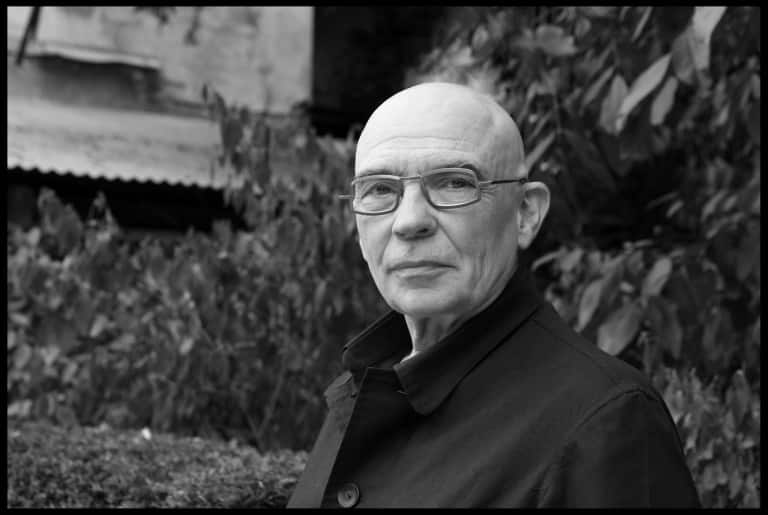Le théâtre de consommation culturelle se satisfait vite de la prestation « Canada dry » qui, selon sa publicité, ressemblait à de l’alcool, mais n’était pas de l’alcool. La consommation culturelle aime le simili : cela ressemble à une démarche artistique, mais ce n’est pas une démarche artistique. C’est un surf habile sur les vagues du goût moyen, un produit attractif sensé satisfaire une attente bien disposée que l’exigence artistique ne taraude pas. Le théâtre de consommation culturelle est un théâtre paresseux. Il est paresseux à la façon de ces élèves doués qui pourraient faire des étincelles, s’ils le voulaient, mais se satisfont d’une note présentable, une note en tout cas qui n’indisposera pas les parents. C’est qu’il y a souvent un immense talent dans le théâtre de consommation culturelle. Le théâtre de consommation culturelle aime les valeurs sûres, le reçu, le canonique, le déjà digéré, les grands noms, les grandes réputations. Des grecs à Shakespeare, de Molière à Tchekhov, de Goldoni à Ibsen : les œuvres de haute qualité ne manquent pas, dieu merci. Deux-mille cinq cent ans de théâtre ont accumulé des joyaux dans les caves de la culture. La qualité des propositions textuelles peut facilement être assurée. Mais le théâtre de consommation culturelle a pour vocation moins d’interroger cette qualité, d’explorer la résonnance de celle-ci dans un monde changé, dans une historicité qui bouge, de la mettre en rapport avec notre moment historique, que de transformer sa puissance de vision en marchandise culturelle. Le public est ainsi assimilé à un ensemble de clients qui aiment les placements artistiques sûrs et ne souhaitent pas acheter un chat dans un sac.
Cet appétit du reconnu peut le cas échéant se compléter d’un recours à quelques grands noms d’acteur ou d’actrice, grands par le talent souvent, mais grands aussi par la surface médiatique qu’ils occupent. Ce duo gagnant (texte canonique + interprétation prestigieuse) a des vertus sociales : il est efficace, de nature à satisfaire l’abonné. Il enchante le directeur d’institution soucieux de sa jauge et il autorise la rédaction de rapports d’activités compréhensibles même par le plus ignare des bailleurs de fond. Certains qui ne sont pas regardant sur le populisme, lui décerneront même un brevet de démocratie : l’essentiel est de toucher le plus grand nombre, n’est-ce pas, et pour ça, comme en politique, tous les moyens sont bons. Le « médiocre réputé » (le « médiocre » qualifiant ici la paresse du travail artistique et le « réputé » le matériau sur lequel s’exerce la paresse), c’est toujours mieux que rien, surtout si personne ne s’en plaint.
La soumission du travail artistique à la consommation culturelle entraîne néanmoins une conséquence fâcheuse : elle pousse le théâtre vers son devenir-opéra. Celui-ci est un genre, on le sait, qui prospère sur un nombre réduit de chefs d’œuvres musicaux que viennent dynamiser des voix d’or et des directions musicales impeccables. Mais de même que l’opéra est un genre mort, dont on ne cesse de farder le cadavre (et les metteurs en scène de théâtre ont parfois donné le meilleur d’eux-mêmes dans cet art mortuaire), le théâtre des œuvres et des noms de prestiges risque d’aller rapidement à l’épuisement. De même que l’opéra est un art de musée qui ne s’affiche pas comme tel, le théâtre-des chefs d’œuvres et des « chefs interprètes » pourrait lui aussi n’être rapidement plus qu’un monument historique. Quelques grands établissements de prestige pourraient avoir pour mission de présenter le monument au public, et le théâtre délaisserait alors sa qualité d’art vivant pour n’être plus qu’un secteur de la gestion du patrimoine.
Le théâtre de consommation culturelle tue la part vivante du théâtre, sa capacité à engager le spectateur dans un trajet où il fait l’expérience de lui-même au travers de ce que la scène lui présente. Le théâtre n’est vivant qu’à la condition de donner au spectateur les éléments textuels et/ou scéniques qui poussent ce spectateur sur le chemin des questions. Le théâtre comme art de la question est un art où chaque spectateur vient tisser l’expérience de la vie qui est la sienne (expérience intime autant que sociale) avec les matériaux que lui propose le plateau (texte et /ou discours scénique). Chaque spectateur qui vient au théâtre y vient avec sa part de vie faite des bons et des mauvais jours, dans une société qui fonctionne plus ou moins bien. Cette part de vie, il l’investit dans ce qu’il voit, entend, sur scène, dans ce qu’il comprend intellectuellement et dans ce qu’il ressent au contact de ce qu’on lui propose. La puissance d’expérience de l’art théâtral (c’est-à-dire sa capacité à provoquer l’expérience chez le destinataire) se dégrade là où la mise en représentation elle même n’est pas un sujet d’expérience pour ceux qui s’y adonnent. Si l’art de la question n’est pas présent à la fabrication, il sera faiblement actif à la réception. Comme spectateur, on ne pense pas à partir d’un matériau qui ne pense pas.
Formaté sur une conception artistique moyenne, l’art théâtral comme consommation culturelle tend à exclure la notion d’expérience de la fabrication. Elle réduit ainsi le champ d’expérience du spectateur. Elle instaure un tourniquet de la paresse artistique, elle engage la fabrication et la réception du spectacle dans une spirale descendante qui assassine à chaque fois la notion d’exigence. La notion d’expérience doit être prise au niveau le plus simple : lorsque je marche dans une forêt inconnue, j’en fais l’expérience. J’enregistre la présence des différents arbres, des animaux éventuels, j’enregistre et j’expérimente les reliefs du terrain, s’il fait chaud, je sue, s’il fait froid, j’ai froid. La traversée de la représentation théâtrale est de cet ordre : elle se donne comme un terrain à arpenter, avec ses zones faciles ou difficiles d’accès, dans lequel mon corps et ma tête mettent à la question ce qui fait ma vie, ce qui fait mon identité, ce qui fait que je suis venu là. Si je n’arpente que les terrains connus et si ces terrains sont d’une platitude infinie, l’art de la question prendra difficilement son envol.
L’art théâtral est vivant à une autre condition encore : qu’il sache garder le contact avec le réel. Une œuvre coupée du réel a peu de chance d’intéresser grand monde. Quand le théâtre ne parle plus qu’aux gens de théâtre (comme l’opéra souvent ne parle plus qu’aux amateurs d’opéra) il entre en phase d’embaumement, il dit son impuissance à être autre chose qu’un art orgueilleusement transformé en camp retranché, il a l’arrogance de la mouche du coche. Et faisant contre fortune bon cœur, il célèbre comme une vertu recherchée la mise à l’écart que la société actuelle lui impose. La demande de contact du théâtre avec le réel n’est pas une façon de lui remettre une fonction prométhéenne sur le dos. Le théâtre ne change pas le monde, seuls les mouvements sociaux peuvent prétendre jouer ce rôle. Mais le théâtre remue le grain fin de la vie, il n’est pas cet édifice qui referme ses portes sur ses participants, ne laissant rien passer qui vienne de l’extérieur. Ce qui se dit, se vit, se sent, se fait à l’extérieur du théâtre appartient de plein droit au théâtre. À charge pour le théâtre d’empoigner ce réel à bras le corps. Mais avec les moyens spécifiques du théâtre, de faire surgir le réel-au-théâtre par un biais qui lui est propre. Si le théâtre qu’on désire ressemble au cinéma, faisons du cinéma. Si le théâtre que l’on désire ressemble au documentaire télévisé, faisons du documentaire télévisé. Si le théâtre que l’on désire ressemble au journalisme d‘actualité, faisons du journalisme d’actualité.
Mais si l‘on veut un réel-au-théâtre, il faut le parler dans la langue du théâtre. Ce réel convoqué sur scène, on ne doit le percevoir ainsi que là, dans une énonciation singulière, faite de convention, d’artifice, de mensonges affichés pour aboutir à des effets de vérité. Mais spécificité n’est pas purisme. Pour parler le réel de façon spécifique, le théâtre peut utiliser les mots, l’image, le son, le document, la lumière, le commentaire, la philosophie, le roman, etc : l’art théâtral est par nature un art impur, puisqu’il confie un texte de papier à un corps en volume, lequel corps évolue entre Cour et Jardin dans un espace convenu, disant qu’il s’appelle Hamlet (par exemple) alors que nous savons tous qu’il ne l’est pas, lui le premier. Seule l’articulation dramaturgique des matériaux hétérogènes donnera une légitimité à l’édifice des langages employés sur une scène.
Le théâtre comme art de la question fait du réel-spécifiquement-exprimé son objectif, parce qu’il met la relation salle/scène, la relation spectacle/public au centre de sa démarche. Ni participant à la messe d’une secte artistique, ni voyeur de la vie des autres, le spectateur est d’abord un interlocuteur. La scène lui parle, et, muettement ou dans l’après coup, le spectateur répond à la scène. Quelque chose s’imprime en lui, immédiatement, mais qui peut aussi surgir à sa conscience bien plus tard. La dimension du débat est fondamentale au théâtre. Elle s’accomplit dans l’acte théâtral lui-même, elle procède de la façon de le concevoir. Le débat théâtral est l’autre nom de l’expérience qui lie salle et scène, débat muet, différé, secret, non quantifiable. Le débat théâtral ainsi précisé n’a évidemment rien à voir avec le débat télévisuel, ni avec les « bords de scène » existants. Le débat au théâtre n’est pas un échange d’opinions, ce n’est pas parole contre (ou avec) parole. C’est corps contre corps. Corps de la langue, corps du jeu, corps de l’écriture scéniques, corps du spectateur. Là où le théâtre n’a plus de puissance d’ébranlement, c’est que les corps tels que définis plus haut, ont fait défaut, et si ces corps-là ont fait défaut, c’est parce qu’ils n’ont pas été constitués en éléments d’expérience pour le spectateur et/ou que la consommation d’un théâtre trop formaté a fait perdre le goût de l’expérience à ce spectateur. Alors, au final, ce théâtre sans corps n’est qu’un acte de communication, autant dire du vent. Et là où l’insignifiance de l’acte théâtral résulte de cette absence de corps, il est délicat de parler encore de théâtre comme service public.