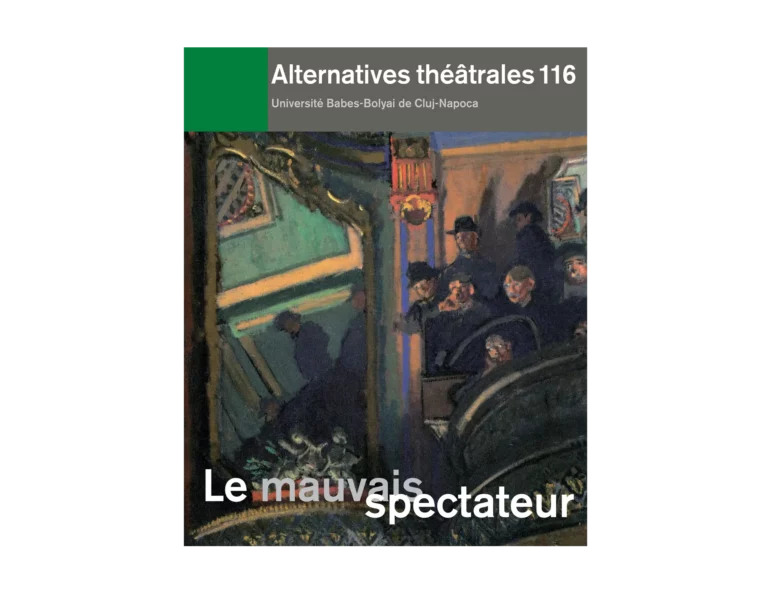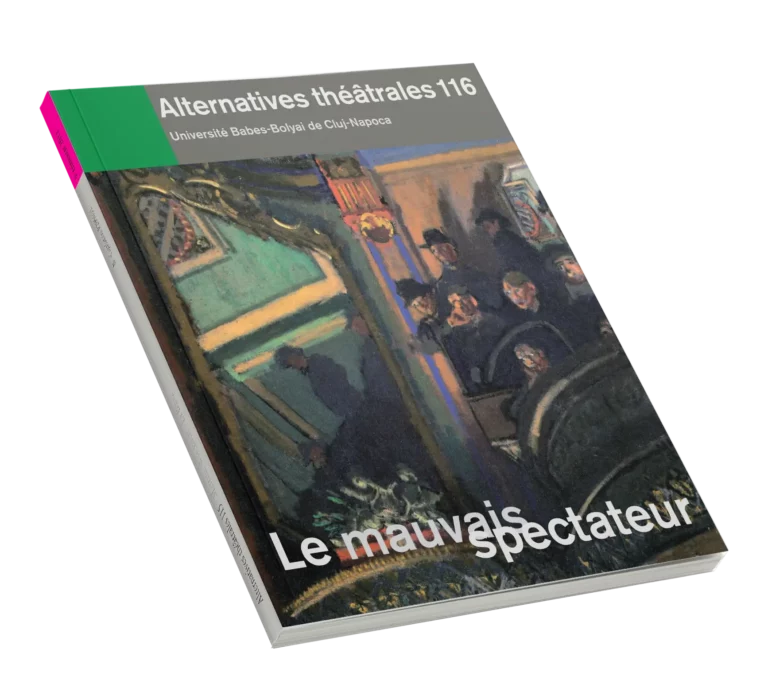« J’AI LU TOUS LES LIVRES » – de cette célèbre phrase de Mallarmé j’ai, progressivement, approché le sens jusqu’à ce qu’il se convertisse en donnée intérieure, en vécu dont j’ai pris la mesure le jour où, las tout autant qu’inquiet, j’ai formulé le même constat : « j’ai vu tous les spectacles ». J’assistais désormais, me disais-je désemparé, à la déclinaison du connu que je reconnaissais, par-delà les apparences d’une modernité à même de tromper l’innocence d’un public jeune. Et cela ne pouvait que me décevoir, me désengager, m’éloigner, d’autant plus que ce « connu » ne revêtait pas, comme en Asie, les habits délibérément anciens du théâtre traditionnel, il se dissimulait derrière les simulacres d’une originalité facile à dénoncer pour le spectateur à long terme que j’avais été. Je ne parvenais pas à l’admettre et ses propositions me semblaient galvaudées, désamorcées de toute charge explosive. Parce que je les reconnaissais, je suivais cette agitation en surface toujours déçu par ce qui échappait aux jeunes spectateurs et me décourageait, moi. Réticent à l’adage du « vieux spectateur » renvoyant à un âge d’or d’outre temps, je ne pouvais pas surmonter cette « lucidité » qui me conduisait au même constat : essentiellement « le nouveau » renvoyait à des moules d’autrefois. « Éternel recommencement » – diagnostic formulé par le bon spectateur que j’avais été en train de devenir son contraire.
Le théâtre, comme d’ailleurs tous les arts, depuis les débuts de la modernité s’est dérobé à l’immobilisme d’un modèle hérité d’un siècle à l’autre et a fait de la transformation son régime de fonctionnement. Mais cette transformation, je le découvre avec surprise, comporte des choix qui reviennent cycliquement et invitent à leur lecture dans une perspective historique. Il y a eu les années 60 où l’on a pratiqué la « mise en pièces » des textes – ce fut même le titre d’un spectacle de Roger Planchon, LA MISE EN PIÈCES DU CID – puis la réhabilitation « intégriste » opérée par des metteurs en scène qui réclamaient le respect de la moindre réplique des pièces jouées – règne des ayatollahs du texte, renversé contesté aujourd’hui lorsqu’on procède, exercice qui fait retour, au traitement du texte comme matériau radicalement « déconstruit»… Le goût pour l’improvisation et la « création collective » qui s’imposa aux alentours de 68 a connu un reflux pour qu’il soit réactivé ces derniers temps. Le naturalisme et l’excès de matière déguisés en « figure du monde » chassent la scène vide pour faire un pas en arrière. La valorisation du théâtre documentaire est d’actualité… D’autres exemples peuvent être convoqués… Le spectateur – témoin du cours agité que le théâtre a emprunté ne peut échapper au scepticisme que procurent tous ces « retours » – de l’éclatement du texte, de l’improvisation, de la scène encombrée, du document ! Il relativise les engouements immédiats au nom d’un passé qui s’est déjà confronté à des questions apparentées et doute d’un prométhéisme récent qui lui semble être de pacotille. Spectateur sceptique !
Parce qu’il « a vu tous les spectacles » et repéré le faux nouveau des mutations actuelles, ce spectateur – mon double ! – ce spectateur devenu « mauvais » – va au théâtre comme étant pourvu de renseignements liés à des options anciennes qui lui permettent, estime-t-il, de ne pas se fourvoyer dans l’engouement pour des aventures de dernière heure. Il a le mérite et, pour moi-même, je le revendique aussi, de ne pas vouloir enfourcher le cheval du « jeune théâtre » comme en Italie où un vieux critique, Giuseppe Bartolucci, était devenu son « pape » à force d’accepter toutes les propositions, de se dérober à toute exigence pour dresser les louanges d’un artiste au nom de sa seule appartenance à une classe d’âge. C’est l’équivalent de cette illusion qui consiste à se faire teindre les cheveux et, par le recours au « jeunisme » vouloir fuir sa biographie grâce à l’intimité avec les créateurs d’une toute autre génération. Il renvoie aux désarrois du protagoniste de MORT À VENISE… Chaque artiste en herbe est un Tadzio potentiel pour le critique qui cherche à nier son passé et se maquille pour dissimuler ses rides. Critique épris non pas tant du « nouveau » mais de la « jeunesse ». C’est à cette défaite-là que jamais je ne me suis résigné.
Le « mauvais spectateur », par quoi se définit-il ? Un jour, lorsqu’un ami insistait pour que je vienne voir son spectacle, je lui ai répondu par une lettre où, le plus sincèrement du monde, je m’employais à motiver mon forfait par le fait que je traversais une période d’épreuves difficiles qui ne me rendait pas disponible au théâtre. « Je ne suis pas “ouvert” ces temps-ci et ton spectacle, j’en suis certain, ne pourra rien faire. Je suis replié, “fermé” sur moi-même. Je suis un mauvais spectateur. » Depuis, je le sais, c’est le fait de vouloir accueillir ou pas le théâtre qui est le critère premier. Il ne s’agit pas pour autant de se dérober à toute évaluation et d’applaudir à la moindre simagrée du plateau – non, il ne s’agit pas d’avoir l’orgasme formaté – mais seulement de s’ouvrir à la scène en tant que sujet chargé de son histoire, marqué par ses déterminismes, respectueux de ses désirs. Et, partant, de jouir ! La clôture, par contre, voilà le symptôme de frigidité du mauvais spectateur. Il s’érige en citadelle à investir où l’on a retiré les pont-levis. Rétif à l’échange, il parie d’emblée sur la défaite du plateau !