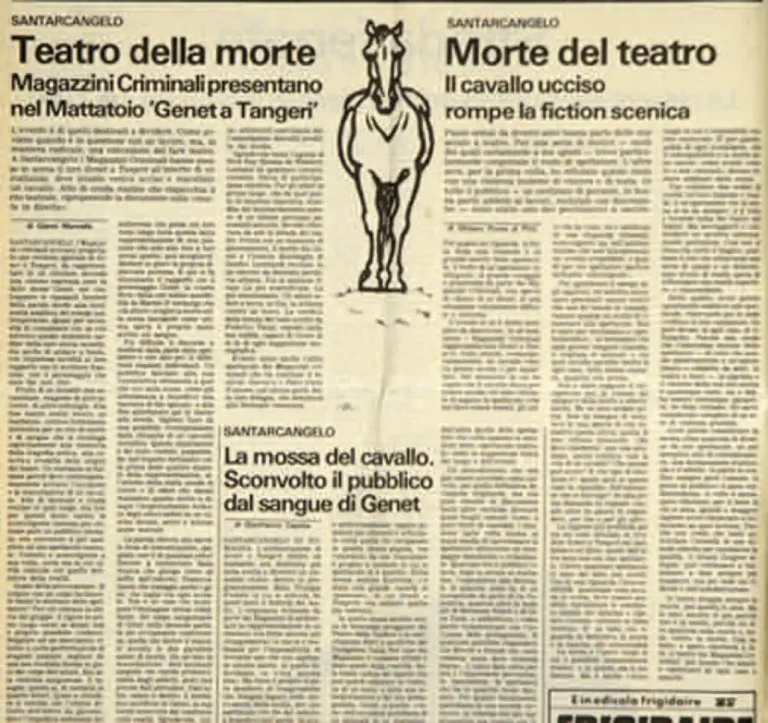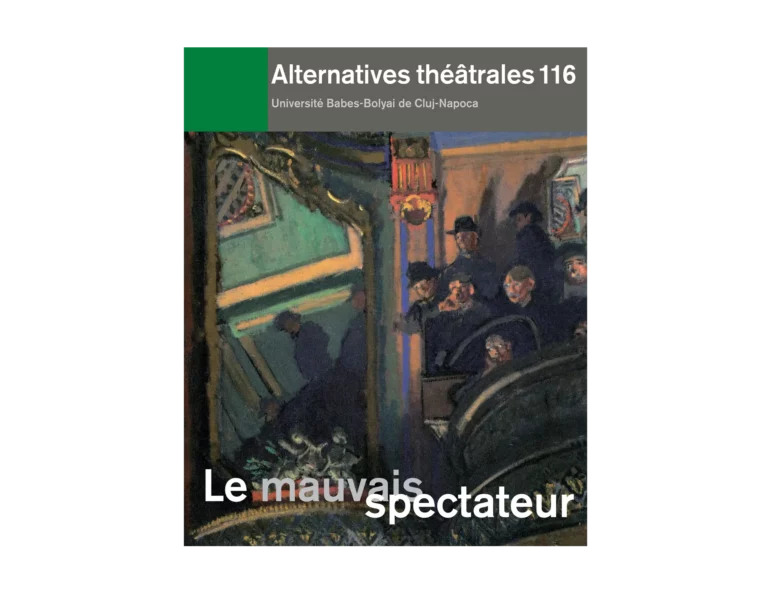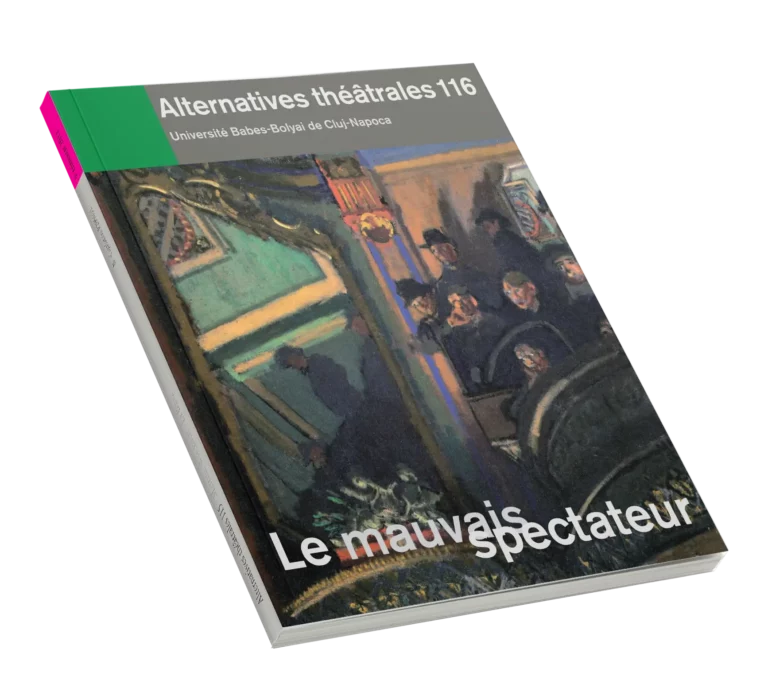IL Y A EU dans le passé des moments où de « mauvais spectateurs » ont vraiment changé l’évolution du théâtre. L’un des cas les plus saisissants où le rejet a été aussi puissant s’est produit en 1985, en Italie, lorsque la compagnie Magazzini Criminalia monté la pièce GENET A TANGERI dans un abattoir pendant le Festival de Santarcangelo di Romagna.
Cette pièce était la première de la trilogie PERDITA DI MEMORIA, qui comprend aussi RITRATTO DELL’ATTORE DA GIOVANE (1985) et VITA IMMAGINARIA DI PAOLO UCCELLO (1985). Sa dramaturgie se situait dans la lignée de l’idée d’un « théâtre poétique », tel qu’envisagé par le directeur de la compagnie, Federico Tiezzi, dès le début des années 80. C’était un théâtre fondé sur « l’équivalent visuel […] du rythme, de la construction et de la “géométrie” de la poésie » (Mango Lorenzo), où tous les éléments étaient juxtaposés, les citations artistiques et le monde réel interféraient, et la narration n’était jamais linéaire, mais plutôt évocatrice.
Le texte de GENET A TANGERI s’inspirait des pratiques d’écriture et des citations de Genet, utilisées pour faire revivre l’auteur, tandis que les autres personnages provenaient du monde et des mythes du metteur en scène et des acteurs. Parmi ces personnages, il y avait Rainer Werner Fassbinder, William Burroughs et Antonin Artaud, qui apparaissaient comme des doubles de Genet. Dans la pièce, ils se rencontraient tous à Tanger, une ville qui, dans le spectacle, finissait par symboliser l’endroit de la mort, dont Genet parlait dans ses textes. La perception de la mort était donc celle qui permettait de saisir le sens contemporain de la tragédie dans la vision de la compagnie, un sens que les artistes s’étaient appliqués à déceler et à explorer dans sa dimension quotidienne.
La première du spectacle avait déjà eu lieu au Teatro di Scandicci, à Florence, et avait suscité une réaction mitigée. Les polémiques n’éclatèrent pourtant qu’à l’été 1985. Dans la version abrégée de GENET A TANGERI de Magazzini Criminali, présentée au Festival de Santarcangelo, un cheval avait été abattu par les bouchers qui travaillaient dans l’abattoir où la pièce était montée. Après les premiers comptes rendus, tous les journaux ont pris position : la nouvelle a pris de l’ampleur et un incroyable scandale a éclaté. Les politiciens se sont eux aussi impliqués dans le débat général, la conséquence étant que la compagnie a perdu et sa salle et ses financements publics. Elle a également changé son nom de Magazzini Criminalien Magazzini afin d’éviter l’association immédiate avec la criminalité.
Cet abattage politique et médiatique est désormais un fait historique qui a été immédiatement repris, notamment par l’historien Ferdinand Taviani. L’automne suivant, ce dernier analysait déjà la polémique qui s’était déclenchée en Italie juste après l’événement. Son essai passionné et profond, les avis exprimés dans la presse écrite, le texte mis en scène par la compagnie ainsi que ses lettres concernant GENET A TANGERI sont les principales sources qui permettent de reconstituer ce qui s’était passé en cet été de 1985 : un événement malheureux que la plupart des gens auraient voulu mettre entre parenthèses et oublier le plus vite possible. Mais ce souvenir flou va de pair avec le sentiment d’une incompréhension profonde de la problématique et de l’interaction sémantique implicite par le public. La complexité que l’événement aurait dû mettre en avant a été occultée une première fois quand le cheval est mort et, une seconde fois, au moment où la polémique a éclaté.
La mort comme simulacre et mystère quotidien
Dans son autobiographie, GLI ANNI FELICI, Sandro Lombardi, cofondateur avec Federico Tiezzi et Marion D’Amburgo de MagazziniCriminali (qui s’appelait au début IlCarrozzone), établit un lien entre ses attentes par rapport à la réaction au spectacle et son expérience personnelle d’exposition, au cours de son enfance à la campagne, à la mort animale. Il suggère en quelque sorte que le spectateur idéal n’était pas, en fin de compte, le spécialiste du théâtre – le destinataire principal en l’occurrence –, mais quelqu’un qui fût plus proche du monde agricole, un monde où l’on est exposé à la mort. En fait, le spectacle de Magazzini Criminali brisait une barrière sociale en rappelant que la mort existait « non seulement comme simulacre, mais aussi comme mystère quotidien ».
L’évaluation a posteriori que fait Lombardi confirme également le point de vue d’un article que la compagnie avait publié à sa défense dans la revue Alfabetaen Septembre 1985. Le groupe y soulignait qu’on n’avait pas compris la relation qu’il avait tenté d’établir entre, d’une part, la présentation d’une routine de la mort et, d’autre part, les massacres, la violence et les morts auxquels les gens sont exposés quotidiennement par les programmes d’informations. La première mort était en fait censée symboliser, renvoyer à cette autre mort, celle qui laisse en général tout le monde indifférent. Ce que les artistes n’ont jamais dit, c’est que cette interprétation douloureuse visait peut-être l’identification de leur propre sacrifice en tant qu’acteurs avec la mort – simultanée – de l’animal : une mort – rappelons-le – qui n’est pas perçue comme une donnée négative dans la vie au jour le jour de la société, mais plutôt comme un service nécessaire.
L’interprétation erronée de l’événement avait été renforcée aussi par un choix d’ordre dramaturgique. Les spectateurs venus du côté de la « vie » allaient se heurter à une frontière, ils allaient arriver devant « une porte au- delà de laquelle ils trouveraient “le langage universel” des morts » (Federico Tiezzi). L’entrée dans la salle des bouchers accentuait l’impression qu’auraient donnée des dispositifs plus théâtraux dans d’autres contextes. L’effet de séparation a été obtenu, mais ce même effet faisait en sorte que le spectateur avait une chance de s’éloigner de ce qu’il avait vu.