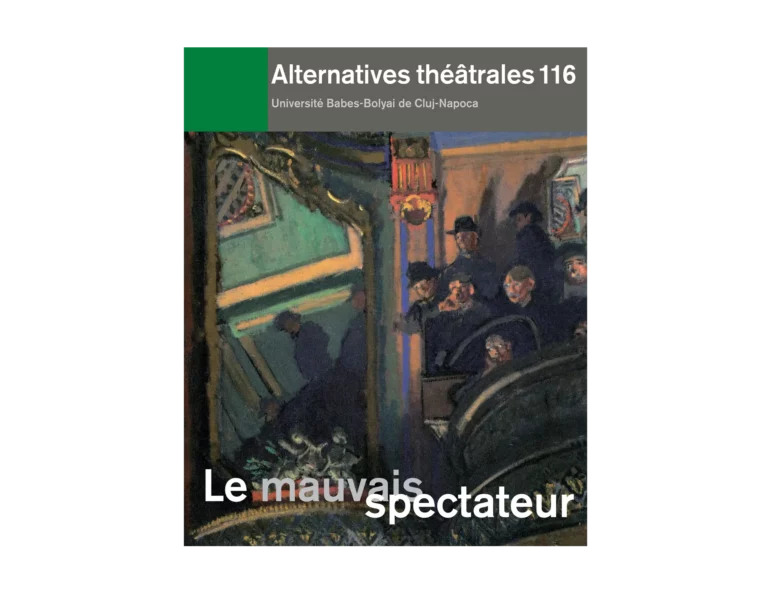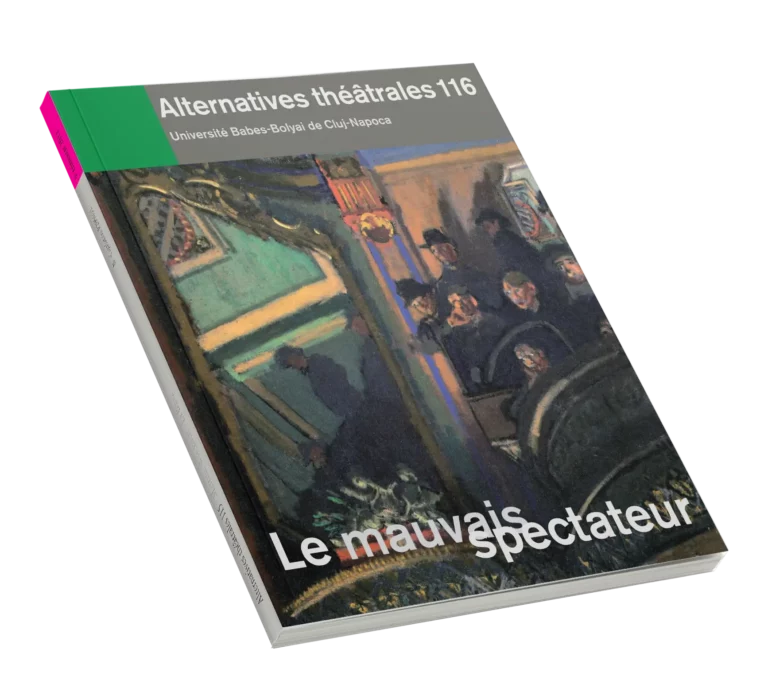JON FOSSE est l’un des créateurs d’un théâtre de la participation, dans l’idée que Hans-Thies Lehmann a exprimée à propos du théâtre post-dramatique, situé à la portée d’un public capable de s’investir lui-même dans le spectacle théâtral. Fosse choisit de représenter dans ses pièces les défis d’une perception faussée chez les figures qu’il fait se confronter sur scène. Faute d’une énergie motrice normale des corps, la tension dramatique est sublimée au niveau de l’œil qui regarde. Ce qu’on voit, c’est une réalité déformée, dérangée, parfois mutilée. On passe son temps à assister à des changements imperceptibles. Souvent, on a affaire à de mauvais spectateurs, à des personnages doués d’une énorme capacité de destruction et reconfiguration maligne de l’image. Nous proposons une analyse des sociétés de témoins et des qualités performatives du regard négatif chez cet auteur, aussi bien que de leur rôle dans la dimension participative du public.
Le théâtre de Jon Fosse est d’abord le lieu de déconstruction du langage tel qu’on l’utilise dans la vie quotidienne. La chute et la reconfiguration des structures spatiales suivent de près ce mouvement. La transparence offerte par l’enlèvement de n’importe quel type de mur imaginé par la pensée classique va doter les habitants de ces espaces frontaliers, que Claude Régy appelle des « espaces perdus », d’une étrange vision sur les autres et sur les événements eux-mêmes. Dans les drames de cet auteur, le regard, intensifié par une massive absence des obstacles de la vue, acquiert des fonctions dramatiques inattendues. Les vieilles maisons délabrées, décors très chers à Fosse, ne nous semblent pas être loin des maisons transparentes de Maurice Maeterlinck. Espaces ouverts aux quatre vents, doués eux-mêmes d’yeux et d’oreilles, ces anciens abris permettent au sens d’observation de s’épanouir. Ce théâtre repose justement sur les fins changements perceptifs qui ouvrent la possibilité de l’échange dramatique là où les corps et l’histoire ont été vidés de force. Tout comme la transparence des espaces, la fatigue immobilisante qui tourmente la majorité des personnages créés par Fosse mène à l’exacerbation de l’état de guet-apens de l’autre et à la mutation des perceptions.
Dans ESSAI SUR LA FATIGUE, Peter Handke parle d’une force maléfique qui possède les fatigués : « Et il arrivait que tous les deux, possédés par le démon-fatigue, devenaient eux-mêmes redoutables. » Les situations dramatiques de Jon Fosse, traversées difficilement par des personnages à bout de force, constituent un préambule du repos. Mais celui-ci ne peut pas être atteint, sa quête devenant hypnotique et maintes fois létale pour ceux qui sont en proie au trouble ou bien pour ceux qui les entourent.
Handke dépistait donc une sorte de guerre menée au nom du repos, dans laquelle le regard de ceux qui étaient épuisés devenait le terrible ennemi de l’altérité. Quand le corps de tels personnages arrive à être vidé de force, le lieu du conflit est transféré au niveau de l’expression des yeux, capable de détruire elle seule tout un monde.
Chez Fosse, les yeux et le visage sont les zones privilégiées de la manifestation de la tension dramatique, des non-lieux où l’on peut suivre le cours des désirs et des catastrophes, la peur et le désespoir, l’obsession et l’oubli. Le conflit traditionnel des actants qui s’affrontent sur scène est remplacé, dans le théâtre de cet auteur, par des silences ou des paroles qui ne disent presque plus rien, par une transformation intériorisée des situations dramatiques, placée au cœur d’une éternelle répétitivité extérieure.