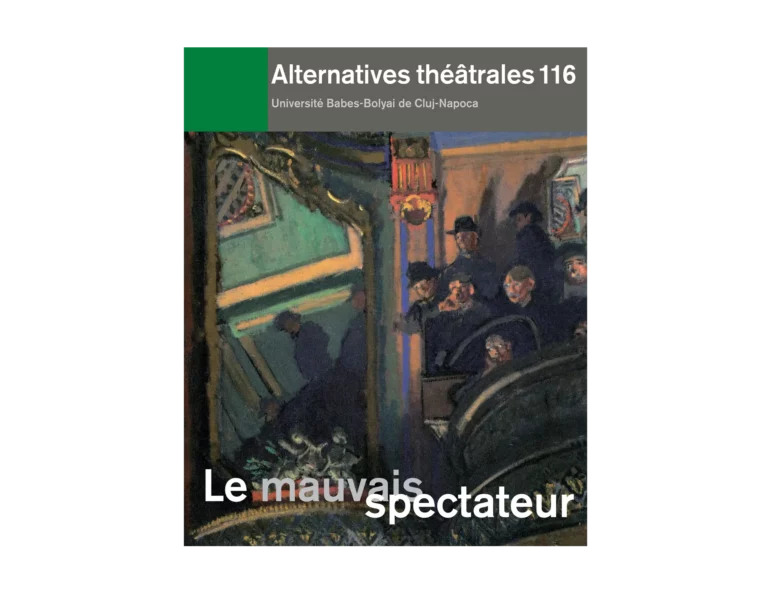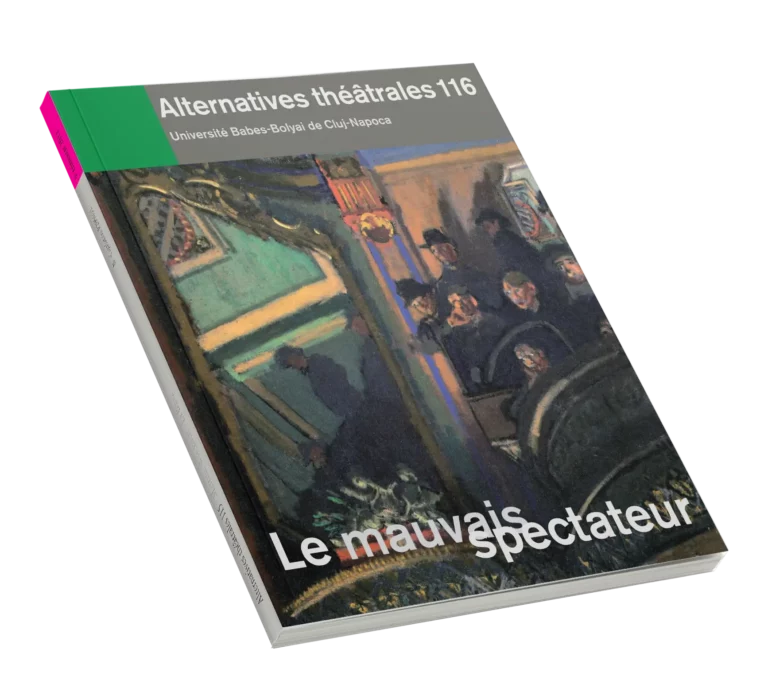LE PROJET POLITIQUE du théâtre populaire, qui émerge en France au tournant des XIXe et XXe siècles, repose, d’une part, sur le rejet du théâtre et du public bourgeois et, d’autre part, sur l’appel à une communauté théâtrale composée de tous les segments de la société. Pour les pionniers du théâtre populaire, seule l’instauration de cette communauté pourra renouveler des formes théâtrales perverties car assujetties au mercantilisme du théâtre bourgeois. Le spectateur est donc l’objet d’une attention particulière : non contaminé par les rites mortifères des scènes traditionnelles, il devient celui par qui la rénovation théâtrale attendue peut advenir. Ainsi, les premières réalisations pratiques de théâtre populaire (celle de Maurice Pottecher avec la création du Théâtre du Peuple à Bussang en 1895 ou celle de Jacques Copeau avec l’installation de la troupe des Copiaus à Pernand-Vergelesses en 1925) consacrent la rencontre d’un nouveau répertoire et d’un nouveau spectateur. Plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, lors de l’institutionnalisation du théâtre public, autour de la décentralisation théâtrale, c’est ce même spectateur, dont la sensibilité, vierge, reste à conquérir et à éduquer, qui sera le symbole de la réussite des premières expériences de démocratisation culturelle.
Pourtant, cette rencontre entre un projet artistique et un public populaire heurte la sensibilité de ses initiateurs. À partir des écrits des pionniers du théâtre populaire, nous nous proposons d’explorer cette contradiction, pour mettre au jour les ambiguïtés du théâtre populaire, entre un spectateur rêvé et un spectateur réel, objet de déception.
Une réalité charnelle rejetée
Le JOURNAL de Romain Rolland, à la fin du XIXe siècle, est constellé de remarques hautaines sur le comportement d’un peuple qu’il ne connaît pas. Ses origines bourgeoises et provinciales, puis sa socialisation parisienne à l’abri de l’École normale supérieure et au contact de la bourgeoisie intellectuelle et cosmopolite, ne l’ont pas préparé à une fréquentation assidue des prolétaires, ouvriers, petits commerçants ou paysans.
Ainsi, en août 1897, deux ans après la création du Théâtre du Peuple de Bussang, Romain Rolland assiste à une représentation du drame de Maurice Pottecher, MORTEVILLE. Sa description de la représentation est un témoignage fondamental pour saisir l’ambiance de ces premières représentations populaires, mais également pour comprendre le positionnement de Rolland vis-à-vis du projet. Rolland juge le public mal élevé, grossier, brutal, insensible, incapable de saisir l’intrigue. Derrière ces constats, se cache une perception différente des conventions théâtrales : le public de Bussang ne respecte pas les conventions auxquelles Rolland est parfaitement habitué, ce qui le gêne et le trouble. Il reconnaît être « blessé de la bassesse d’âme » du public qu’il a côtoyé, qui semble n’apprécier que la « grossièreté » et la « brutalité ». À l’occasion de la représentation de la pièce de Maurice Pottecher, LIBERTÉ, le 24 décembre 1899, à l’université populaire de la Coopération des idées, Rolland apprécie la spontanéité des réactions du public, mais regrette l’absence d’un guide capable de contrôler l’expression peu policée des émotions et des sentiments de celui-ci. Derrière ces contradictions, semble se cacher la posture type de l’intellectuel, qui appelle sur scène et dans la salle la présence du peuple sans l’envisager dans sa réalité sociale.
Une représentation en miroir du peuple comme foule