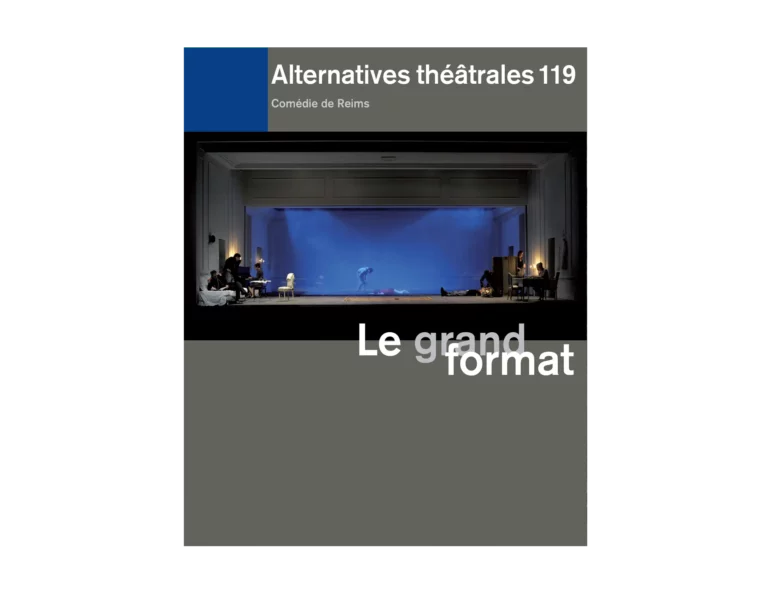Préliminaires sur le spectacle1
DANS LA VIE QUOTIDIENNE, publique ou privée, nous assistons souvent, muets ou inexpressifs, à ce que font les autres, ou bien, au contraire, nous exprimons verbalement notre réaction ou passons à l’action. Le simple regard des autres nous transforme en leurs spectateurs ; la réaction, s’il y en a, reste ici implicite ou dissimulée. D’autres fois, nous retardons notre réaction consciemment, ou bien, de manière plus habile, nous la traduisons, la codifions dans un système « objectif » de signes. Ce n’est qu’à la fin, si nous y parvenons, que nous participons ouvertement à l’événement.
L’idée générale sur laquelle se fondent ces remarques est la dimension spectaculaire de notre existence, le fait que nous faisons partie, que nous le voulions ou non, d’un monde en spectacle, pour des raisons soit individuelles – selon les observations d’Erwin Goffman, par exemple – soit sociales, comme l’ont théorisé Guy Debord et d’autres. Goffman considérait le spectaculaire – de THE PRESENTATION OF SELF IN EVERYDAY LIFE, 1959, à FRAME ANALYSIS, 1979 – comme une sorte de connotation, volontaire parfois, involontaire presque toujours, de notre comportement, soit afin d’attirer/provoquer le regard d’autrui, soit afin de le retenir quand il est déjà fixé sur nous. Presque tous les moralistes ont dénoncé les deux attitudes comme étant de la pure vanité, ou ont analysé et critiqué sa transformation en espionnage visuel dans des sociétés ou milieux mondains, de la cour du roi (Saint-Simon) aux salons modernes (Proust), ou en contrôle social répressif (Foucault), implicite ou systématique. Nombreux ont constaté cette attitude dans l’adéquation de l’individu à un rôle institutionnel (Goffman), ou l’ont définie comme étant un complexe retour de la conscience de soi sur elle-même (Lacan, citant Valéry : « se voyant voir » ou Merleau-Ponty : « nous sommes des êtres regardés, dans le spectacle du monde» ; les deux citations proviennent des QUATRE CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA PSYCHANALYSE). D’autre part, le tournant général dans les sciences humaines d’une analyse de la lisibilité du monde à l’analyse de sa visibilité, a été discuté surtout par W. J. T. Mitchell et Nicolas Mirzoeff. On arrive ainsi à l’(inattendue) actualité de la thèse plus ancienne de Debord selon laquelle une partie de la société moderne s’offre en spectacle à l’autre partie, de telle manière que « Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images » (LA SOCIÉTÉ DU SPECTACLE).
En scène, au-delà de la scène
Que signifie alors « l’ombre de la scène » ? Dire que l’on se trouve dans cette ombre dépend de ce que l’on comprend par « scène » : est-elle la scène d’un théâtre ou bien est-elle, plus généralement, la scène du monde ? Georges Banu, dans l’un de ses peu nombreux ouvrages (encore) non traduits en roumain, MINIATURES THÉORIQUES (Actes Sud, 2009), raconte le faux-pas commis une fois dans un théâtre qui l’a vu se retrouver soudain sur scène, à la surprise des comédiens et des spectateurs habitués à la distinction absolue entre les deux mondes. (« Le pacte de la clôture propre au théâtre avait été brisé », p. 148). Dans un autre théâtre il a donc scrupuleusement respecté une ligne tracée au sol avec une craie qui l’avertissait : « Au-delà de cette ligne vous êtes en scène » (ibid.). Ce sens est clair pour celui qui vient de la salle vers la scène. Mais comment est-elle regardée par celui qui vient de la scène ? « Au-delà de cette ligne… on est où ? » (p. 149) se demande alors Banu. De manière significative, cette phrase clôt l’ouvrage tout comme la ligne en question clôt la scène ; au-delà d’elle ni le texte, ni le théâtre ne se poursuivent. Ou bien quelque chose d’inconnu s’ensuit.
Le comédien, en quittant la scène, entre de nouveau en scène, passe du théâtre au non théâtre. Toutefois, comme d’habitude, les termes négatifs contradictoires ne peuvent pas être aussi spécifiques que les positifs. Si le terme « théâtre » est, tant bien que mal, définissable, son opposé ne l’est pas ; de même, la non scène. Au contraire, comme on l’a vu, la non scène, disons la vie quotidienne, est remplie d’éléments théâtraux, voulus ou involontaires. Si le théâtre, la scène, contiennent beaucoup de « fiction », vivre en dehors d’eux ne veut pas dire vivre par définition aussi en dehors de la fiction, c’est-à-dire dans la réalité. Dans le même ouvrage, Banu rappelle la TEMPÊTE de Shakespeare dans laquelle, au signe de Prospéro, tout ce qui est « monde » autour se fane ( fade) ou se dissout dans l’air (are melted into air, into thin air) étant donné qu’en fait le monde est constitué de la même matière que les rêves. Tout cela a peut-être une sorte de réalité, mais n’est pas la réalité. Bizarrement, sur scène comme en dehors d’elle, la réalité et la non réalité se mêlent : la fissure entre la présence et l’absence d’une institution couvre une suture ontologique, semble dire Banu, en suivant entièrement Shakespeare. Les deux zones, celle d’en deçà comme celle d’au-delà de la frontière imaginaire qui les sépare, expriment la même fluidité de la substance, seulement cachée différemment par leur hétérogénéité respective. Certains éléments des deux zones sont matériels et immatériels, réels et irréels, seule la perspective d’où on les regarde les place dans des catégories (ontologiques) distinctes.