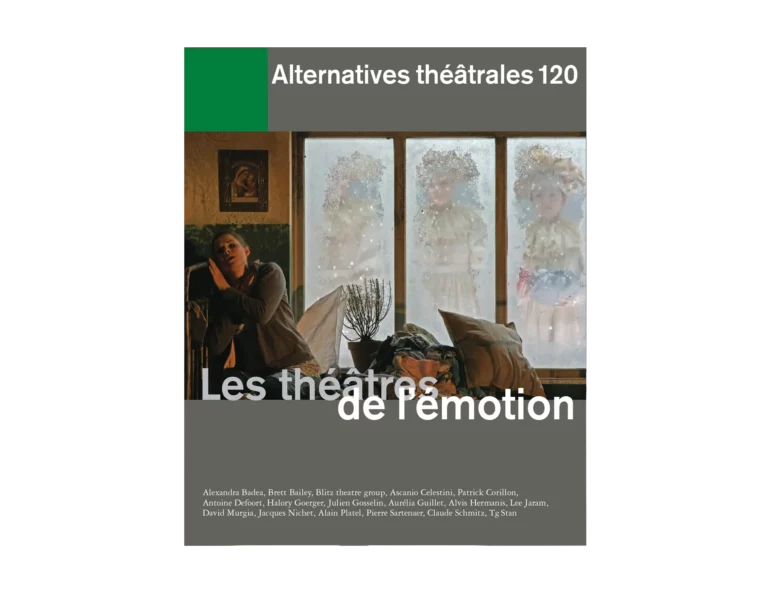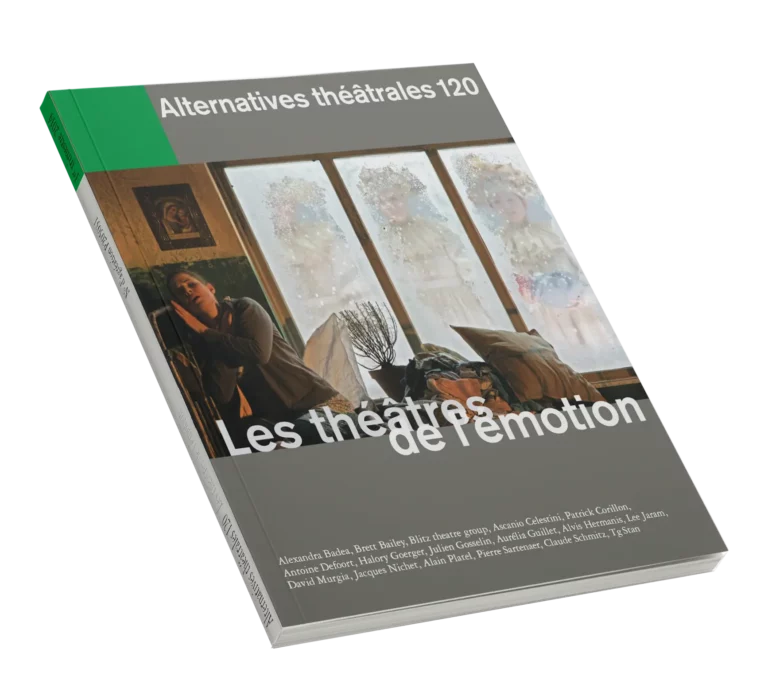« Tu ne veux vraiment plus jouer, Else ? » – « Non, Paul, je n’en peux plus. À tout à l’heure. Au revoir chère Madame. » – « Mais enfin Else, ne m’appelez pas toujours Madame. Dites Madame Cissy. Ou même plutôt Cissy, tout simplement. » – « Au revoir, Madame Cissy. » – « Pourquoi partez-vous déjà Else ? Il nous reste deux bonnes heures avant le dîner. » – « Jouez votre simple avec Paul, Madame, moi je vous gâcherais votre plaisir, aujourd’hui. » – « Laissez-là, chère Madame, elle fait du genre, c’est son jour. Un genre d’ailleurs qui te va à ravir Else… Et ton sweater rouge, encore mieux. » – « J’espère qu’avec le genre bleu, tu auras plus de succès, Paul. À tout à l’heure. »
Une assez belle sortie. J’espère qu’ils ne me croient pas jalouse…1
Else est une jeune fille de la bourgeoisie viennoise, belle et capricieuse à souhait. Alors qu’elle est en villégiature avec sa tante, elle reçoit une lettre de sa mère avec injonction de demander à monsieur von Dorsday, ami de longue date de la famille, d’éponger les dettes de son père ruiné. Le verdict est radical, la somme doit parvenir à maître Fiala le surlendemain à midi, sinon un mandat d’arrêt sera lancé. Monsieur von Dordsay accepte, mais à condition qu’elle le laisse contempler un quart d’heure son corps nu, ce soir, dans sa chambre, numéro soixante-cinq, ou dehors dans une clairière qu’il a découverte à côté de l’hôtel.
Le texte de Schnitzler, emblématique du monologue intérieur, est d’une oralité certaine – selon l’avis même de son auteur qui désirait d’ailleurs qu’elle soit portée à la scène2. Mais s’il a une dimension spectaculaire, il résiste néanmoins à toute interprétation trop univoque. Comment théâtraliser les perturbations d’une pensée en bataille ? Comment transposer scéniquement ce flot continu de pensées, de sensations, de réactions pulsionnelles sans enferrer la modernité de l’écriture de Schnitzler dans quelque esthétique restrictive – qu’elle soit conventionnelle ou à tendance avant-gardiste ?
Cette mise en scène parvient à en saisir l’essence dans une pièce d’une redoutable spontanéité. Le détachement – intellectuel et scénique – auquel les tg STAN sont parvenus aurait pu devenir un « style », avec ses concepts normatifs. Mais cette création, initiée par Frank Vercruyssen, témoigne à tous points de vue de la pérennité de leur liberté d’action3. Refusant le diktat du metteur en scène, portés par un idéal de réflexion collective, ils œuvrent hors des doctrines pour un théâtre affranchi. Rompre avec l’illusion a été une priorité fondamentale pour ce théâtre d’acteurs hors normes. Le rapport scène-salle est totalement désinhibé, la notion de personnage est repensée et le jeu s’inscrit dans une recherche du « naturel », selon la personnalité de chaque acteur au dépend d’une homogénéisation du groupe. Les tg STAN (tg pour « toneelspelersgezelschap », compagnie d’acteurs de théâtre, et STAN pour « Stop Thinking About Names ») ont été fondés en 1989. Aujourd’hui, vingt-cinq ans après, tandis que le groupe est devenu une référence pour une nouvelle génération de comédiens et de collectifs, MADEMOISELLE ELSE est un projet rassembleur, entre deux générations d’acteurs.
Et cette MADEMOISELLE ELSE est une révélation. Novice et mature à la fois comme la jeune fille de dix-neuf ans de la nouvelle de Schnitzler, Alma Palacios est une danseuse que Frank Vercruyssen a rencontrée à l’école P.A.R.T.S. d’Anne Teresa de Keersmaeker où il enseigne4. Elle parvient à se maintenir dans une économie du jeu, entre incarnation et distanciation, implication et retenue. Et ce, jusque dans l’effusion de ses visions délirantes de la fin. Face à elle, la présence ultra-décontractée de Frank Vercruyssen ne fait que renforcer sa sobriété, qui la maintient aux limites de la « performance », sans jamais aller vers la virtuosité ou l’exercice de style.
C’est elle qui porte à bout de bras ce « monologue » d’une heure et demie, telle une icône sur sa « petite scène », une planche de deux mètres carrés environ placée devant un vieux rideau rouge au centre du plateau. Autour de ce domaine réservé, presque rien. Sur le côté, un portant à roulettes et un banc où sont posés vêtements et accessoires. Une table et deux lampadaires disposés aux extrémités cour et jardin.
Frank Vercruyssen agit à un autre niveau qu’elle. En arrière-plan, extérieur à ladite fiction, il n’intervient que par intermittence et de façon décalée. À travers lui, la simplicité naturelle de ce théâtre d’acteurs transparaît à tous les niveaux de la création, qui fonctionne sur des ressorts élémentaires. Au décor minimal s’ajoute la régie lumière installée sur le plateau, que l’acteur conduit à vue. Il déclenche également depuis un téléphone les morceaux de musique, lointaines mélodies jouées au piano censées être entendues depuis les salons de l’hôtel. Qu’il suive le texte assis au bureau (du metteur en scène, du régisseur, du lecteur…) ou qu’il intervienne plus directement, ses interventions jouent sur les conventions. L’artifice est mis en évidence pour mieux déjouer l’illusion.
Sa fonction est plus de l’ordre du faire-valoir que du maître de jeu. À plusieurs reprises, il lui apporte aux abords de sa petite scène des accessoires. La lettre de sa mère, la clef de sa chambre… Magie du plateau, un rien évoque un monde. Quand il se tient face à elle avec deux robes sur cintres, on « voit » Else dans sa chambre ouvrir la penderie.
« Quelle robe vais-je mettre ? La bleue ou la noire ? La noire conviendrait mieux aujourd’hui. Trop décolletée ? Toilette de circonstance, comme on dit dans les romans français. ».
L’actrice se déshabille, enfile des bas qu’on lui tend, sa robe, ses chaussures. Un miroir apparaît :
« Je suis vraiment en beauté aujourd’hui. L’excitation, sans doute. »