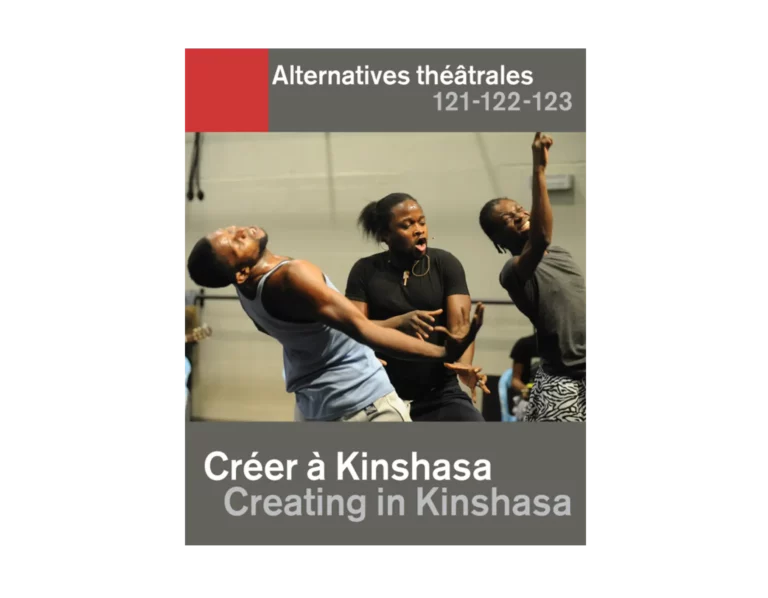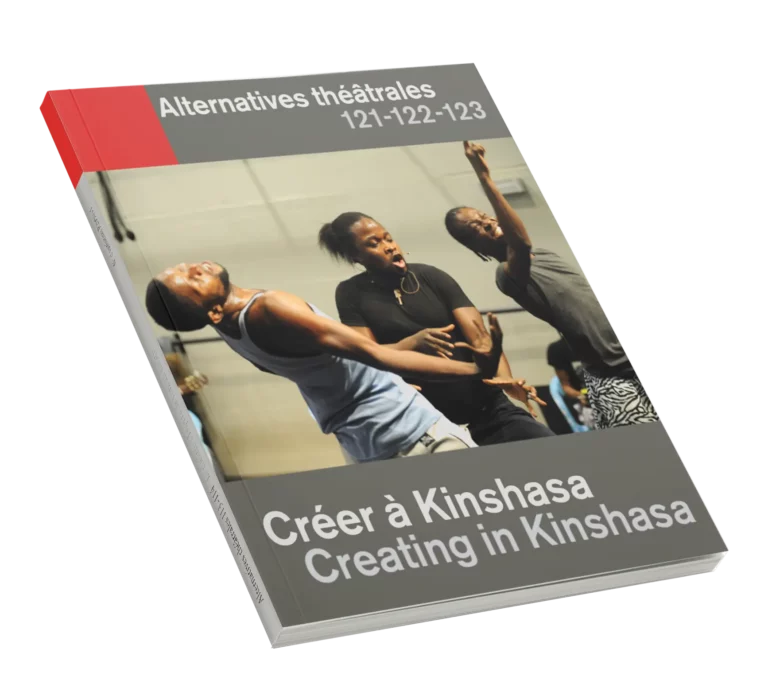De retour dans son pays après avoir séjourné plus de cinq années en France, l’auteur et metteur en scène haïtien Guy Régis Junior occupe aujourd’hui une position-clé dans l’avenir du théâtre contemporain de création en Haïti. Il lui a été proposé dès son retour de reprendre la direction de la section théâtre de l’École National des Arts et il hérite aujourd’hui de la direction artistique du Festival Quatre Chemins – événement annuel majeur dans la vie théâtrale haïtienne depuis 2003 – dont il prépare actuellement la prochaine édition, prévue pour octobre 2014.
À l’heure où la manifestation chante haut et fort ses dix ans d’existence, et ce bien qu’elle soit boudée presque chaque année par son Ministère de la Culture, avec quels paramètres le dramaturge va-t-il devoir composer pour poursuivre l’aventure ? Quels sont les éléments qui vont permettre au théâtre haïtien d’aller un pas plus loin dans l’affirmation de ses forces et de son identité ? À travers le chantier que représente la ville de Port- au-Prince dans l’après 12 janvier 2010, Guy Régis Junior observe ses contemporains et pose une vision sur la scène haïtienne résolument au dedans et en dehors des cadres établis. Entretien.
Caroline Berliner : Te voici responsable de la direction artistique du Festival Quatre Chemins qui a joué un rôle important dans ton parcours d’auteur et de metteur en scène. Et inversement. Il a accueilli tes spectacles dès la première édition avec Service Violence Série dont le retentissement en Haïti et à l’étranger a été très important pour votre compagnie. Quelles étaient les préoccupations de Nous Théâtre à cette époque ?
Guy Régis Junior : Quand nous avons créé la compagnie en 2001, nous voulions interroger en profondeur nos fonctions supposées et notre rapport à la scène. Qu’est-ce qu’un comédien ? Quel est le rôle du metteur en scène ? Qu’est-ce qui est spectaculaire ? Il existe en Haïti un rapport au jeu et à la performance qui se répand presque inconsciemment. Un besoin permanent de se mettre en scène. Comment pouvions-nous poser nos yeux sur le réel et travailler avec ce qui est déjà là ? Nous nous sommes beaucoup inspirés des bandes de Raras1, par exemple. Et nous envisagions l’acteur comme un citoyen. Le citoyen-comédien, capable de partager ses mots avec la cité. De partager ses poèmes, des textes de Frankétienne ou de Rimbaud et ce n’importe où, dans la rue, dans une fête, dans un bus. Quel est cet homme qui peut nous interpeller grâce à un texte et sa présence ? Le comédien est celui qui est lié à une cité et qui a quelque chose à lui dire. Qui en s’exhibant, en jouant de sa présence physique vient nous parler. Et le metteur en scène est là comme oreille, comme regard, pour saisir cette chose-là et accompagner le comédien dans sa recherche. J’animais, en fait. J’animais, plus que je mettais en scène. J’avais d’ailleurs une grande peur de ce mot, qui n’existe pas dans la langue créole et qui nous vient du théâtre occidental. Nous voulions exister en tant que groupe inscrit dans un autre groupe. Voilà pourquoi Nous s’est très vite imposé pour définir la compagnie, nom qui désigne aussi le public à qui nous nous adressions et que nous voulions inscrire au cœur de notre démarche. Bien sûr, après vient le travail sur la forme et l’esthétique, mais je continue de croire fermement à tout cela. Et quand j’ai monté mes textes en France, c’est aussi cela que je recherchais chez les acteurs, le désir et la nécessité de s’adresser, même s’ils avaient derrière eux une école, un théâtre, un cadre. Mais pour en revenir à l’histoire de la compagnie et de Quatre Chemins, c’est vrai que nous avons toujours été liés. Dans Service Violence Série, nous sortions de la salle de théâtre pour offrir la fin du spectacle à la ville, et maintenant j’ai la responsabilité d’inviter la ville au théâtre …
C. B. : La programmation de cette édition-ci va plus loin dans ce sens puisque la Fokal2 et toi avez proposé aux artistes d’occuper des espaces non-théâtraux dans la ville de Port-au-Prince. Nous avons pu assister à des spectacles qui se jouaient dans la rue mais aussi dans une gaguère (lieu dédié aux combats de coq ndlr), dans un bar, sur le parvis d’un musée.
G. R. J. : Depuis le séisme du 12 janvier 2010, il n’y a plus de salle de spectacles à Port-au-Prince. La plupart des espaces qu’avait investi le Festival ont été détruits. Il faut donc penser les choses autrement. Plutôt que de regretter la carence de salle de spectacles, j’aime penser qu’elles existent partout, justement parce qu’il n’y en a pas.
De plus, notre ville résonne aujourd’hui dans le monde entier : nombreux sont ceux qui s’interrogent sur son avenir et s’affairent à chercher la réponse. Je voudrais que les artistes investissent également cette question.
La construction d’Haïti nous concerne tous. Comment allons-nous investir la question de notre devenir ? Qu’allons-nous faire de cette ville en ruines ? Je pense d’ailleurs donner à l’édition 2014 le titre Faisons tomber nos ruines. Ces ruines présentes physiquement sous nos yeux mais aussi dans notre mentalité, qu’on ne parvient pas à abattre. Comment discerner celles qui vont nous permettre de nous reconstruire parmi celles qui nous momifient ? Comment s’emparer de cette fête théâtrale que représente un festival au sein d’un espace comme
ça ? Les moments festifs ne sont pas des moments vides de sens pour moi, au contraire, je les envisage comme des vrais moments de remise en question. Le carnaval, très populaire chez nous, est un moment dont on profite pour critiquer les structures, l’état, les autorités. Je voudrais emmener les créateurs avec moi sur cette idée qu’un festival peut déboucher sur un projet de société. Nous avons la chance de pouvoir interpeller les gens, faire en sorte qu’ils s’habillent, qu’ils sortent de chez eux. Nous devons nous placer dans la clairvoyance et interpeller le public, ne pas lui dire ce qu’il faudrait faire ou pas, mais lui permettre d’ouvrir les yeux sur sa ville, son pays, sa réalité. Pourquoi se réunir, sinon pour remettre en question ce qui nous concerne tous ? Notre vie dépend de cette terre et inversement.
C. B. : Faire tomber les ruines. La formule peut-elle s’appliquer à ton projet pédagogique pour la section théâtre de l’Enarts ?
G. R. J. : L’enjeu principal pour l’instant est de sensibiliser les étudiants à la réalité artistique contemporaine.
Leur donner des clés pour qu’ils se libèrent de cette image du théâtre classique français, extrêmement apprécié dans notre pays et enseigné dans nos écoles comme une tradition que nous n’avons n’a pas eu la chance de vivre. La notion d’auteur vivant est quelque chose qui existe très peu dans l’imaginaire théâtral. Je travaille avec mes étudiants sur les auteurs venus après Büchner mais aussi sur l’espace scénique, les nouvelles formes, les nouvelles esthétiques, les préoccupations des créateurs au sens large.
- Adopté en Haïti au moment de l’avè- nement de l’esclavage, Rara est aujourd’hui un des emblèmes du patrimoine culturel haïtien, très apprécié par la population. Les bandes de Raras sont des troupes musicales regroupant des paysans qui, chaque année, défilent dans les rues entre le premier jour du Carême et le lundi de Pâques. Une bande se déplace au départ avec une dizaine de personnes et le nombre de participants augmentent de défilé en défilé, celui-ci pouvant aller jusqu’à 2 000. Ce spectacle est souvent dirigé par un « maître-rara », interprété par un prêtre vaudou. ↩︎
- La Fondation Connaissance et liberté est une fondation haïtienne, financée principalement par l’Open Society, créée
en 1995 pour promouvoir les structures nécessaires à l’établissement d’une société démocratique. Elle soutient Quatre Chemins depuis sa création et a pris en charge la production exécutive et l’organisation du festival de 2010 à 2013, en partenariat avec Wallonie-Bruxelles International et l’Institut Français d’Haïti. L’édition dont il est question ici, celle de 2013, a été élaborée par Fokal et Guy Régis Junior. Fokal restera l’un des principaux interlo- cuteurs de Guy Régis même si elle se retire de l’organisation du festival à partir de 2014. ↩︎ - J.-C. Lanquetin est artiste, scénographe et enseignant à la Haute École des Arts du Rhin / Strasbourg. Interlocuteur privilégié de Guy Régis Junior, il réalise ses scénographies depuis 2010 et a ouvert depuis un séminaire sur les scénographies urbaines à l’Enarts. ↩︎