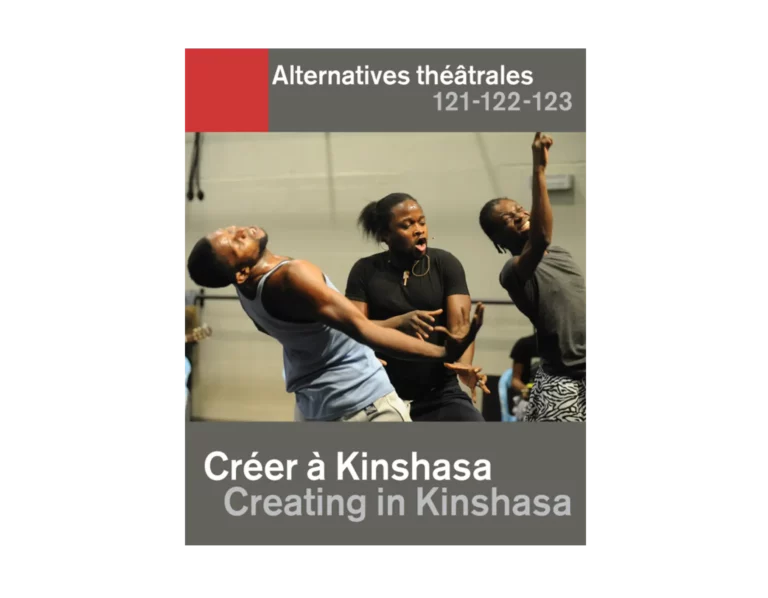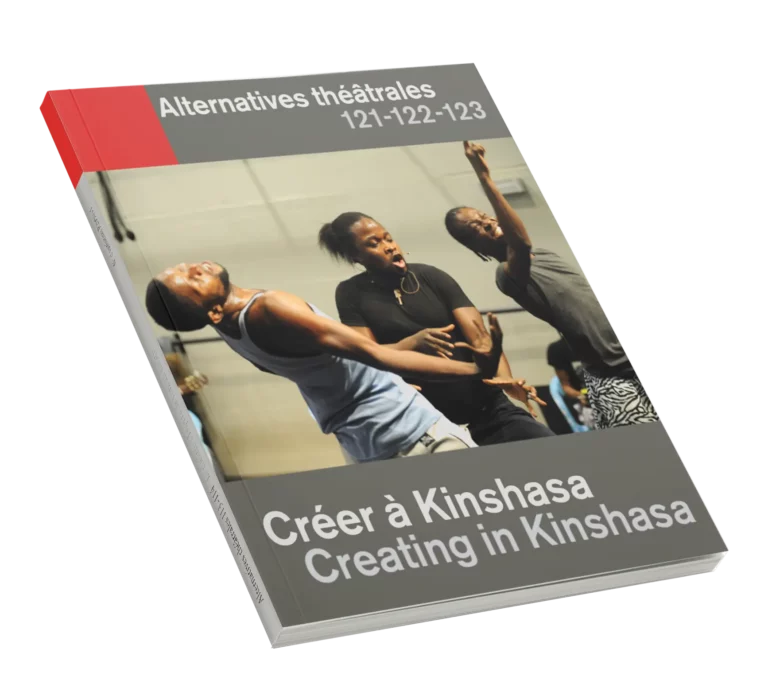Bernard Debroux : Vous bougez beaucoup ! Normal pour un danseur… Parti de Kinsangani, vous êtes allé au Kenya puis vous êtes passé par la France. Votre travail aussi, mêle plusieurs disciplines : théâtre, danse, langage, musique… Quels ont été vos premiers contacts avec la Belgique ? La première fois que vous y venez, c’est au Festival de Liège, en 2005, avec Le Festival des mensonges…
Faustin Linyekula : Oui, pour une première étape de travail du spectacle. Claire Verlet, qui était à l’époque directrice de programmation au Centre National de la Danse, a été parmi les premières personnes à soutenir mon travail en France. Elle a parlé de moi à Jean-Louis Colinet. On s’est rencontrés et il nous a programmé au Festival de Liège. Paul Kerstens est venu me voir après le spectacle pour me proposer de rencontrer le directeur artistique du KVS, Jan Goossens. Je suis venu à Bruxelles et ils m’ont parlé de leur projet, Green Light1, qui rassemblait des artistes belges d’origine africaine. Ils se posaient vraiment des questions de fond sur la meilleure manière de nouer des liens avec le Congo. C’est ainsi qu’a commencé ce compagnonnage qui dure depuis bientôt dix ans.
Le KVS est le seul endroit en Europe où je peux appeler en disant : « dans deux semaines, serait-il possible d’avoir un studio pour travailler?»; il y a de fortes chances qu’on me réponde oui et qu’il y ait un technicien pour m’accompagner, même si ce n’est pas une production prévue pour leur théâtre. Un dialogue s’est noué avec Jan Goossens et son équipe, au-delà de mes projets de spectacles : nous menons des échanges sur la place du théâtre et de la création dans une ville, à partir des questions que se pose le KVS à Bruxelles et celles que je me pose dans un contexte très différent, à Kinsangani. Leur réflexion nourrit la mienne, et vice-versa.
B. D.: Quelle formation avez-vous suivie ?
F. L. : Ma formation au départ est littéraire. J’ai commencé à écrire quand j’avais quatorze, quinze ans, et comme beaucoup d’adolescents, j’ai écrit des poèmes. J’ai eu la chance, ou la malchance, de commencer à écrire en réaction à la Négritude. Je le dois probablement à mon professeur de français de l’époque, pour qui l’aboutissement de toute démarche littéraire pour un noir était la négritude. Une phrase de l’écrivain Wole Soyinka2 m’a libéré : « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. » J’ai commencé à écrire adolescent avec la conscience que je venais après les Senghor, les Césaire et que je devais, non pas me mesurer à eux mais me considérer comme leur descendant. C’est une chance de commencer sa vie artistique avec la conscience d’arriver dans une Histoire importante et de se positionner par rapport à elle.
B. D. : Ce qui m’a frappé lors de ma visite à Kinshasa, c’est que plusieurs artistes qui étaient partis travailler en Europe, aux États-Unis ou ailleurs en Afrique sont revenus là où se trouvent leurs racines alors qu’ils auraient pu faire carrière ailleurs. Pourquoi avez-vous décidé de revenir, d’abord à Kinshasa, puis à Kisangani et d’y créer une structure de création ?
F. L. : Au-delà des questions de forme, ce qui m’intéresse, c’est d’abord de raconter des histoires, ou du moins d’essayer de les raconter. Les histoires qui me mettent en mouvement pour la création ne sont pas des histoires d’exils, même si je suis très sensible à la question de l’exil. Pour être en accord avec moi-même, après un long séjour en France, je devais rentrer au Congo. Je ne pouvais pas, au départ, aller directement à Kisangani : durant la guerre la région était contrôlée par les rebelles. En 2001, je suis donc allé à Kinshasa où je n’avais jamais mis les pieds et où j’avais des amis qui pouvaient m’accueillir.
Là, personne ne développait le genre de travail qui m’intéressait. J’ai alors eu le choix soit de ne créer que des soli, soit de mettre en place un studio où je pourrais transmettre des connaissances, former et travailler avec un groupe. C’est cette direction que j’ai choisie. Je travaille aussi pour ne pas être seul, pour rencontrer d’autres personnes et essayer de faire un bout de chemin avec elles : rêver, réfléchir, douter avec d’autres. Je n’arrive pas à avoir le même niveau de dialogue avec les gens quand nous sommes en création que quand on est juste en train de boire des bières. On passe tant de temps ensemble en création qu’à un moment, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui commence à se révéler, peut-être même malgré nous.
B. D. : Les Studios Kabako, créés d’abord à Kinshasa, étaient-ils conçus au départ comme une structure de formation ou de production ?
F. L. : J’ai tout de suite lié les deux. Le premier texte, qui se trouve toujours sur la première page du site (www.kabako.org), dit bien que les Studios Kabako, ce n’est pas une compagnie mais un lieu. Un lieu où on apprend, où on échange, où on doute, mais où certains soirs il s’impose comme une certitude. Un lieu où on peut oser, où on peut imaginer que le dérisoire de l’art peut faire face à l’énormité de la destruction.