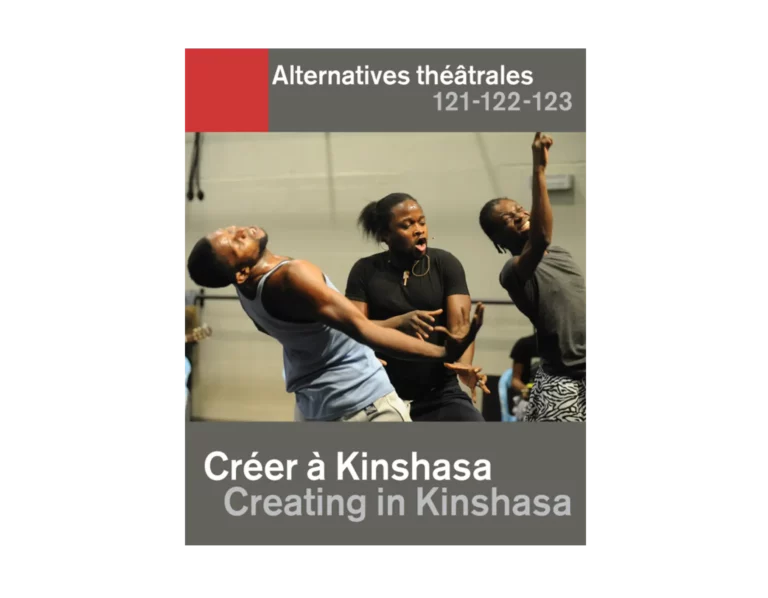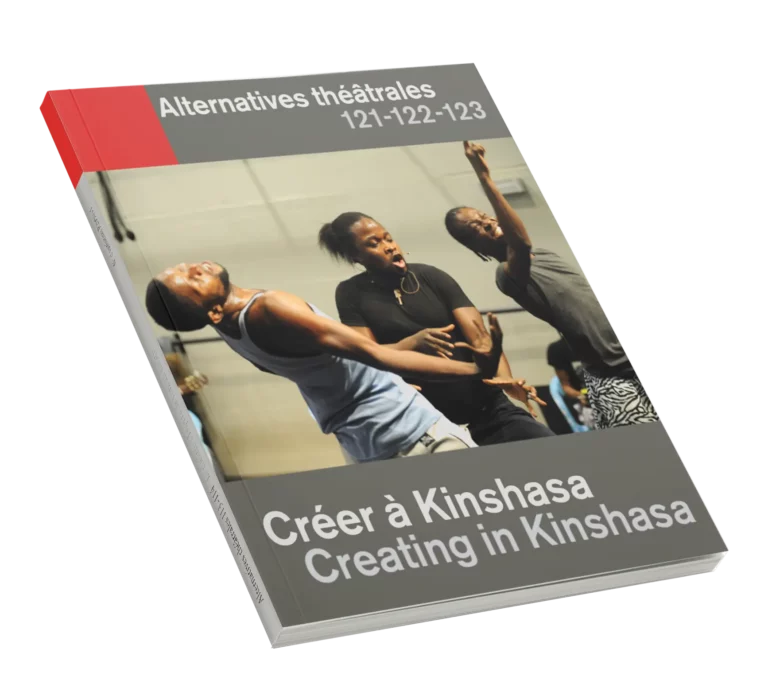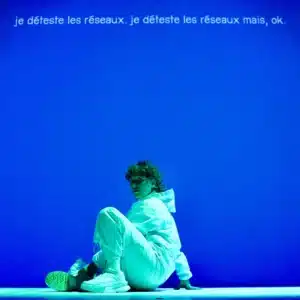Bernard Debroux : Comment est née ta vocation de sculpteur, devenue une profession, un art, aujourd’hui internationalement reconnu ?
Freddy Tsimba : Je suis issu d’une famille de quinze enfants. Une famille polygame, à l’époque c’était admis. Une famille très soudée sous l’autorité du papa. Quinze enfants, c’était normal. Bien sûr, à la fin, la crise venant, mon père n’a plus pu assurer l’éducation de tous et nous avons dû nous débrouiller. Mon père était fonctionnaire à la mairie de Kinshasa. C’est lui qui fixait les prix des denrées alimentaires. C’était un homme honnête, il n’a pas profité de la position qu’il occupait pour s’enrichir. Il voulait surtout aider les gens. Il a réussi à acquérir une maison où nous avons tous été élevés et une plantation au plateau de Bateké mais il n’avait pas d’autres richesses, d’autres biens et quand la crise s’est amplifiée, nous avons dû vraiment nous débrouiller pour avancer dans la vie.
B. D. : Vous habitiez donc tous dans cette maison paternelle à Matonge ?
F. T. : Oui, tout à côté de la place de la Victoire, place mythique pour les artistes de Kinshasa et centre de la vie populaire nocturne. Je suis né là. Très petit, je dessinais, faisais des voitures en fil de fer pour mes amis. Nous n’avions pas les moyens d’avoir des jouets, alors je les fabriquais moi-même. Petit à petit, ces objets sont devenus comme des bijoux et les amis de mes parents ont commencé à les commander chez moi. Ça m’a permis d’acheter à manger pour mes jeunes frères et moi et aussi de m’acheter de la « friperie ».
Déjà, je n’étais plus nu ! Bien sûr, j’ignorais les prix, c’étaient les acheteurs qui les fixaient. Trois dollars, pour moi, c’était bien, je pouvais m’acheter des caleçons ! Il y avait trois cinémas dans le quartier (ciné Bongolo, ciné Matonge, ciné Victoire), et le plus grand des trois manquait d’affiches. Ces affiches circulaient, étaient abîmées, il fallait les refaire. On a découvert que je dessinais et que je pourrais réaliser des affiches. On fixait une image arrêtée du film et je la reproduisais sur un papier à carreaux. On ne me payait pas, je pouvais aller voir les films, mais mon père ne voulait pas ! Une de mes sœurs était tombée amoureuse d’un homme qui était à l’école des Beaux-Arts. Il venait souvent à la maison et comme je dessinais tout le temps, il a découvert mes dessins.
C’était l’été, il m’a fait dessiner quelques croquis et les a transmis à l’école pour que je puisse m’y inscrire. On cachait les noms des candidats pour pouvoir juger sans être influencé. Sur cinq cents candidats, on en a retenu cinquante et j’en faisais partie. C’était une grande joie. Ensuite, il y a eu une seconde sélection où nous étions enfermé dans une salle et nous avons à nouveau dû dessiner pour être sûr que nous étions bien les auteurs des œuvres. Vingt-cinq ont été retenus et j’ai fait partie du lot.
B. D. : Tu as donc suivi ensuite les cours de l’école des Beaux-Arts…
F. T. : J’ai fait quatre ans d’humanités artistiques et j’ai ensuite suivi trois ans d’études supérieures. Je n’ai pas suivi la licence. Je considérais que j’avais reçu des bases solides et je ne souhaitais pas être formaté davantage par une formation « classique ». J’ai préféré poursuivre ma formation durant sept ans auprès des fondeurs et des soudeurs pour apprendre les techniques. À l’école, on apprenait l’art grec, le classique, mais ce n’est pas ce que je cherchais. Je voulais être libre d’exprimer ma sensibilité dans des formes qui me correspondaient.
B. D. : Ces stages, tu les as faits chez des artisans différents ?
F. T. : Oui, la plupart étaient situés à Matete, au sud de la ville. C’était des gens qui travaillaient pour la fonte de bronze, mais qui maîtrisaient parfaitement les techniques. Souvent les artistes dessinent leurs projets, leurs moulages, et s’adressent ensuite aux artisans, fondeurs, pour réaliser l’œuvre. Je ne voulais pas agir de la sorte, je voulais souder et fondre moi-même. D’autant qu’on pouvait réaliser plusieurs copies de l’œuvre, ce que je ne voulais pas. Dans ma relation avec eux, j’ai caché mes diplômes, je ne voulais pas qu’on m’appelle « maître ». Un jour pourtant j’ai été trahi. Des amis sont passés et m’ont demandé, surpris, ce que je faisais là. Les artisans ont pensé que j’aurais pu les aider car eux aussi réalisaient quelquefois des œuvres et ils m’ont chassé… Je ne regrette pas, car si j’avais dit que je venais des Beaux-Arts, les rapports auraient été différents. Je venais pour apprendre, je voulais être un artisan, comme eux. J’ai donc appris énormément auprès des soudeurs et des fondeurs.