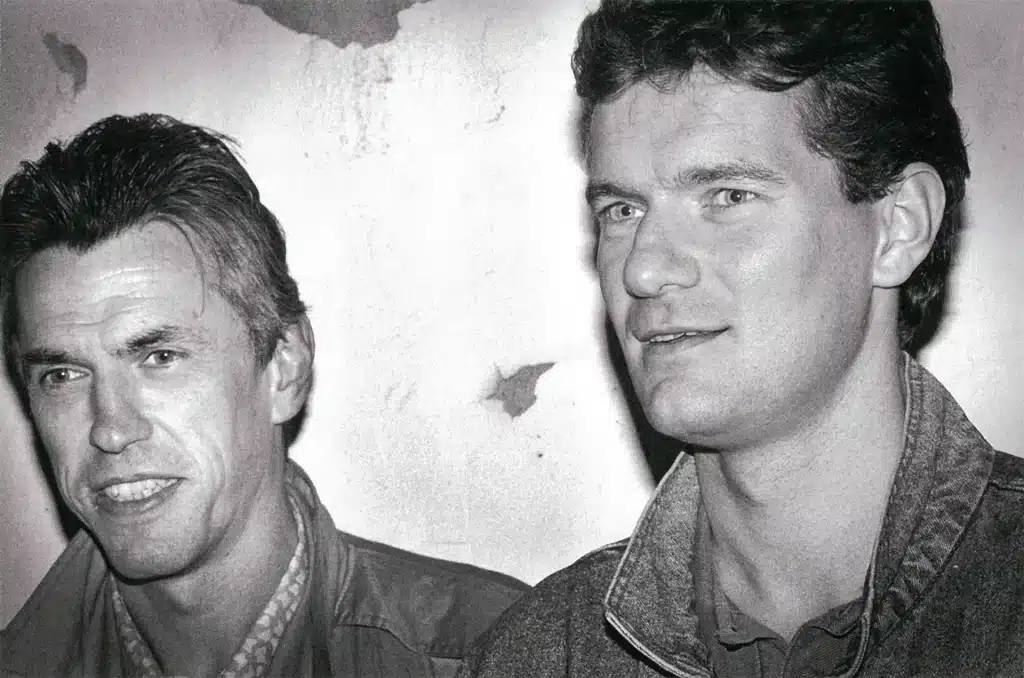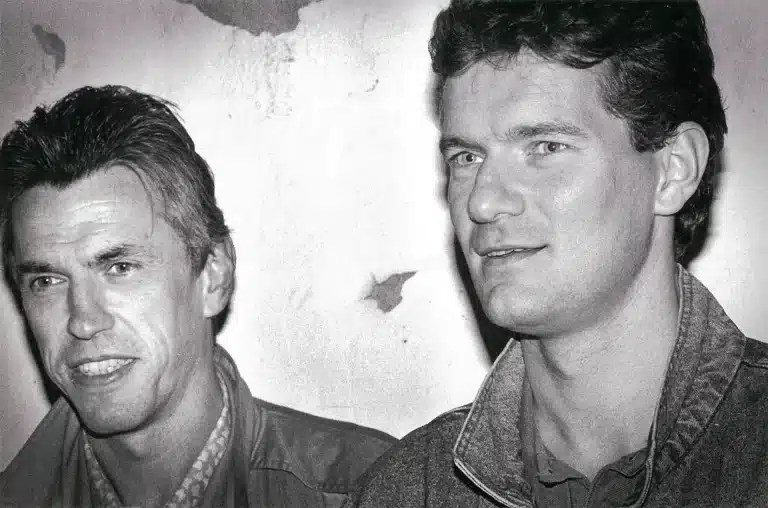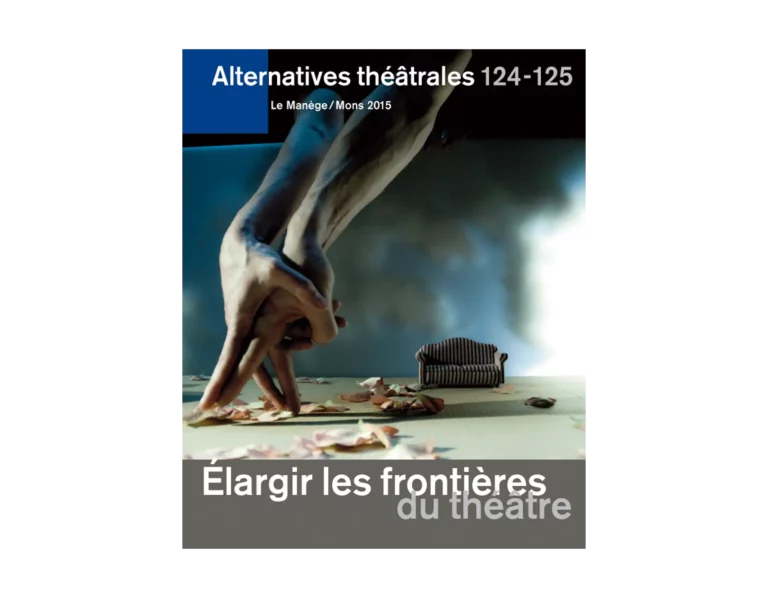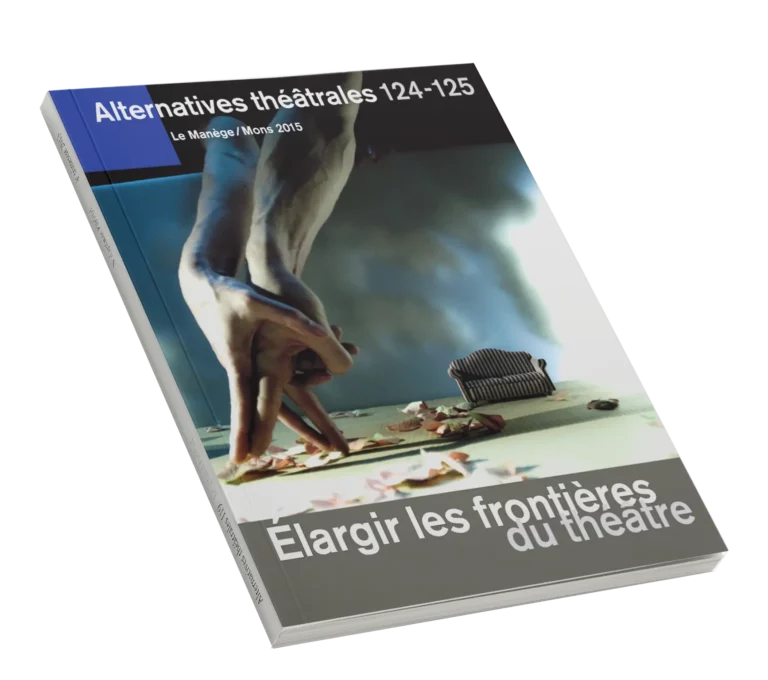« AUJOURD’HUI, après l’hôpital et tous les autres bâtiments publics, avec la naissance de ce théâtre, s’achève enfin, et grâce à l’aide américaine, le temps de la reconstruction… ». Par cette déclaration du maire en 1983, s’ouvraient les belles années de conquête. Ces années 82 – 83 coïncident aussi avec la création à Béthune du Centre Dramatique National du Nord- Pas-de-Calais, dirigé par Jean-Louis Martin-Barbaz qui prend l’initiative d’engager un dialogue avec des villes de La région qui ne disposent pas encore d’une programmation théâtrale de service public : Dunkerque, Maubeuge, Laon…, créant ainsi autour de Béthune une constellation. Jean-Louis Martin-Barbaz, qui développa ainsi une des missions du Théâtre Populaire des Flandres de Cyril Robichez. C’était le début des années Lang.
La poursuite sans faille de cette aventure s’est faite avec le soutien indéfectible des maires de la ville Jean-Claude Decagny, Alain Carpentier, Rémi Pauvros et aujourd’hui Arnaud Decagny, ainsi qu’avec le bougmestre de Mons, Elio Di Rupo.
Reconstruction
Avec le label estampillé de la DRAC, on passait ensuite à la Région, et on repartait avec l’équivalent de 150 000 euros en ayant moins de 30 ans…
Nous avons donc lancé deux festivals et avons imaginé les « Théâtrales » des trois provinces : la Picardie et les deux Hainaut, belge et français. Nous avons dès le début travaillé avec des auteurs qui à la fois témoignaient de la mémoire ouvrière et populaire, et inventaient des formes nouvelles d’écriture, comme Jean Louvet par exemple. Et puis nous avons associé des metteurs en scène comme Robert Cordier qui nous faisait découvrir Shakespeare. Toutes ces formes nouvelles, où parfois, et même souvent, s’imposait la nudité des corps, firent aussi grincer les dents. Nous étions habités par cette phrase du jeune Treplev dans LA MOUETTE de Tchekhov : « Des formes nouvelles, sinon rien ! » et des aventures du Festival de Nancy et du Mickery à Amsterdam.
Par effraction
Il y avait alors sur place des artistes qui nous ont aidés à affirmer le choix de cette modernité : Gérard Hourbette, le fondateur du groupe Art zoyd, qui en était l’emblème absolu, le sculpteur Grégory Anatchkov, Richard Castelli aujourd’hui directeur de l’agence artistique Epidemic.. Et vint Philippe Thiry, le directeur de l’ONDA, l’Office National de la Diffusion Artistique, qui fut aussi l’un de nos bienfaiteurs. Il nous donnait rendez-vous à l’étranger, en Italie, à Lisbonne, et prenait en charge notre séjour sur place. On y retrouvait des figures pionnières comme François Le Pillouër, Jean Blaise, Jean Marie Songy, Michel Orier, etc.
C’est ainsi que, sur les traces du Festival d’Automne de Paris, nous avons pu programmer à Maubeuge une bonne partie de ce qui dans ces années-là constituait la fine fleur des avant-gardes internationales. Les Flamands aussi ont débarqué : Anne-Teresa de Keersmaeker, Wim Vandekeybus.. qui, une nuit, sans rien demander à personne, presque par effraction, repeignit en noir les planches de notre grand plateau de chêne neuf. Mais cela faisait partie des provocations nécessaires, un peu comme le fait de dormir dans le théâtre pendant les périodes de création et de montage. Ce sont là les symptômes de cette dynamique « langienne » qui nous offrait beaucoup de liberté. On était encore dans la pulsion de la chair et du sang.
Nous travaillions beaucoup avec les Comités d’Entreprise : tout d’abord avec Jeumont Schneider. Nous étions encouragés à ces partenariats par le Ministère de la Culture dont le budget venait d’être doublé. Une ferveur populaire s’est alors emballée autour du Manège.
Pendant ce temps-là, de l’autre côté de la frontière, le Théâtre Royal de Mons continuait à ronronner avec ses comédies de boulevard et ses opérettes. Seuls quelques francs-tireurs tentaient d’imposer autre chose : Michel Tanner avec son Centre Dramatique Hainuyer, Bernard Debroux à la Maison de la Culture de Tournai et de Namur, Jean-Louis Colinet à Liège, Frie Leysen et Jo Dekmine.
L’accueil de toute une ville
Nous avons donc nous aussi lancé les Théâtrales en mars, que nous avons doublées et prolongées l’été, au moment de la kermesse de la bière par un autre festival, Les Inattendus. Encore une fois la Région Nord- Pas-de-Calais et le Ministère nous ont beaucoup soutenus en les personnes Jacques Imbert, d’‘Ivan Renard puis Catherine Génisson, d’Alain van der Malière, Alain Brunsvick et Yves Deschamps invitant les artistes à venir travailler et créer à Maubeuge à leur rythme. C’était beaucoup plus sain. Éric Lacascade et Guy Alloucherie ont inauguré ce dispositif, parmi les nombreux artistes nomades qui ont posé leurs valises à Maubeuge. Plus tard nous avons poursuivi l’ambition encore en invitant Peter Stein ou Robert Lepage, puis Bob Wilson qui est venu trois fois et qui se souvient encore de l’accueil au château — il en a parlé récemment dans un entretien publié dans un quotidien new-yorkais — grâce à l’hospitalité de Pierrette Mariani, sa très cultivée et très généreuse propriétaire.
L’accueil des artistes et du public extérieur n’était pas assuré par le seul théâtre, mais par toute une ville. Les services techniques municipaux se dépensaient sans compter pour construire des scènes et des gradins dans des usines, et quand on se met à la disposition de Matthias Langhoff pour accueillir son MACBETH, il n’est pas question de ménager son effort. Lors d’une panne d’électricité qui nous a privés de chauffage en plein hiver, nous sommes allés chercher des couvertures chez les pompiers, une pour deux, et nous avons improvisé une soupe pour réchauffer les spectateurs à chacun des deux entractes. Ce sont des aventures inoubliables et qui marquent profondément la mémoire sensible des spectateurs.
Pour la Fura dels Baus, la compagnie catalane dont c’était la première visite en France, il a fallu trouver des litres et des litres de vrai sang de bœuf — on n’utilisait pas d’hémoglobine artificielle à l’époque — et Les spectateurs se souviennent encore de la force sauvage que ces litres de vrai sang ajoutaient à la représentation. Ce n’est qu’en 1991, grâce à Bernard Faivre d’Arcier, que le Manège a pu rejoindre avec les Maisons de la Culture, les CAC et les CDC le réseau enfin rassemblé des 70 Scènes Nationales et jouer enfin, institutionnellement, dans la cour des grands.
L’obtention dès fin 1991 du Grand Prix National de l’entreprise culturelle saluait l’arrivée dans le monde culturel d’une dynamique nouvelle de gestion et de gouvernance.
Avant l’euro
Soulignons aussi l’absolue volonté de vouloir adosser une ville frontalière à sa voisine belge de Mons, tentatives repoussées d’abord ce qui nous incite à jouer le jeu transfrontalier avec Charleroi Danses et le Grand-Hornu, voire le Pass. Dans ce contexte, il faut saluer l’apport essentiel des programmes européens Interreg auxquels nous avons participé du tout premier à l’actuel n° 4.
En grandissant, nous avons donc pu nous associer avec Charleroi Danses, alors dirigé par Frédéric Flamand, et jeter ainsi Les bases d’une politique transfrontalière plus ambitieuse. Grâce à une volonté politique sans faille et toujours réaffirmée, le dynamisme apporté par
Daniel Cordova, Pascal Keiser, nous avons pu créer la Scène Transfrontalière :une seule billetterie, une programmation et une information communes, une politique tarifaire identique de part et d’autre de la frontière, à une époque où il fallait encore convertir les monnaies (francs belges et francs français), communiquer par eurochèques et les adresser par voie postale. Un temps d’avant l’euro. Nos bus-cocktails, où l’on offrait l’apéritif aux spectateurs pendant le trajet, étaient parfois bloqués par la police ou par la douane au poste frontière, le temps d’un contrôle, et il fallait retarder le début du spectacle jusqu’à l’arrivée du dernier bus. Les mineurs devaient produire une autorisation de sortie du territoire ! Un autre âge, quoi… Mais pour voir Peter Stein, Romeo Castellucci, Reza Abdo et plus tard Alain Platel, cela valait la peine de subir quelques tracas et de prendre son mal en patience.
Manèges(s)
Et petit cadeau du destin : il se trouve que les deux bâtiments dans lesquels ont été aménagées nos aventures transfrontalières, à Mons comme à Maubeuge, sont deux anciens manèges équestres reconvertis. Un heureux hasard qui a créé l’homonymie, la symétrie, l’effet miroir, et qui bien sûr aujourd’hui fait sens à l’heure de Mons 2015, l’événement qui aujourd’hui nous réunit. Pour Mons comme pour Maubeuge, cet événement sera l’aboutissement et la récompense de ces vingt-cinq années de persévérance, d’efforts et de succès engrangés.
Mais nous espérons aussi que l’événement sera l’occasion d’un nouveau départ, d’un redéploiement, et aussi le symbole voire le coup d’envoi de notre entrée dans le XXIe siècle. Le Festival Via, en 2015, sera en particulier l’emblème de cette volonté artistique et politique commune.

Un destin numérique