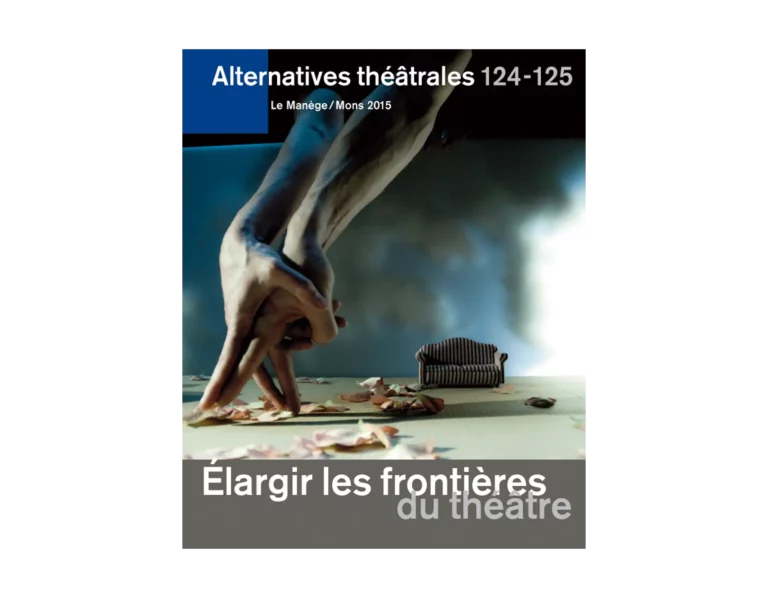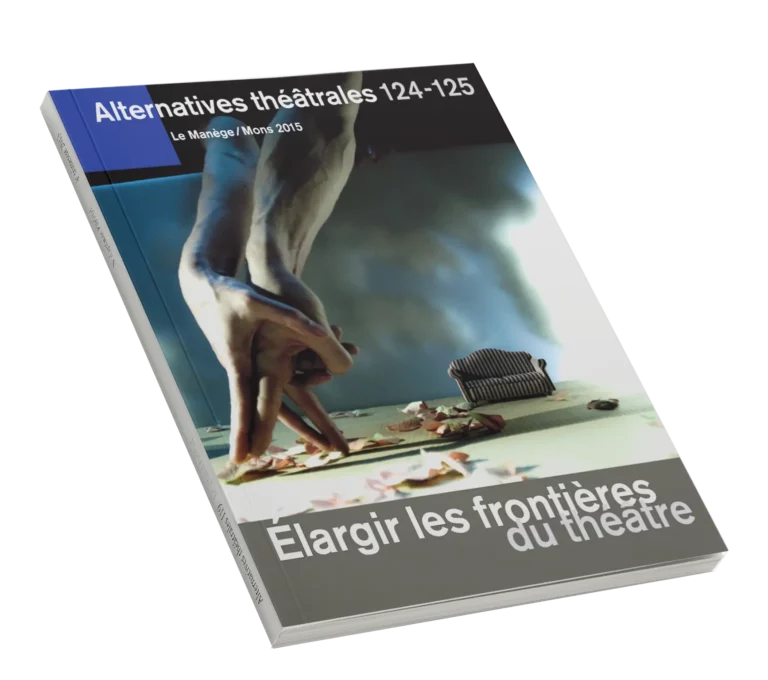BERNARD DEBROUX : Il y a près de trente ans que tu es engagé dans le théâtre où tu occupes une place singulière. Ne peut-on pas dire qu’il y a toujours eu dans ton travail une double dimension ? Il y avait dans les premiers spectacles (MUSIK, SALOMÉ), une exigence esthétique, une volonté de renouveau de l’art de la mise en scène. D’autres spectacles ont suivi dans cette veine (SAINTE-JEANNE DES ABATTOIRS, UN ENNEMI DU PEUPLE). Et, en même temps, il y avait Le souci d’aller à la rencontre et de travailler avec un public qui était en dehors des circuits habituels des spectateurs de théâtre. Ce furent des expériences comme celles de CQFD avec une organisation syndicale ou celle tout à fait étonnante des AMBASSADEURS DE L’OMBRE avec ATD Quart Monde. On a le sentiment que tu aurais pu poursuivre une carrière très reconnue avec des spectacles à l’esthétique très marquée par un renouveau de la mise en scène et en même temps que cette volonté, ce choix de travailler autrement et avec un autre public a été prédominant.
Lorent Wanson : Il y a deux pans, certainement, qui sont liés à des rencontres, à des choix qui s’opèrent à des moments charnières. Quand on fait des petits spectacles dans la cave de ses parents, on veut parler à ses voisins et ses parents. Ensuite, quand on entre dans des écoles de théâtre, on veut continuer à parler aux gens que l’on connaît : les profs, les condisciples. On se détache peu à peu de ces raisons premières.
UN ENNEMI DU PEUPLE a été un très gros succès du Théâtre National à l’époque. Durant trois saisons, les salles étaient pleines. Il y avait, à ce moment, des grèves d’enseignants ; les profs ont pris le spectacle comme une sorte de bannière. J’avais pourtant l’impression que les salles restaient « homogènes ». Si les questions centrales d’UN ENNEMI DU PEUPLE tournaient autour du débat, de la démocratie, y compris dans la scénographie, je me demandais comment arriver à « hétérogénéiser » le public.
Je reçois des subventions publiques. Qu’est-ce que cela signifie si je ne fais pas un travail qui peut s’adresser à chaque citoyen qui, par ses impôts, paie pour que je puisse, moi, faire mon travail.
Artistiquement, je fais partie d’une lignée qui trouve ses racines dans le travail de metteurs en scène comme Marc Liebens, et en même temps je me sens héritier d’un courant qui œuvrait pour la démocratisation du théâtre.
Yannic Mancel : J’ai l’impression en effet que l’on retrouve dans ta démarche les grandes contradictions, les grandes tensions dialectiques entre des questions de forme et des questions de contenu. Certains de tes spectacles comme MUSIK ou SALOMÉ explorent davantage la question du langage, de la grammaire, de la rhétorique, du signe. D’autres spectacles qui ne sont pas si différents de ces deux-là comme CQFD, UN ENNEMI DU PEUPLE, SAINTE JEANNE affirment très fort l’engagement de l’artiste citoyen dans un combat, dans la problématique de la lutte des classes, de la vérité, de la lutte contre la corruption.
Quels sont les outils esthétiques que tu utilises pour réaliser ce travail ? Il y a cette démarche de la « fragmentation », de la brièveté, du séquençage, et par ailleurs la dimension de la choralité. Ce sont, me semble-t-il, deux fils rouges de tes mises en scène.
L. W.: La question de la choralité est fondamentale.
Jusqu’à SAINTE JEANNE, je me sens assez « membré » idéologiquement. Je pense que Le théâtre et nos processus de travail vont changer le monde ; il y a une certitude que le théâtre qu’on fait a une raison politique.
Que se passe-t-il dans les répétitions ouvertes mises en place pour SAINTE JEANNE ? L’idée du « non-public », l’idée de « l’autre » va prendre une dimension très concrète. La parole de l’autre, sa réalité vont apparaître au premier plan. Ces questions vont culminer jusqu’aux AMBASSADEURS DE L’OMBRE. Les schémas idéologiques face à ce que les gens traversent ne tiennent plus la route. La question n’est plus de faire — même si j’aime bien l’expression —, un théâtre d’utilité publique, le travail doit plutôt être un terrain où nous confrontons et partageons des expériences humaines. En quoi la culture de celui qui est en face de moi serait inférieure à la mienne ?
L’objectif est de faire de la culture partagée, de la culture de rencontres. Des chocs qu’on n’essaye pas d’annihiler. Dans LES AMBASSADEURS DE L’OMBRE, travailler avec des non professionnels ne signifiait pas faire du théâtre amateur, mais créer une œuvre qui tienne compte de leur culture et de notre culture. C’est cette démarche que je vais développer ensuite, sur RUPPE en Serbie, sur AFRICARE, sut HISTORIA ABIERTA. Cela nous conduit à la question de la choralité.
À partir de ces expériences-là, je me suis rendu compte que j’ai passé beaucoup de temps de ma vie à écouter des histoires et à avoir des voix, des voix, des voix.
Y. M.: Dans choralité, il y a aussi polyphonie…
L. W.: J’ai écrit un texte où je me posais la question de savoir pourquoi je n’arrivais pas à demander aux gens de chanter à l’unisson. Ce qui m’intéresse dans la choralité, c’est que chacune des voix puisse avoir sa propre inclination. Comme dans mes compositions musicales : qu’un élan musical soit de porter, qu’un autre élan musical soit de mettre en doute, qu’un autre élan musical raconte que c’est déjà perdu — que ces trois, quatre, cent voix se fassent entendre.
J’ai beaucoup travaillé dans les écoles ; ce travail amène naturellement à la choralité. Développer le sens du partage, que tout le monde ait une voix ; faire entendre des fables avec des voix qui soient différentes.
Y. M.: La fragmentation permet à chaque individu, à chaque sujet, dirait-on en psychanalyse, de s’exprimer. En même temps la choralité lui permet de se rattacher à un groupe humain qui forme une société, une communauté, une citoyenneté.
L. W.: Le sens même de tout ce que j’ai abordé dans mon travail est toujours lié aux rapports de l’individu, de l’intime avec la société. En quoi faisons-nous cet incessant aller-retour?En quoi, en tant qu’individu, faisons-nous partie d’une société ?
Les choix au théâtre sont souvent faits par rebonds et par propositions.
Il n’y aurait pas eu le travail en Serbie (RUPE) s’il n’y avait pas eu LES AMBASSADEURS DE L’OMBRE, comme il n’y aurait pas eu non plus AFRICARE et il n’y aurait pas eu HISTORIA ABIERTA s’il n’y avait pas eu AFRICARE.
Daniel Cordova : Si j’ai proposé à Lorent d’aller en Afrique et au Chili, c’est que je sentais chez lui cette capacité de prendre en compte de façon forte cette tension entre le politique et la forme. J’ai pensé que Lorent avait cette capacité d’explorateur mais aussi de déclencheur des potentialités qui existaient là-bas en Afrique. Lorent a mis sur pied une méthode pour récolter l’information et suite aux observations faites sur place, d’intégrer ces formes dans le spectacle AFRICARE.
Pour le Chili, il s’agissait de traiter les blessures fortes qui sont dans la mémoire des gens. Comment créer un spectacle en lien avec cette mémoire douloureuse de la dictature, mais dans une forme différente de ce qui se fait au Chili ? Ainsi a surgi une création dans laquelle se retrouvaient trois scénographes, deux compositeurs, deux chorégraphes, et au début trois personnes qui participaient à l’écriture. Il s’agissait d’un risque énorme, mais Lorent a cette capacité d’entraînement qui a permis au projet d’aboutir.
Y. M.: J’ai encore ressenti cette méthode de travail dans ton dernier spectacle, UNE AUBE BORAINE. Partant d’une chanson de Brecht, il y a un concept qui est souvent affectif et sentimental. Ensuite, comme la chanson de Brecht évoque la question de l’exil et de l’immigration, Lorent va se documenter, Lire. Puis, il réécrit, non seulement d’un point de vue textuel mais aussi au plateau. Dans la troisième phase de la méthode, il y a une espèce de superposition écriture textuelle / écriture de plateau.