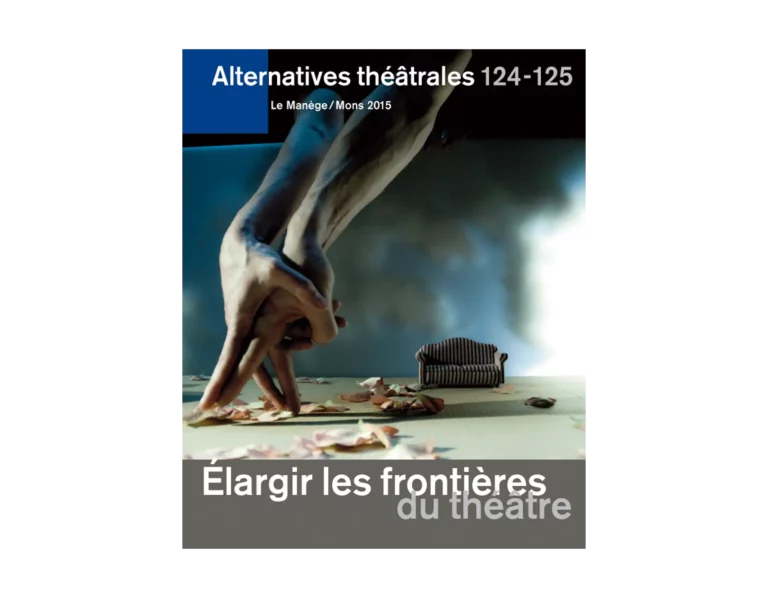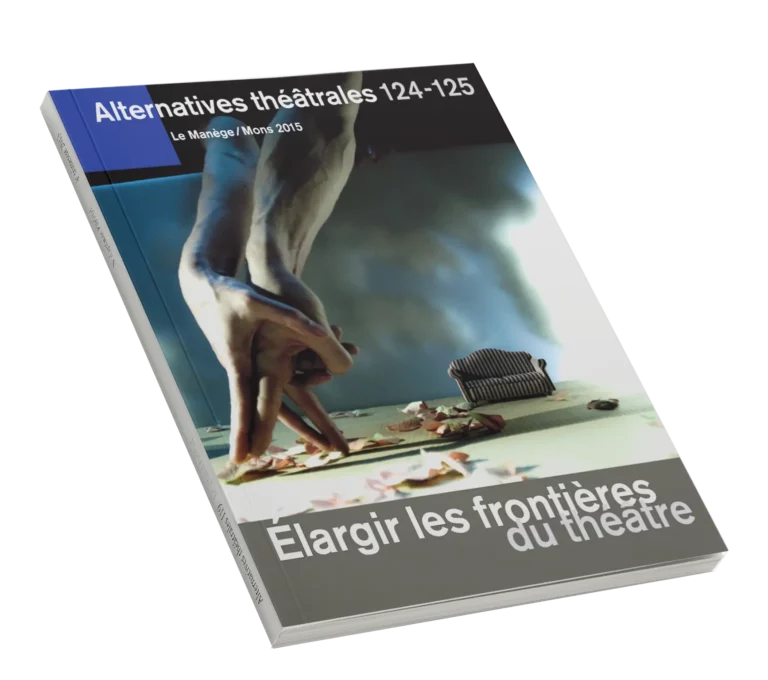LA VILLE BOUGE. Les politiques culturelles évoluent depuis les dernières décennie ; que ce soit les opérateurs cherchant à trouver de nouveaux outils de médiation, des élus empoignant la culture comme une éventuelle solution à des questions d’image à revaloriser, ou de troubles sociaux à atténuer, voire d’économie ou de territoires à revitaliser. Et Les artistes créent. Les habitants restent, eux, encore souvent indifférents à tout ce brouhaha officiel.
La ville bouge, le paysage culturel change, ne se satisfaisant plus des espaces ritualisés:les scènes culturelles subventionnées, du théâtre au rock, continuent à accueillir des publics nombreux, attentifs, mais, en général, restreints.
Dès lors, il nous faut nous intéresser à l’espace public, là où chaque habitant vit, travaille, passe, et réinventer la surprise au coin du chemin. Les arts de la rue ont montré la voie, le théâtre de rue notamment, en bousculant les habitudes, celles des artistes, des élus et des spectateurs. En parallèle, de nouvelles techniques artistiques sont apparues, occupant l’espace public : vidéo mapping, installations sonores, architecture éphémères, danse verticale.
Il nous reste à accompagner l’art par de nouveaux outils culturels. L’agora, la proximité des œuvres, des artistes et des habitants est un sujet en soi : aller vers eux alors que nous leur demandions de venir à notre culture. Mons 2015 s’inscrit, à sa façon, dans ce besoin de recherche au cœur d’un paysage habité.
Mons, rapide tour de visite : nonante mille habitants, connue pour sa Grand Place, ses festivités du Doudou, son musée et… et pas facile de lui trouver une place sur la carte européenne. Et pourtant cette géographie est pleine de ruelles pavées, de monts et terrils, de murs de pierre grise, de jardins cachés, de carrières et de rivières, de l’intramuros aux anciens charbonnages du Borinage et champs de maraïîchers.
Nous avons donc pris notre bâton de pèlerin : vivre ce paysage et rencontrer ceux qui y habitent, avec leurs méfiances initiales (et une capitale de la culture est un formidable outil pour réveiller les oppositions !). Discuter, s’engueuler, puis s’entendre, une choppe à la main : rien de tel à Mons pour s’obliger à inventer des formules adaptées à la ville.
Un point de départ : la géographie
Nous sommes partis, non de l’histoire (celle qui fonde un texte, un passé, une légende, une réflexion) mais de la géographie:y apparaissent les questions de proximité et de paysages urbains, les termes de voisinage et d’intimité.
Outil pratique s’il nous faut contourner les questions de vocabulaire quand nos interlocuteurs cherchent leurs mots ; tout le monde n’a pas cette aisance que la littérature et le chéâtre demandent. Piste parmi d’autres, nous préférons donc passer par la cartographie qui raconte les chemins de traverse à parcourir, les secteurs ruraux, urbains et montagnards (collines, terrils) à franchir, la ville à construire.
Les images et la toponymie, à côté des voix et des textes.
À partir d’une carte de huit secteurs de proximité, et une autre de douze communes partenaires sur le Borinage, bases des Grand Huit et Grand Ouest, nous cherchons à investir la ville, les jardins privés et les champs, les maisons particulières, les fenêtres et les porches, les friches oubliées et les quais de halage, entre espaces intimes et publics. Sur l’ensemble, plus de cinq cents Montois, généalogistes amateurs, sportifs et pépiniéristes, seniors et étudiants, responsables d’écoles et danseurs de tango, ont choisi de participer depuis juin 2013 à la conception et la fabrication de ces huit semaines de manifestations, dont un banquet, un bal, un projet participatif, un parcours à faire à pied, à cheval, en poussette (à hauteur d’enfants donc), un artiste étranger en résidence, des expos, des spectacles. Et l’envie de se surprendre, tous.
Après la géographie : le réveil de l’imaginaire
Nous demandons en général à nos voisins d’aimer le théâtre russe, l’art contemporain ou la musique sérielle. Et s’ils n’apprécient pas, nous leur donnerons du théâtre action, de l’art figuratif ou du hiphop.
Et toc, c’est bien fait !
Mais comment comprendre les artistes quand on a oublié nous-mêmes de jouer avec nos propres rêves ? Comment se laisser aller devant les œuvres lorsqu’on ne sait en général plus aussi facilement, l’adolescence passée, manipuler les mots, les images, les sons qui ont tous pris des sens sociaux plus complexes que lorsqu’on était enfant ? Proposons donc à nos voisins de jouer avec leur imaginaire, de trouver des thèmes identitaires.
Dans la foulée, comment ne pas critiquer les budgets élevés de la culture, non expliqués, quand on paie difficilement ses impôts ? Et hop, nous proposons un apprentissage d’outils de production (passer par les coulisses pour mieux les comprendre), des résidences d’artistes à la maison (une écrivaine, n’ayant pas le permis, va se faire raccompagner à la gare par les habitants, le voyage étant le support de leurs conversations puis d’un livre), des ateliers participatifs et expos autour des arts modestes (du tatouage sur les cimaises et sur nos bras, des jardins suspendus réalisés par des enfants, des épouvantails par dizaines) et des œuvres pointues (une série de vidéos d’art notamment), la simplicité et l’exotisme (les artistes d’ici et de là-bas comme sujet de confrontation) tout autant que l’exigence de l’art. Et surtout le collectif comme lieu de partage d’expériences et de savoir-faire : tous les mois, les groupes d’habitants se retrouvent pour fabriquer ces semaines.
L’expérience est loin d’être terminée, mais il semble qu’affûter le regard de nos voisins, les former et les sensibiliser à l’art en valorisant leurs propres cultures ne peut que les aider à mieux appréhender ce que ces rencontres bizarres et surprenantes que sont les œuvres et les spectacles ne soient plus des univers lointains ; et ce laboratoire se pose en complément de ce que travaillent, au quotidien, les équipes des structures culturelles.
Habiter collectivement le paysage, cartographier nos relations humaines, créer une géographie de l’imaginaire :un paysage sensible, base d’une histoire qui débutera en 2015, et devra continuer, sans nous, dans les années qui suivent.