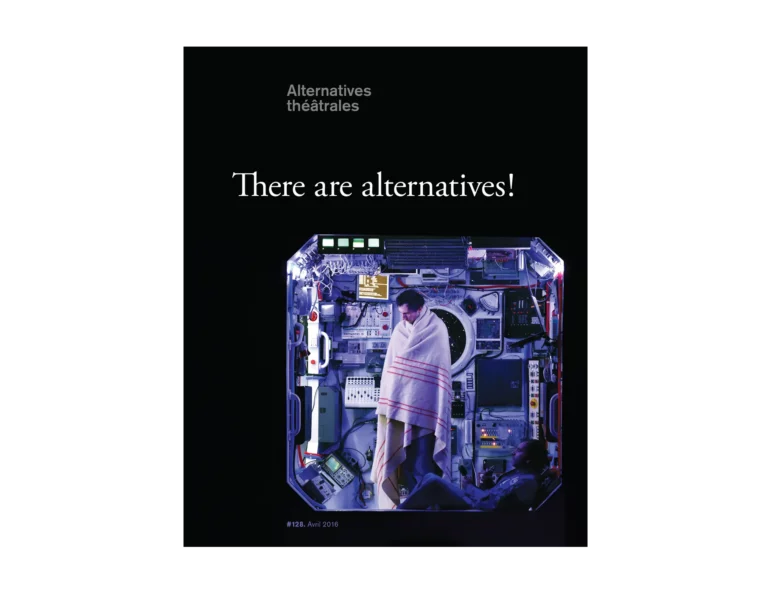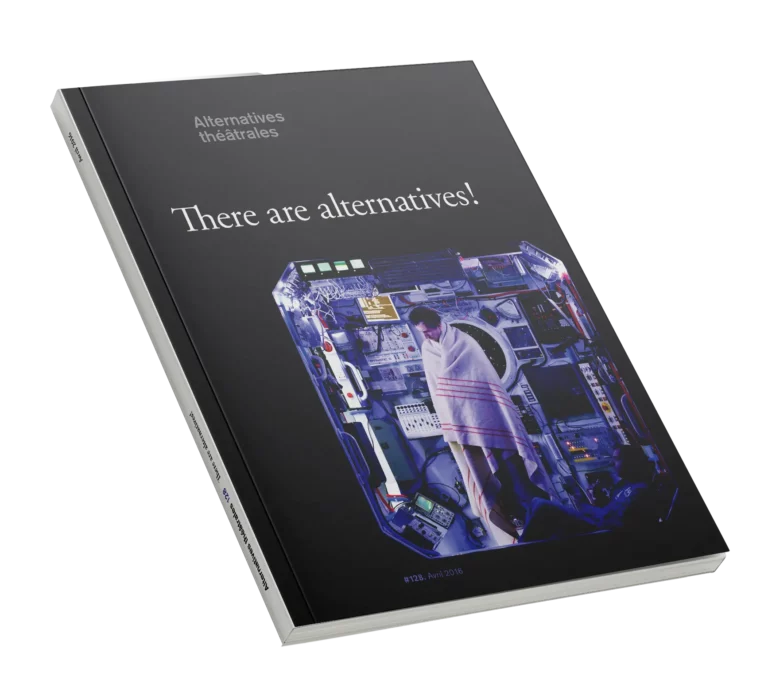Il y a un certain temps au théâtre des Bouffes du Nord où j’avais passé des soirées et des soirées pour suivre les spectacles de Peter Brook, j’ai ressenti un profond sentiment d’isolement que j’ai diagnostiqué comme étant un symptôme flagrant de vieillissement : le spectacle du collectif Les Chiens de Navarre m’échappait, rien ne m’intéressait, je restais étranger au cœur d’une salle enthousiaste. Impossible de m’associer à cette dérision généralisée, à ce théâtre direct et grossier, vital et vulgaire. Et pourtant autour de moi, de jeunes gens se réjouissaient et, à la fin, enfiévrés, applaudissaient à tout rompre. D’où venait ce succès, me demandais-je perplexe ? Et mon indifférence, voire mon exaspération ne cessaient pas de croître. D’un écart de génération, me suis-je dit, résigné. Il faut l’admettre… un autre théâtre remplace celui de Brook dont j’éprouvais la nostalgie aux Bouffes. La fracture s’est creusée et il est temps de l’assumer, nullement de la camoufler ou de la masquer. Rien de plus dangereux que de se réfugier dans l’évaluation négative personnelle sans prendre en compte la réalité collective de la salle, de ce public conquis – leçon de lucidité que je me suis infligée à moi-même ! Avec regret, mais en consentant. En prenant la mesure du temps, de l’âge, de la séparation.
Ces jours-ci, pour ne pas m’isoler, par désir de découvrir cet aventurier du théâtre qui a surgi sur la scène française avec fracas, Thomas Jolly, je me suis rendu à l’Odéon plein d’appréhension pour voir Richard III. Qu’est-ce qu’il est beau un théâtre plein… quelle énergie dégage-t-il ! Avec, à côté, un ami amateur de théâtre compulsif, je me suis installé inquiet. Qu’allais-je découvrir ? La déception, comme aux Bouffes, sera-t-elle au rendez-vous alors que les éloges fusent autour. Éloges parfois suspects car rapidement déployés, sous l’effet d’un jeunisme « officialisé » auquel j’échappe en raison de cette « vérité » que je respecte, la vérité qui est la mienne, celle d’un spectateur solitaire qui a traversé un demi-siècle de théâtre. Sceptique, inquiet, attentif tout de même : dans cet état je m’engageais sur la voie de ce Richard III. Au-delà du spectacle en lui-même, je devais le subir comme une épreuve générationnelle. Comme un test personnel.
Le spectacle commencé, l’histoire engagée, le plateau occupé – c’est à un théâtre exalté que j’étais convié. Non pas un théâtre réservé, mais, au contraire, pleinement assumé, non pas un théâtre économe, mais un théâtre épanoui, sans contraintes ni censure. Un théâtre qui s’affirme sur fond de confiance. Qui ressuscite une sorte de mémoire imaginaire… et alors s’est emparée de moi la satisfaction inouïe que j’avais éprouvée en voyant, il y a plus de trente ans, les Molière de Vitez. Alors j’avais été fasciné, comme aujourd’hui, par le désir de théâtre assumé pleinement, théâtre placé sous le signe d’un jeu ludique à la fois archaïque et immédiat, fête des corps qui actualisent les temps passés et jouissent de l’instant immédiat. Oui, ce Richard III m’est apparu comme étant vitézien. Et comme Vitez à l’époque, il retrouve son public, surtout jeune… Sur mon siège, je ne me retrouvais plus isolé, mais intégré dans cette assemblée effervescente sur fond de souvenirs de jadis. Oui, Jolly, pareil à Vitez autrefois, procède à la redécouverte des « galions engloutis » d’un théâtre ancien qui, maintenant, sous nos yeux, prend vie et procure un « plaisir » particulier, celui d’un art qui ose revisiter son passé sans pour autant se vouer à des fouilles archéologiques.