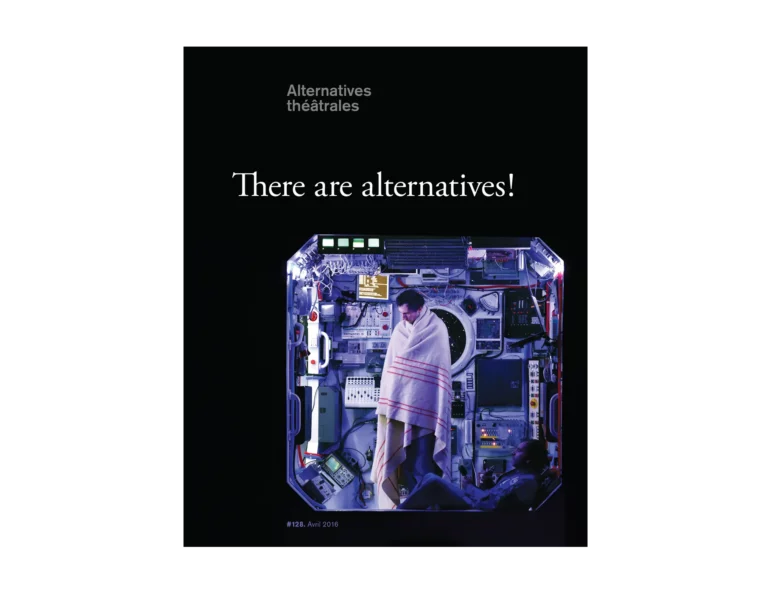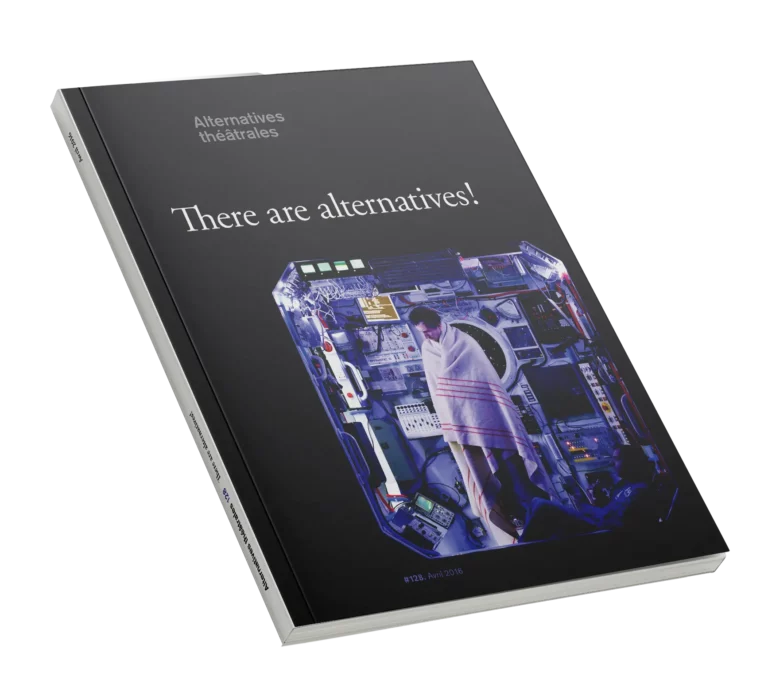Trois sphères
Antoine Laubin - Dans ce premier numéro piloté par la nouvelle équipe de direction, nous avons souhaité interroger le titre de notre revue, trente-cinq ans après sa création et, avec lui, une certaine dimension politique des arts de la scène. Les sciences humaines, le monde associatif et la création sont trois sphères où, potentiellement, la société peut se réinventer. Je souhaiterais commencer un premier tour de table pour tenter de poser un constat. Comment expliquez-vous que ces trois sphères – pensée, mouvements citoyens, création artistique – ne se rencontrent-elles pas davantage ?
« Pose-t-on la question
en termes de représentation
–que montre-t-on sur un plateau ?
– ou en termes de production ? »
MG Je ne peux répondre que pour la création artistique : je ne suis pas certain que ce secteur ait la possibilité de réinventer le monde… L’art représente le monde mais je ne pense pas qu’il souhaite réellement le changer ni qu’il le remette fondamentalement en cause ; il tend même parfois plutôt à reproduire les logiques du système néo-libéral. Le modèle de développement du projet artistique le plus répandu – production, diffusion – perpétue ces logiques, même s’il existe des initiatives qui relèvent de l’exception. Si on regarde l’ensemble du secteur, on est très loin d’un idéal révolutionnaire.
MA La non remise en cause du système dans le milieu artistique a moins d’excuses qu’ailleurs. Ce milieu est inscrit dans la société. Il en reproduit les logiques mais ses marges de liberté et ses possibilités de sortir du cadre y sont plus grandes qu’ailleurs.
MG Cette marge de liberté induit une responsabilité du secteur artistique. Les contraintes de production actuelles font qu’il est beaucoup plus facile de monter un spectacle bien pensant et joli et de le tourner à travers la planète que de faire une œuvre véritablement politique.

Photo Leslie Artamonow.
ND La question est difficile à universaliser : il n’y a pas LE monde de la pensée ou LE monde créatif. À partir des années 1970 en Belgique francophone, un certain théâtre a voulu intervenir dans la société en travaillant d’abord sur les structures, c’est-à-dire sur ses conditions de production : avec qui « faire théâtre », comment faire théâtre et où faire théâtre. Avec le temps, le monde du « théâtre-action », par exemple, a eu à se resituer par rapport à ses relais politiques (les mutuelles, les syndicats, etc.). Le théâtre institutionnalisé a cherché sa place face aux contraintes de la société, notamment économiques. Ainsi, dans les années 1990, par exemple, les théâtres étaient « sommés » d’agir sur leur quartier. Aujourd’hui, ce qui est politique reste assez flou. Certains artistes, comme Joël Pommerat, disent ne pas faire du théâtre politique, d’autres revendiquent un théâtre qui serait davantage militant. Ce flou n’est pas un hasard. Pose-t-on la question en termes de représentation – que montre-t-on sur un plateau ? – ou en termes de production ? Les revendications de conditions de production dans un cadre donné s’uniformisent beaucoup : on essaie d’agir sur la Ministre ou dans les cabinets mais les cadres sont peu remis en question. C’est là le problème. Entre le milieu associatif, le milieu théâtral institutionnalisé et la mouvance du théâtre-action, les éléments de différenciation sont le lieu et les conditions de production. Il faudrait s’emparer de cette question-là. Les rencontres après les spectacles, le lien avec l’associatif qui est souhaité et mis en place par beaucoup d’artistes, est-ce que ça transforme réellement le cadre ?
CS La prétention qui consiste à poser un « vernis politique » à la création, à se montrer ouvert aux changements, ne résiste pas quand on gratte un peu. Comme ailleurs dans la société, c’est au niveau des très petites échelles que les choses sont expérimentées et se réinventent, très peu au niveau du fonctionnement global : les modèles critiqués sont tout de même reproduits.
SML Si le théâtre en salle reste très cloisonné, le développement du théâtre hors les murs et de la création in situ a beaucoup ouvert le champ des possibles à destination d’autres publics et a été très soutenu par les pouvoirs publics (création de labels, nouvelles subventions, etc.). Si ces pratiques sont encore considérées comme « mineures », en tout cas moins nobles que le théâtre en salles, elles se sont tout de même institutionnalisées. Le cloisonnement entre artistes professionnels et amateurs s’y amenuise, l’inscription dans le territoire peut être plus forte. On parle de « démarches artistiques partagées », les exemples sont nombreux d’artistes qui prélèvent une matière sur un territoire et permettent un travail particulier de médiation et de rencontres.
DM Je voudrais revenir sur la première intervention de Matthieu. J’observe des préoccupations très communes à l’ensemble des personnes qui travaillent dans les arts de la scène, souvent concentrées autour de phénomènes négatifs produits par le néolibéralisme. De nombreux artistes tentent, au plateau, de « faire quelque chose », de raconter des histoires qui relaient ces préoccupations. Bien entendu, les modes de production sont parfois en totale contradiction avec les propos tenus. Il y a aussi des chercheurs scientifiques qui sont poussés à la production effrénée d’articles et travaillent selon des normes en opposition à ce qu’ils revendiquent. Il est fréquent de s’opposer aux modes de production dont on bénéficie en même temps…
AL On peut vouloir changer le monde mais ne pas y parvenir… Ce que j’entends dans l’intervention de Matthieu, c’est un point de vue sur le « résultat » des œuvres, pas sur les intentions de leurs auteurs.
Les conditions du décloisonnement

Photo DR.
DM Ce point d’intersection entre chercheurs critiques, artistes et associatifs, c’est-à-dire entre des producteurs de pensée, des « raconteurs d’histoires » et des gens de terrain, me semble crucial et je m’étonne que la rencontre n’existe pas davantage. Il faut chercher des raisons pratiques et non théoriques : quelle est cette plateforme qui ne parvient pas à exister ? Je pense que les artistes ont un rôle à jouer avec les penseurs pour soutenir l’action de terrain des mouvements associatifs. Si on se demande comment limiter le pouvoir du politique ou de l’économique, comment éviter concrètement, par exemple, que le TTIP s’impose, il me paraît évident que les personnes qui savent produire de la (contre-)pensée et celles qui savent la transmettre doivent travailler ensemble pour faire émerger des alternatives au modèle dominant imposé. Les universitaires parlent trop dans les universités, les artistes sont trop dans les théâtres : les uns et les autres devraient sortir de leurs « milieux naturels » et soutenir la rue pour créer des alternatives concrètes.
« La vraie pensée intellectuelle
est une pensée laborieuse,
du secret, de la concentration,
qui n’a pas d’impact direct. »
MA Il est certain que les structures officielles empêchent les alternatives. L’organisation du travail qui domine dans le monde artistique se retrouve aujourd’hui dans le monde de la production : travailler par projets, intérioriser les contraintes… J’observe tout de même une convergence ces dernières années : l’expérience de « Tout autre chose1 » a été lancée en partie par des artistes issu du monde théâtral, tout comme celle des « Acteurs des temps présents2 ». Ce sont de nouvelles manières de se retrouver dans l’espace public. De plus, en se retrouvant, ces personnes développent une manière de s’exprimer proche du mode théâtral. J’ai récemment participé à un débat sur la sécurité sociale à La Louvière où des mutualistes wallons et africains avaient matérialisé leur jumelage en créant ensemble une pièce de théâtre. D’autres expériences similaires m’ont été rapportées. Le mode théâtral est utilisé comme outil.
AL Nancy, perçois-tu des raisons historiques qui expliqueraient que l’institution théâtrale ne soit pas actuellement le lieu privilégié de ce décloisonnement ? Des choix passés de politique culturels peuvent-ils être pointés ?
ND Depuis les années 1930 et l’agit-prop, il y a une grande tradition de mobilisation du fait théâtral à visée sociale et politique. Les explications sont simples : le théâtre peut être un art pauvre, qui échappe très vite à la censure politique (se déployant et disparaissant rapidement), et il s’agit d’un art éminemment social puisqu’il rassemble les gens. Mais aujourd’hui, la créativité est toujours davantage mise au service de l’esprit d’entreprise, dans le cadre de ce que Boltanski appelle le « nouvel esprit du capitalisme ». Cela oblige la « vraie » création à réinventer son propre modèle.
Pour revenir à ta question, je pense que ces catégories sont des pré-constructions. Il faudrait interroger ce qu’est « l’associatif ». Durant les années 1970, en Belgique francophone, au moment de la transformation de l’institution par le Jeune Théâtre, les syndicats étaient complètement dans le jeu et, parmi cette génération du Jeune Théâtre plusieurs figures marquantes provenaient du monde intellectuel et universitaire (Jean-Marie Piemme, Michèle Fabien, Jean Louvet…). Or, la pensée événementielle domine largement aujourd’hui. Les journées d’études dans les théâtres sont des événements ponctuels sans grande retombée : les intellectuels sont contents d’avoir été invités et le théâtre est content d’avoir fait un débat. L’un et l’autre monde sont d’ailleurs poussés à des rapprochements, peu importent les effets. Or, la vraie pensée intellectuelle est une pensée laborieuse, du secret, de la concentration, qui n’a pas d’impact direct. Et, par ailleurs, le théâtre étant un art largement minoritaire aujourd’hui, il n’intéresse guère les intellectuels, en dehors des spécialistes. Surtout, l’un et l’autre de ces mondes ont des contraintes institutionnelles fortes, notamment en matière d’évaluation. Il faut trouver les manières d’agir dans ces situations – ou les transformer – mais une difficulté réside dans la récupération permanente opérée par la logique institutionnelle.
MG Quand on lit un contrat-programme d’une structure théâtrale, on n’y voit jamais d’obligation de missions liées au monde académique ou aux mouvements citoyens ! Des objectifs « classiques » de démocratisation culturelle s’y trouvent (diversifier les publics, ce genre de choses) mais pas de lien avec la pensée ou l’action citoyenne.
ML La logique des conventions en Fédération Wallonie-Bruxelles est celle des projets déposés. En déposant un projet de convention pour un lieu, les directeurs se donnent des missions à eux-même ; c’est une grande responsabilité qui nécessite de fait une réflexion sur l’outil qu’on a entre les mains. C’est à nous de changer les paradigmes.

Photo Véronique Vercheval.
AL Historiquement, il me semble que les centres culturels ont été, dès leur création, les lieux où l’impact dans le réel des pratiques artistiques était le plus recherché. N’y a‑t-il pas eu un mouvement général chez les artistes de refus de l’instrumentalisation du geste artistique à des fins uniquement socio-culturelles et, conséquemment, un certain repli de ces artistes vers une sphère considérée comme plus « noble ». La logique institutionnelle n’a‑t-elle pas suivi ce double mouvement de refus et de repli ?
ML L’injonction formulée aux logiques de démocratisation des publics, à la sensibilisation, a débouché sur l’idée que « ça n’est pas du théâtre ». Il y a artistiquement et esthétiquement un préjugé défavorable qui s’est effectivement installé.