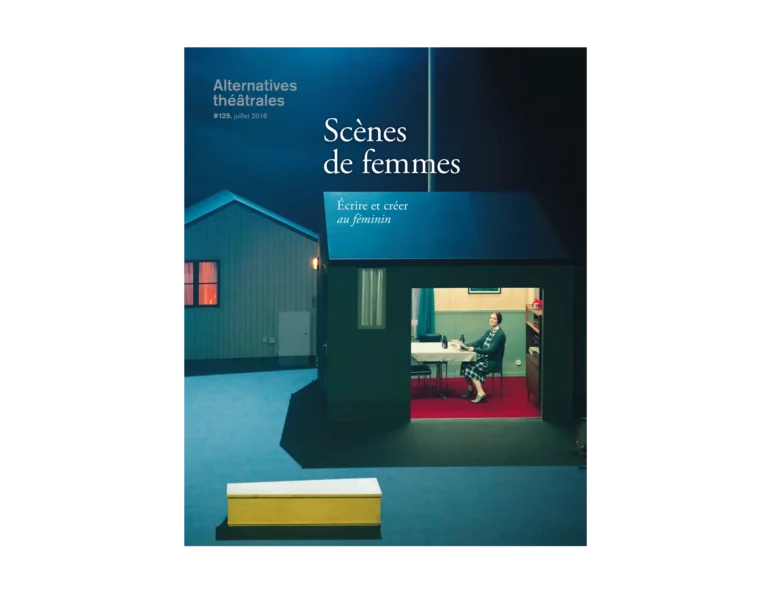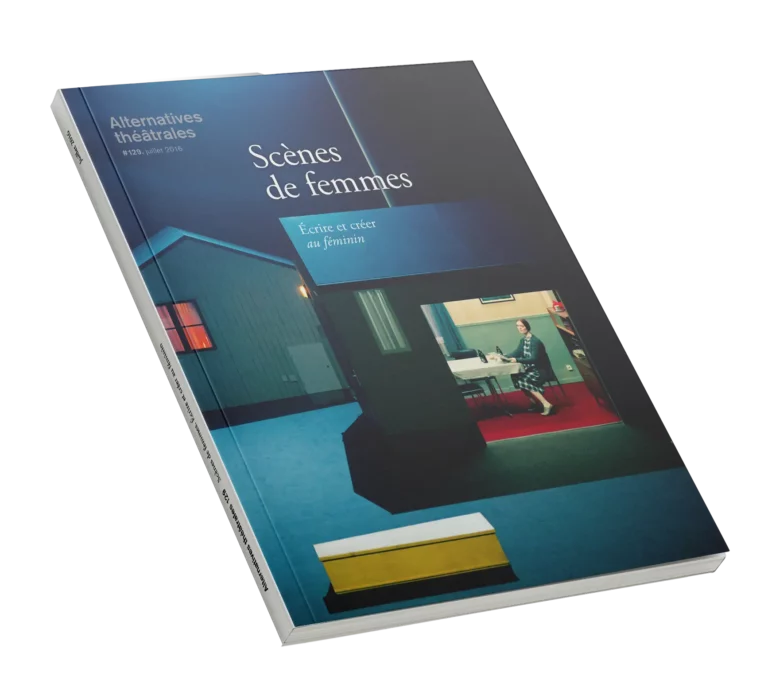En 2011, Vinciane Despret, philosophe des sciences à l’ULg et Isabelle Stengers, philosophe des sciences à l’ULB, publiaient Les Faiseuses d’histoires. Que font les femmes à la pensée ?, résultant d’un questionnement sur leur parcours et leur place au sein de l’université. Les perplexités, réflexions, résistances et propositions soulevées par cette question – et relayées par d’autres femmes – m’ont semblé pouvoir éclairer ce que les femmes font à l’art. Vinciane Despret a bien voulu m’accorder un entretien à ce sujet, à partir d’expériences créatrices croisées entre son domaine de recherche et celui des arts de la scène.
ID Chère Vinciane, quand on demande aux créatrices si elles créent en tant que femmes, la question suscite souvent des réticences : elles ne veulent pas être réduites à leur genre, elles sont d’abord artistes… La même controverse semble exister chez les chercheuses en sciences.
VD Oui, certaines ont revendiqué une science féminine, c’est-à-dire une science moins dans la maîtrise, plus attentive aux faits, plus suspicieuse à l’égard des théories trop générales. Mais d’autres ont réagi en disant que c’était la palme toute préparée pour le martyre puisque la science s’était constituée contre ces modèles « féminins ». Ces scientifiques-là se sont donc positionnées en affirmant que leur pratique différente n’avait rien à voir avec le fait d’être femme, mais avait à voir avec des raisons historiques, contextuelles. « Nous avons produit un meilleur savoir parce que nous sommes restées plus longtemps sur le terrain, mais si nous l’avons fait c’est parce que nous n’avions que des bourses et pas de postes à l’université ! » D’autres ont pris une troisième voie en se demandant ce que serait une science féministe, donc une science qui ne serait assignée ni à l’un ni à l’autre sexe, simplement méfiante à l’égard des manifestations du pouvoir et de l’idéologie qui imprègnent les théories et les pratiques, y compris le pouvoir que le scientifique s’arroge de devenir juge et maître de la nature.
On pourrait translater ces positions du côté des autrices : est-ce qu’une autrice est un auteur au féminin ? Dangereuse affirmation qui signifie que l’auteur serait le neutre, la norme, l’étalon dont l’autrice ne serait qu’une variation. Dire « nous écrivons comme les hommes » me semble aussi difficile à tenir, parce que ce n’est pas vrai, et quand bien même ce le serait, c’est un choix que les autrices font.
Comment la revendication du statut d’autrice peut-elle être autre chose qu’une assignation identitaire ou la reconnaissance d’une manière d’être ? Comment peut-elle être plutôt une incitation à d’autres formes de créativité, un programme ouvert autant aux hommes qu’aux femmes ? Dès lors, que voudrait dire non pas « être autrice » mais « devenir autrice » ? Prend-on des qualités féminines ou prend-on des qualités dont on ne définit pas qu’elles sont féminines mais simplement des qualités autres ? On est très proche de la voie féministe en procédant comme ça, puisque la voie féministe est une voie qui rejoue les catégories, qui les brouille, les trouble, les pervertit éventuellement… car répondre de manière symétrique à une assignation de catégories, ce n’est pas déstabiliser les catégories, c’est les sanctionner et donc les pérenniser.
ID « Création, créativité » sont des mots très présents dans ta pensée et ta pratique philosophique et scientifique. Te définirais-tu comme une « femme créatrice » ?
VD Dans mon dernier livre, Au bonheur des morts 1, j’ai développé une écriture littéraire et performatrice qui refuse tout statut d’explication, mais qui déplie des histoires, des hypothèses, et s’aligne le plus fidèlement possible à la manière dont les gens entrent en contact avec les morts. Comment les gens entrent-ils en contact avec les morts ? Par des régimes de sensibilité et de signes qui ne sont pas explicatifs… Et bien, je me suis mise dans la posture de répondre aux signes pour écrire. À la manière de l’artiste Sophie Calle, j’ai suivi pendant un an jour pour jour tous les conseils qu’on me donnait : « Lis tel bouquin, va voir ce thanatopracteur, regarde la série Six Feet under, etc. » Ça voulait dire me mettre en état d’obéissance à l’égard des événements, accepter de perdre la maîtrise de ce qui m’arrivait – ce qui correspond exactement à ce qui arrive aux gens quand un mort les interpelle : ils ne savent pas qui a la maîtrise de la situation et ils l’acceptent. Ça voulait dire aussi repérer les signes, par exemple deux mails arrivant le même jour, de la part de gens qui ne se connaissaient pas, mais où je percevais un point de connexion à chercher…