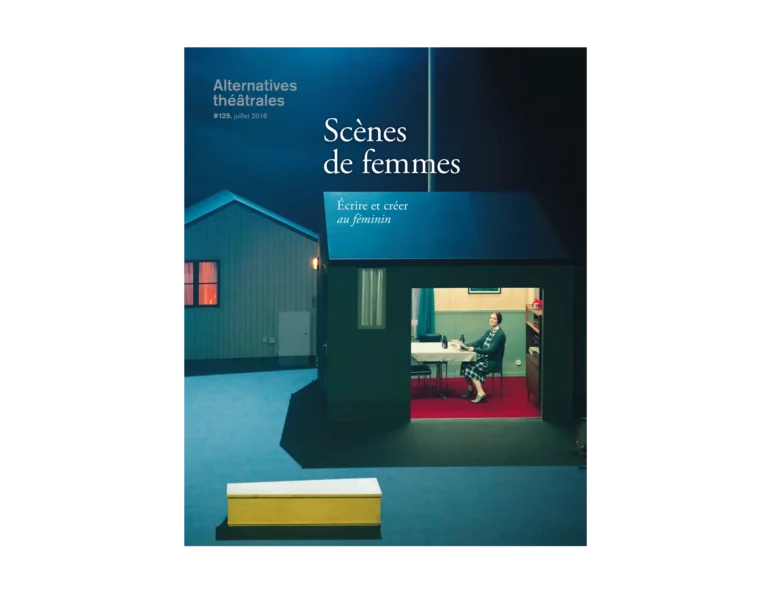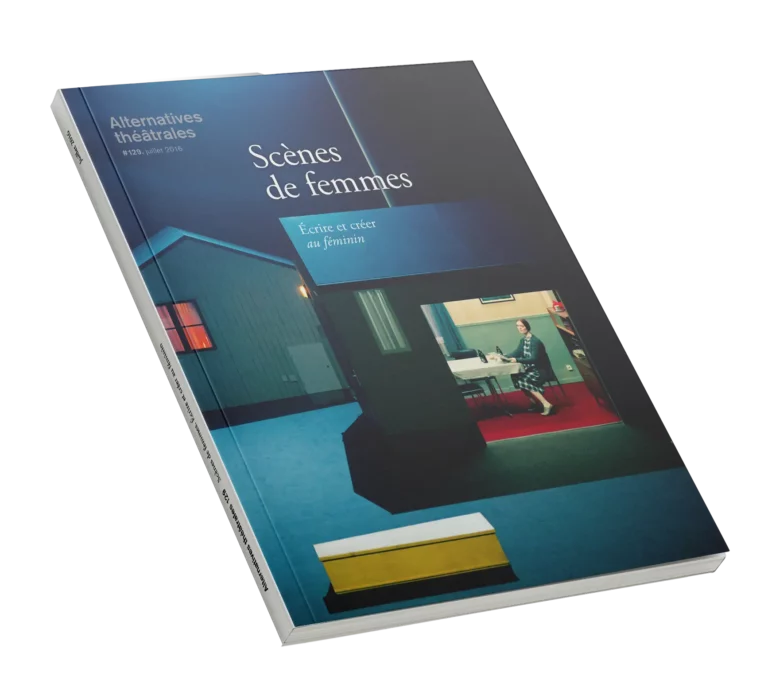La metteuse en scène et auteure Myriam Saduis adapte, en 2012, La Mouette de Tchekhov et signe La Nostalgie de l’avenir1 qui lui vaut le prix de la mise en scène aux Prix de la Critique en Belgique. Dans cette adaptation où s’entrecroisent Meyerhold, Fernando Pessoa, Philip Roth, Shakespeare, six comédiens engagent sur le plateau une énergie éclatante et une sensibilité aiguës pour le récit tragique d’une impossibilité d’aimer.
En 2015, avec sa compagnie Défilé, Myriam Saduis crée, en coproduction avec le Théâtre 95 à Cergy-Pontoise (Scène conventionnée aux écritures contemporaines) et le Théâtre Océan Nord à Bruxelles, Amor Mundi. Sur le plateau s’écrit l’histoire d’une nuit new-yorkaise durant laquelle Hannah Arendt fête avec ses proches la publication de son livre Les Origines du totalitarisme2, l’histoire d’une pensée en devenir, en action, en partage.
SD Ce projet est né d’une image que tu as eue : Hannah Arendt en train de danser, entourée de sa « tribu3 ». Hannah Arendt a écrit : « les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action ». En t’attachant à ce personnage, tu ne voulais pas créer un théâtre didactique mais un théâtre de la pensée en action.
MS Oui. La première image a été charnelle. Cette image dansante m’a traversée : elle cristallisait tout ce que j’avais pu appréhender d’Arendt. C’est, somme toute, l’idée nietzschéenne4 d’une pensée en mouvement car ancrée dans un corps5. Je voulais parler de ce qui précède la création, évoquer le cheminement plutôt que le résultat de la pensée. Arendt se distingue d’autres philosophes en ce qu’elle insiste sur le mouvement, le processus de gestation, en témoigne son Journal de pensée6. Pour cet être passionné, la pensée était toujours liée à l’expérience – au risque sinon de n’être que simple opinion. Ce « penser passionné », selon ses termes, esquissait dans mon imaginaire un personnage extrêmement théâtral.
SD Amor Mundi (l’amour du monde, le souci du monde), à travers la figure d’Arendt, résonne bien entendu avec notre actualité. Voulais-tu aborder la question de la féminité dans la démarche artistique ?
MS Je voulais dresser un portrait de cette femme rare. La jeune Arendt s’était préparée à traduire, commenter des textes grecs, vivre une vie de chercheuse. La guerre l’a déviée de ce projet. L’Histoire a fait d’elle une réfugiée. Cela a totalement fracturé ses perspectives. Cette rencontre avec l’événement me passionnait. Sa rigueur dans la réponse à l’événement historique, une singularité, une inflexibilité…, là se situe, à mon sens, le trait féminin (je suis une incorrigible lacanienne !). Lors de leur arrivée aux États-Unis, son mari a fait une dépression. Elle, elle apprenait l’anglais. Par ailleurs, Arendt ne réfléchissait pas en termes de genre. Elle n’est pas une figure féministe au sens strict. Elle ne se positionnait pas en philosophe mais en théoricienne politique. Ni féministe, ni philosophe, en quelque sorte. À un journaliste l’interrogeant sur le fait d’être la première femme à donner un séminaire de théorie politique, elle répondait : « Cela ne me dérange pas, j’ai tout à fait l’habitude d’être une femme ». Façon subtile de se présenter comme déjà émancipée, de ramener l’interlocuteur au vrai sujet : le séminaire politique, pas le genre de celle ou celui qui le donne. La singularité d’un/une artiste, ou dans ce cas d’une théoricienne politique, tient d’abord à son regard sur le monde dont la féminité fait partie mais ne recouvre pas tout. De même, mon travail de mise en scène tend à l’émergence d’une spécificité artistique plutôt qu’au « traitement féminin » d’un sujet.