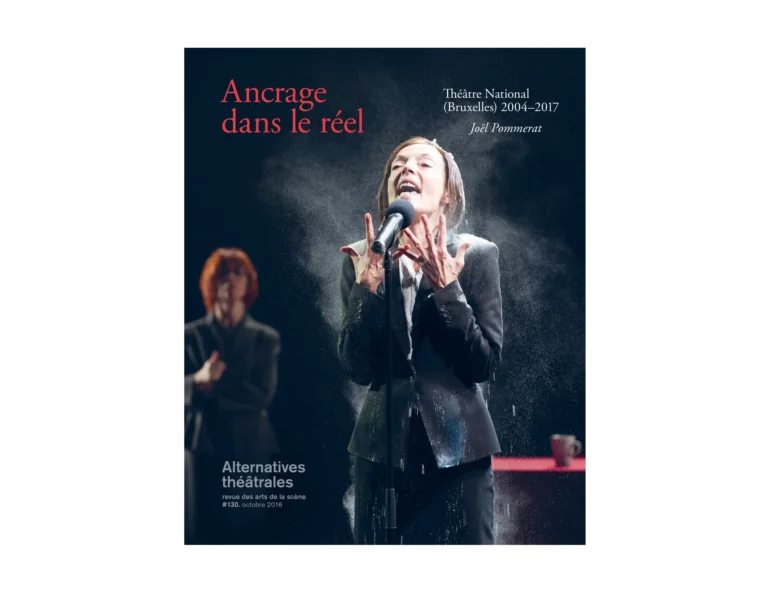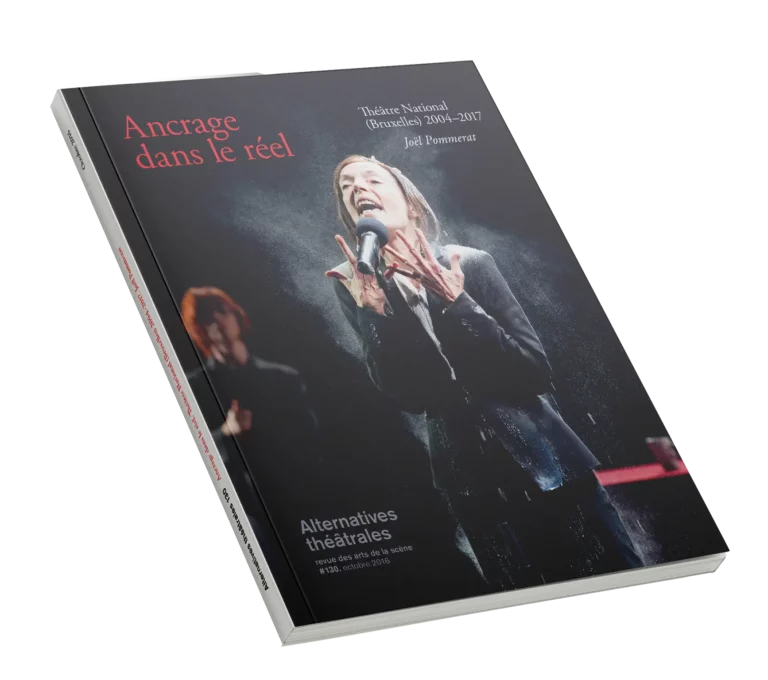Désordre d’un futur passé a émergé d’un premier renversement de l’ordre habituel des choses. Lorsqu’une activité artistique est lancée dans une prison, l’initiative vient presque toujours des intervenants artistiques ou de l’institution1. Ici, c’est Jean Ruimi, détenu à la prison d’Arles, qui a été le point de départ du processus de création auquel Joël Pommerat a pris part, en y étant à la fois au centre et au bord, en oscillant de manière permanente entre son statut d’artiste et une place d’accompagnateur. Il ne veut cependant pas se placer comme un nouvel expert suite à ce projet mené en détention : « Je ne veux pas que ça se cristallise trop vite, que cette expérience se mette en mots trop vite alors que je pense être encore dans une phase de découverte ». Au départ, Jean-Michel Gremillet2 le contacte pour lui parler du projet théâtral d’une personne détenue à Arles. Malgré une période très dense, il accepte d’en savoir plus, puis une rencontre avec Jean a lieu. C’est le début de cette création partagée, dans laquelle il va s’impliquer pendant plusieurs mois, en y associant également Caroline Guiela Nguyen3. Les deux metteurs en scène vont alors partager leur savoir-faire avec un groupe d’une dizaine de personnes détenues qui portent cette action artistique. Lorsque Joël Pommerat revient sur ce qui l’a convaincu, il parle avant tout de la détermination de Jean : « Ce qui m’a frappé, c’est cette détermination, ce désir, et d’abord ça a vraiment éveillé ma curiosité. Quand j’envisageais la possibilité d’une telle expérience un jour, je pensais que ce serait à partir de la proposition d’une administration ou d’une institution, quelque chose à la fois d’un peu vague et de très encadré, sous forme d’ateliers comme je sais que ça se pratique. Mais là, ça venait d’ailleurs, et ça allait ailleurs. Ce que j’ai perçu lors de la rencontre avec Jean, c’est une grande clarté, une grande détermination à faire un projet artistique, un projet de création, de théâtre, avec une volonté précise d’explorer une matière artistique, esthétique, collective. Il m’a parlé de son expérience aux Baumettes, avec une structure implantée dans le lieu de la prison (Lieux Fictifs), avec laquelle il a travaillé le cinéma, réalisé des court-métrages, et de ce qu’ils avaient initié avec d’autres détenus, en cours de promenade, ces improvisations ensemble4, ce désir de théâtre. J’ai entendu ce désir et même cette nécessité qu’il avait de poursuivre avec d’autres, poursuivre ce temps qui avait été pour lui un temps de liberté, ou plutôt par lequel il avait pu entreprendre la création d’un territoire qui déplaçait la notion d’enfermement. J’ai été touché, et j’ai senti que j’avais une possibilité de trouver une vraie place, un vrai rôle, d’accompagner quelque chose de très concret. J’ai cru en ce projet, parce que j’allais accompagner quelque chose qui était déjà en mouvement, j’allais entrer dans une dynamique en marche, suscitée par Jean. C’est une rencontre, un hasard, et face à la question de mon emploi du temps finalement, j’allais inventer des solutions parce que ça en valait vraiment la peine. Et on a commencé à travailler. Certainement, c’était pour moi la question de la nécessité même du théâtre et peut-être même de l’art en général que cela me permettait de me poser à moi-même et de déplacer. »
À raison de deux fois par mois, Joël Pommerat s’est rendu dans la maison centrale d’Arles, retrouvant ainsi la troupe que Jean avait constituée, en imaginant et fabriquant une nouvelle place, en remettant en question peut-être certaines zones de confort : « Dans ce travail, ce qui me fait certainement évoluer et bouger, c’est de revenir à un endroit de recommencement, et d’incertitude, un endroit sans habitude, sans modèle de progression préétabli. Il faut reformuler du langage commun avec mes partenaires. Redéfinir des buts et des objectifs, des nécessités. »
Jean parvient à former un groupe d’une grande diversité, alors qu’habituellement, en détention, une hiérarchisation s’opère en fonction de la nature des actes commis et de la durée des peines. Il semble avoir compris l’importance d’une logique de décloisonnement, avec, sans pouvoir le formuler peut-être, la conscience que ce sera un point d’appui pour mettre en travail la relation à l’autre. Si la pièce produite nous amène à porter un autre regard sur ces personnes au dedans, dans un dépassement des représentations dominantes de la figure du détenu, c’est aussi parce que le processus de création qui a conduit à cette œuvre s’inscrit dans un bousculement des places, des regards, des assignations. C’était d’ailleurs un risque que de jouer sur une mise en abîme centrale : la pièce a été créée en prison, et les personnes détenues jouent le rôle de détenus dont l’un d’entre eux a réussi à fabriquer une machine à voyager dans le temps qui ne va pas fonctionner comme ils le souhaitent, les amenant dans un camp de concentration pendant la seconde guerre mondiale au lieu de les projeter à la date où chacun serait libre. Des détenus interprétant des détenus, une prison mise en scène dans la prison, le danger d’un tel projet était de participer au renforcement de formes de fascination pour ces lieux et ceux qui y sont gardés. Le seul rempart à cet écueil semble résider dans la manière dont le chemin de fabrication se dessine et dans la précision des intentions.
Les temps de travail deviennent peu à peu des formes de brèches dans l’espace-temps carcéral. Les détenus obtiennent le droit de se réunir sans la surveillance directe de l’administration pénitentiaire5, dans un petit espace de répétition, et le processus se met en marche. Généralement confinées dans un statut unidimensionnel, et forcées à des mises en scène d’elles-mêmes permanentes, dans un enchevêtrement de tactiques de survie et de stratégies adaptatives, les personnes détenues font alors l’épreuve d’une autre histoire possible. Celle d’un groupe, de trajectoires singulières qui se retrouvent dans un collectif, d’un ensemble d’effets de contamination de désirs et de nécessités qui ont rendu possible le fait de créer dans des formes réinventées du sens de l’altérité6.