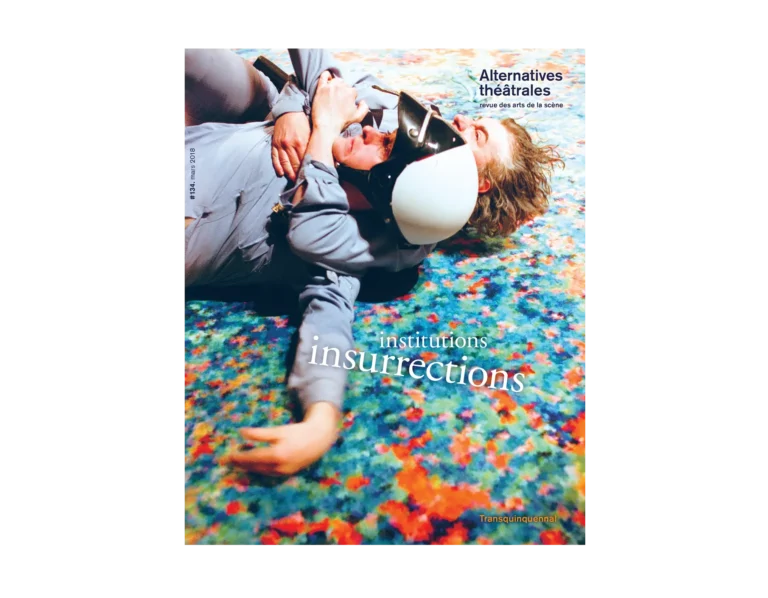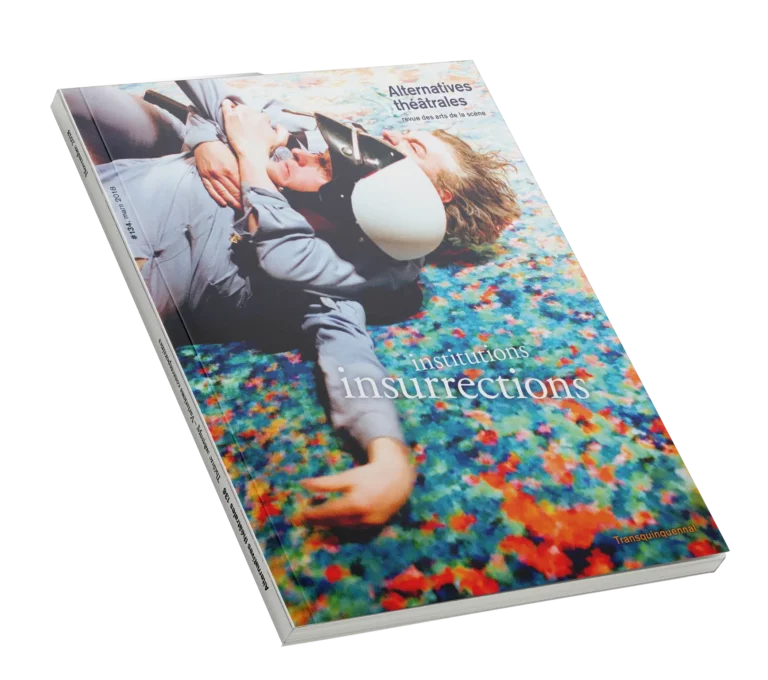Révélation au Festival d’Avignon 2017 avec Ibsen Huis (La Maison d’Ibsen), l’Australien Simon Stone élargit la génération des Christiane Jatahy et Julie Deliquet qui renouvelle une écriture de plateau à partir de textes dits classiques. L’actualisation n’y a pas la même veine politique que chez Thomas Ostermeier. La transposition dans le XXIe siècle se polarise sur l’adresse à un public contemporain, et c’est par de larges détours qu’elle touche paradoxalement le centre névralgique du texte.
Pour ses Trois Sœurs, Simon Stone explicite cette adresse avec Tchekhov : « susciter chez chaque spectateur un certain sentiment de sa propre vie métamorphosée en comédie ou en drame ». Lorsqu’il se tourne vers les Grecs, il s’inscrit dans la lignée des réécritures des grands mythes. Avec Medea, il monte Euripide en lien avec un fait divers américain des années 1990 : qu’est-ce qui peut pousser une femme d’aujourd’hui à commettre un infanticide ? Sa Médée est aussi Debora Green, qui tua deux de ses trois enfants en incendiant sa maison après avoir tenté d’empoisonner son mari. Dans l’agrégat de ces matériaux naît son théâtre du présent.
Objet singulier, Ibsen Huis invente une histoire originale à partir de plusieurs pièces. Connaisseur d’Ibsen pour l’avoir mis en scène plusieurs fois, notamment avec La Cane sauvage dont il a tiré le film The Daughter, il offre ici une variation autour de situations, de thèmes et d’atmosphères également inspirée par la vie de personnes qu’il connaît, des gens d’aujourd’hui qui font, selon lui, partie du « bestiaire » d’Ibsen. La personnalité des acteurs dans le jeu est à son tour moteur de son écriture. Il en ressort une dramaturgie exemplaire, à la fois moulée dans un matériau préexistant et d’une facture totalement libre. Cette construction-déconstruction- reconstruction offre aux spectateurs un espace d’interprétation vertigineux – au-delà du noyau référentiel de l’œuvre d’Ibsen.
Ibsen Huis a l’apanage d’un montage qui rive la scénographie à la dramaturgie. Au centre du plateau, la maison s’impose, l’ère de jeu devient matrice de la tragédie. Le regard y pénètre à travers des baies vitrées ; la maison installée sur une tournette s’offre sous toutes ses facettes. Ce mouvement circulaire se répercute sur le temps : l’histoire se déroule à différentes époques, des années 1960 à 2016 le spectacle est un incessant va-et-vient entre des moments clefs de l’« existence » de la maison – et de celles des membres de la famille. Hormis elle, il n’y a aucune figure centrale, l’interchangeabilité des acteurs, qui prennent en charge un même personnage à plusieurs âges, renforce cet état de fait.
Tout commence, ou presque, par les préparatifs d’une fête familiale à l’occasion d’un prix honorifique que le père architecte reçoit pour cette construction innovante. Le prétexte de ces retrouvailles est un idéal intenable tant il y a de « squelettes dans l’armoire » pour reprendre Régis Boyer. La situation bienheureuse avec « ces gens bien installés, le décor bien planté » débouche sur des passés obsédants qu’ils s’efforcent de dissimuler. « Dès lors, explique-t-il à l’égard d’Ibsen, le travail du dramaturge est de faire apparaître cette tare ou cette faille, de l’amener à se manifester au grand jour et, de la sorte, d’infecter littéralement la situation jusqu’au point où elle ne sera plus acceptable : telle est la tragédie “ibsenienne” ». Ce dévoilement est dans le spectacle démultiplié, les nombreuses « failles » prolifèrent dans les histoires imbriquées.