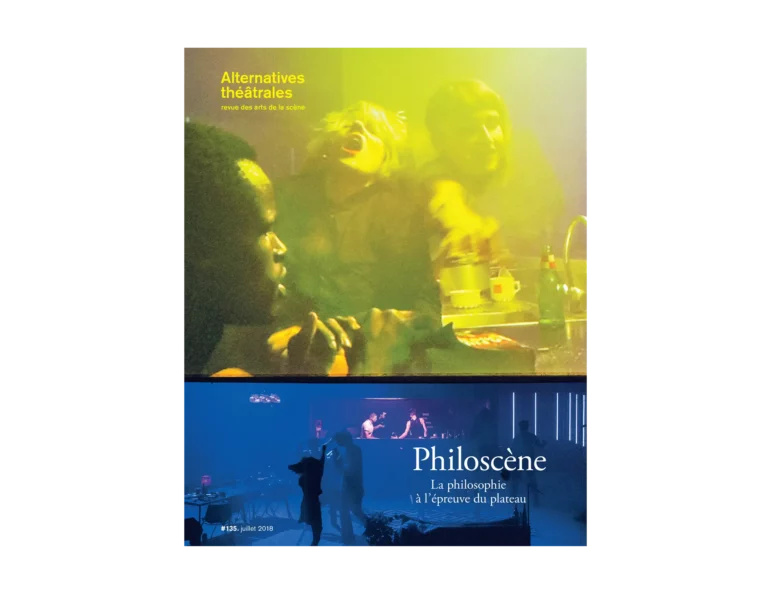Journaliste et responsable des pages « Idées-Débats » du Monde, Nicolas Truong s’interroge depuis de nombreuses années sur les relations entre la scène et les idées. En 2002, il met ainsi en scène La Vie sur terre, adaptation théâtrale de textes issus de la pensée critique, dont les Essais, articles et lettres de George Orwell (Ivréa/L’Encyclopédie des nuisances, 1995 – 2001). En 2012 et en 2013, il crée au festival d’Avignon Projet Luciole, puis, en 2016 toujours au festival d’Avignon, Interview avec Nicolas Bouchaud et Judith Henry. Fondateur de la revue Lettre(1989– 1993), responsable des « Controverses du Monde » au festival d’Avignon, Nicolas Truong est notamment l’auteur, avec Jacques Le Goff, de Une histoire du corps au MoyenÂge (Liana Lévi, 2006) de Résistances intellectuelles (L’Aube, 2013), Le crépuscule des intellectuels français (L’Aube, 2016), Philosophie de la marche (L’Aube, 2018) et a réalisé plusieurs ouvrages d’entretiens, parmi lesquels Éloge de l’amour (avec Alain Badiou, Flammarion, 2009), Éloge du théâtre (avec Alain Badiou, Flammarion, 2013), Ma philosophie (avec Stéphane Hessel, L’Aube, 2013), Le Sens de la République (avec Patrick Weil, Grasset, 2015) ou La Tentation du Bien est beaucoup plus dangereuse que celle du Mal (avec Boris Cyrulnik et Tzvetan Todorov, L’Aube, 2017).
Quentin Amalou : Pourquoi, de Projet Luciole à Interview, avez-vous choisi de faire du théâtre avec de la philosophie ? Et qu’appelez-vous « théâtre philosophique » ?
Nicolas Truong : Cela faisait longtemps que je pensais que l’on pouvait faire du théâtre avec de la philosophie, non pas en adaptant une œuvre du corpus philosophique, comme un dialogue de Platon, ce qui se fait souvent en raison de son apparente proximité avec un texte dramatique, mais en partant précisément des textes concep- tuels eux-mêmes, parfois les plus ardus, afin d’en prélever des extraits qui, collés et montés, permettent d’en faire entendre la théâtralité. Ma lecture de la philosophie moderne et contem- poraine m’a conduit à comprendre que non seule- ment les philosophes se répondaient, mais qu’ils résonnaient entre eux à travers une langue, une couleur, un ton qui leur est propre. Les textes des philosophes me font l’effet des Voyelles de Rimbaud (1871) : « A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu ». A, comme la prose philologique de Giorgio Agamben ; B, comme la poétique de la catastrophe de Walter Benjamin ; R, comme la joie tragique de Clément Rosset ; O, comme la littérature politique élevée au rang d’œuvre d’art par George Orwell… Je voyais les analogies, les correspondances, les différences, les divergences et surtout comment tous ces textes pouvaient composer ensemble un livret pour un opéra philosophique. C’est ainsi que j’ai imaginé une dispute entre Guy Debord et Jacques Rancière, des accords majeurs entre la pensée du désastre de Walter Benjamin et celle de la destruction de l’expérience chez Giorgio Agamben, des désaccords mineurs entre celle de Jean Baudrillard et d’Annie Le Brun. Le théâtre philosophique consiste souvent à faire du théâtre avec de la philosophie, sous forme de fragments ou de plus longs raisonnements, mais il est également et peut-être surtout pour une façon de faire penser avec le théâtre. C’est pourquoi Interview, réflexion sur l’étrange théâtre de la parole qu’est l’entretien médiatisé, s’inscrit dans ce projet.
QA Gilles Deleuze parlait, dans les années 1970, de « pop’philosophie », et imaginait une philosophie qui soit accessible à la manière de la musique pop. C’était aussi votre idée ?
NT Loin d’une « pop philosophie » souvent réduite à l’interprétation philosophique de la culture populaire, qu’il s’agisse des tubes ou des séries télévisées, Gilles Deleuze l’entendait comme une invention de concepts qui doivent être essayés, comme « des intensités qui vous conviennent ou non, qui passent ou ne passent pas », que l’on branche à différents plateaux, aussi bien à la culture classique qu’à la botanique, à la culture populaire qu’à la géographie, aussi bien à Henri Bergson qu’à Bob Dylan : « Professeur, je voudrais arriver à faire un cours comme Dylan organise une chanson, étonnant producteur plutôt qu’auteur. Et que ça commence comme lui, tout d’un coup, avec son masque de clown, avec un art de chaque détail concerté, pourtant improvisé », disait-il. Ainsi je crois qu’il est possible de faire du théâtre comme les Mille plateaux de Deleuze et Guattari, avec des « machines de guerre », des « ritournelles » et des « lignes de fuite ». Et pour cela, il fallait, sur le plateau, non pas un couple, mais un duo en pleine « noces », deux singularités qui tracent ensemble « un devenir ». Faire du théâtre avec de la philosophie est « pop philosophique » en ceci qu’on peut rendre la philosophie à la fois populaire et théâtrale, grâce au collage, au cut-up, au pick-up, à la tragédie comme au stand-up.