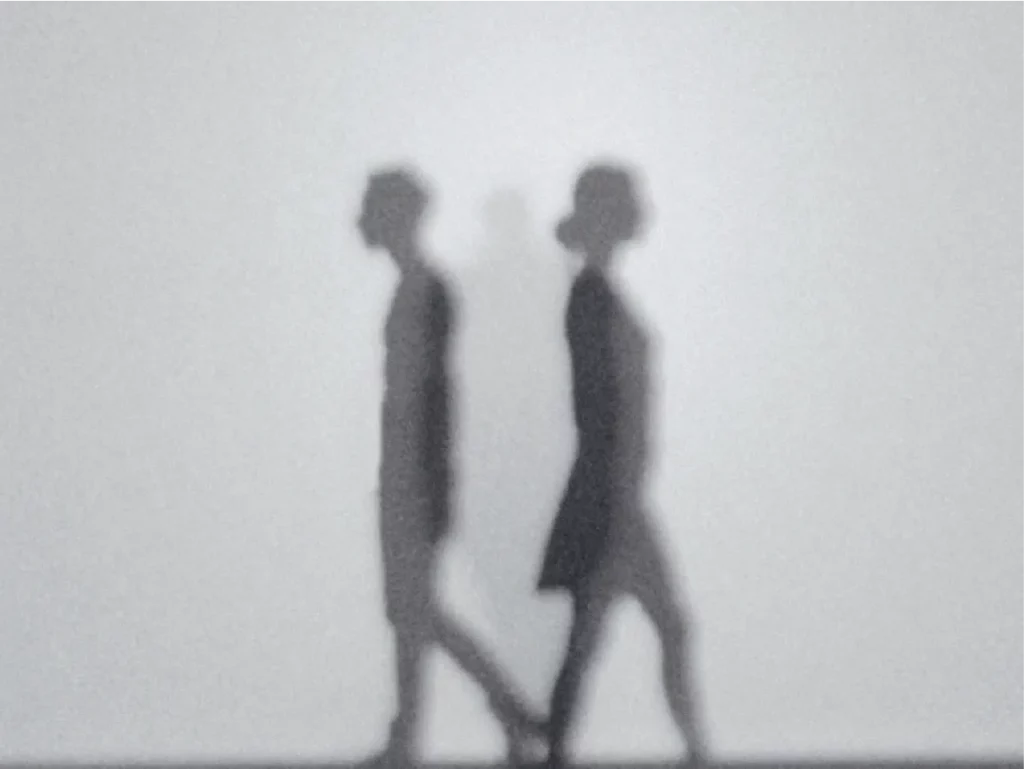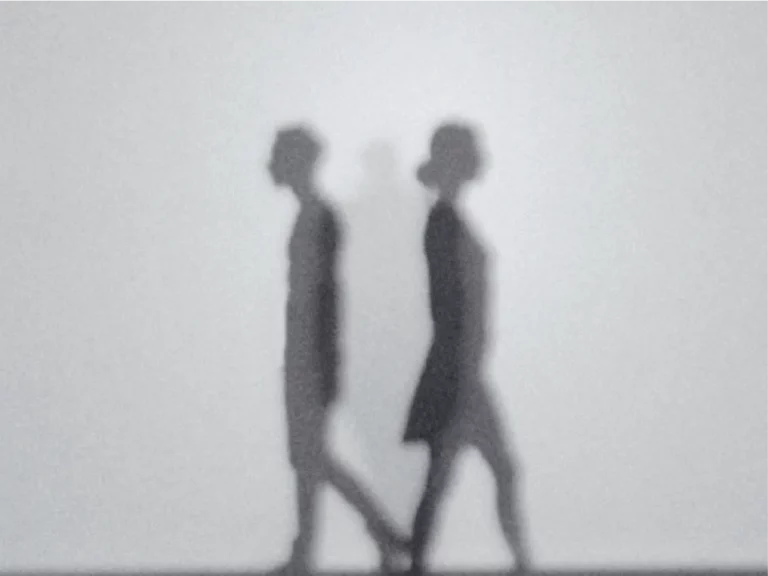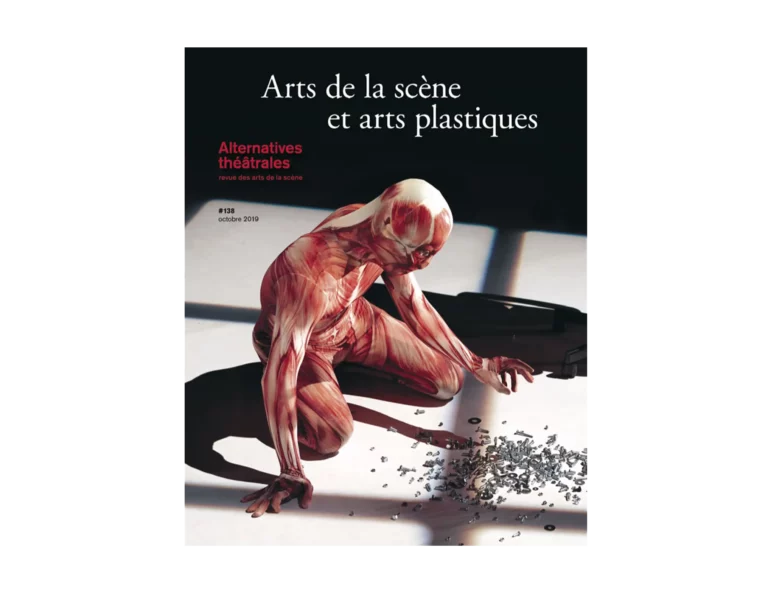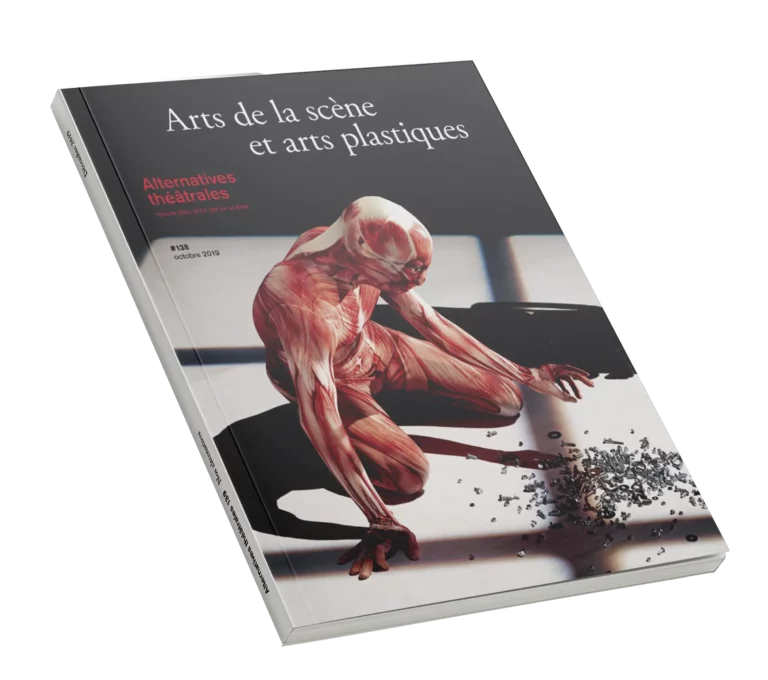Sylvie Martin-Lahmani — Pourrais-tu nous dire, José-Manuel, d’où te vient le désir d’accueillir au centquatre-paris des oeuvres aux formes hybrides nées de l’union des arts plastiques et scéniques ?
José-Manuel Gonçalvès — Je m’intéresse aux oeuvres « pluri » ou « multi » en général. Je suis d’abord attiré par la modernité d’un art ou d’une forme. Mon rapport au théâtre est déterminé par mon rapport à la cité. Je m’intéresse à un théâtre qui se frotte à d’autres formes d’art contemporain et qui raconte un monde. Le théâtre m’a permis d’observer la vie différemment. C’est un endroit qui aspire la société et qui m’inspire. J’ai toujours aimé le confronter à d’autres formes artistiques (plastiques, chorégraphiques…), et observer la coagulation qui s’opère entre celles-ci, entre leurs fonctions pédagogiques, symboliques et critiques…
Sylvie Martin-Lahmani — Quels sont tes premiers souvenirs scéniques et plastiques marquants ?
José-Manuel Gonçalvès - Les Heures blanches1, mis en scène par Didier Bezace et Jacques Nichet, avec des décors et costumes de Yannis Kokkos, ont été un véritable choc pour moi. Ce spectacle parlait d’un homme en train de suivre une psychanalyse, en dialogue avec son thérapeute. Tout se passait sur le plateau autour d’une Fiat 500. Un corps métallique représentant la société de consommation et un corps-cerveau essayant de survivre et de trouver sa place dans le monde. Je garde le souvenir d’une forme épurée plastiquement, et d’un comédien hors norme, Didier Bezace, abordant des questions de psychologie et de sociologie urbaine qui m’importent. Ce spectacle m’a permis d’évacuer l’idée qu’un spectacle doit passer par la réflexion ou l’émotion. Quand on vient d’un milieu populaire comme moi, c’était rassurant de savoir qu’on pouvait ressentir une oeuvre et tenter de lui donner du sens avec son bagage culturel, quel qu’il soit.
Les oeuvres scéniques qui m’ont le plus touché, associent souvent les arts visuels à une scénographie épurée. J’ai été très influencé par les créations de William Kentridge et notamment Ubu tells the Truth, mais aussi par l’artiste peintre portugaise – dont je partage la culture –, Maria Helena Vieira Da Silva. Au sens littéral : son travail m’a tapé dans l’oeil, battu au coeur et permis de réfléchir. Sa manière de livrer bataille entre figuration et abstraction a forgé mon regard. Sa façon de donner du mouvement dans ses toiles (plutôt que de la profondeur) m’a rapproché de la scène. J’ai aussi été profondément frappé par l’oeuvre de Patrice Chéreau, pétri par la musique jazz…
Dès mes débuts de programmateur il y a plus de trente-cinq ans, j’ai cherché à associer le théâtre et la musique avec les arts plastiques, à donner une dimension visuelle à l’espace public. Je pense en termes d’« urbanisme culturel ».



Sylvie Martin-Lahmani — Au centquatre, vous accueillez aussi bien des spectacles que des grandes expositions. Qu’est-ce qui t’intéresse dans l’évolution de l’art contemporain ces dernières années ?
José-Manuel Gonçalvès — Je m’intéresse notamment à la manière dont ils s’adressent au public. Les arts plastiques, contemporains ou visuels, ont longtemps ignoré le rôle du public. Comme s’ils pouvaient uniquement se développer grâce à un réseau de professionnels, de critiques et grâce à une économie, sans le regard des spectateurs-visiteurs ? Je ne veux pas dire que les artistes ne voulaient pas de public, mais cette confrontation ne semblait pas essentielle. Est-ce qu’au final, en se libérant de cette contrainte du public, on est plus créatifs ? J’ai répondu à certaines de ces questions de manière plus ou moins contradictoire depuis que j’exerce ce métier. En tout cas, force est de constater que l’arrivée de l’art contemporain dans des lieux emblématiques, comme Jeff Koons au Château de Versailles, ou l’avènement de manifestations comme Nuit Blanche où l’art contemporain investit la cité à grande échelle, ont modifié ce rapport. Depuis une vingtaine d’années, la fréquentation massive du public joue sur la notoriété de l’artiste. Sa réception agit directement sur sa cote. L’arrivée de l’art contemporain dans l’espace public (« ouvert », le théâtre étant aussi un espace public « fermé), est entré en concurrence avec des formes de théâtre dites de rue. L’un des échecs du théâtre de rue, me semble-t-il, est dû au fait que l’art contemporain devient un art public (et donc populaire) au même titre que celui-ci, et qu’il n’est pas porté par l’intelligentsia qui accompagne l’art contemporain.
Sylvie Martin-Lahmani — Contrairement à des nombreux lieux de programmation qui se concentrent sur la présentation de spectacles − par choix ou par contrainte architecturale −, le centquatre-paris semble ouvert à toutes les disciplines scéniques et plastiques, et surtout avide de rencontres insolites.
Julie Sanerot — Nous ne réfléchissons pas par discipline. On n’invite jamais des plasticiens, sans songer à les emmener aussi ailleurs, à leur présenter d’autres artistes, d’autres univers et formes… En fait, tout le projet du centquatre repose sur l’idée d’un décloisonnement permanent : on choisit vraiment des artistes qui proposent un projet multiforme ou multi-matériaux, et la forme finale apparaît au fil des résidences, des installations…