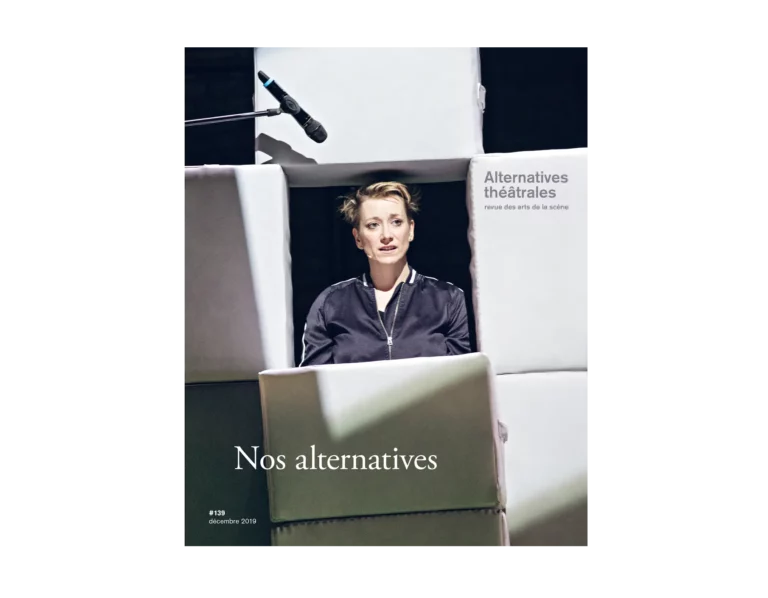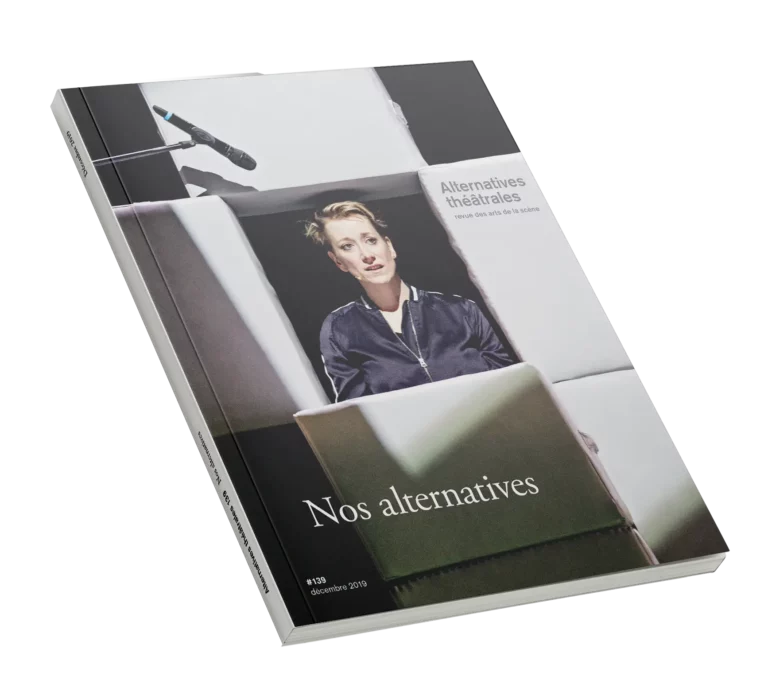Dans sa pièce Café des Patriotes, créée en 1998, l’auteur, Jean-Marie Piemme, met en scène un journaliste, Gianni Gorda en lutte contre l’extrême-droite incarnée dans la fiction par Willy Dewolf, le patron du Café des patriotes, et Lesca, intellectuel homosexuel, sorte de tête pensante de la mouvance ainsi que par plusieurs autres personnages manifestant une sorte d’acquiescement passif. Toute l’ingéniosité de l’auteur consiste à tisser, entre ses personnages, des liens interpersonnels ramenant ainsi un « fléau de société » à un petit monde commun pour y faire voir, comme à la loupe, les mécanismes à l’œuvre dans cette prise de position : Gorda est le compagnon de Claudia, fille d’Yvonne, elle-même serveuse dans le café de Willy qu’elle respecte voire admire. Entre tous ceux-là, Piemme déploie des antagonismes idéologiques qu’il mène jusqu’à leur point d’orgue en montrant leurs effets politiques (Dewolf est élu député), sociaux (Gorda est assassiné), personnels (Willy est quitté par Carmen) et même symboliques, quant à la valeur de l’héroïsme notamment (Lesca accusé s’avère trop lâche pour se tuer). Mais les personnages en scène ne sont pas seulement les signes de positions dans la société. Piemme amène bien au-delà – ou en deçà –, vers des corps pris dans des luttes et des enjeux sociaux au sein desquels ils ont à se situer. Ce que donnent à voir tous les personnages, c’est qu’il n’y a pas d’en-dehors possible : le corps même est inscrit dans la trame du social, le corps est social1. Par exemple, quoi que tente Yvonne pour chercher à s’extraire des luttes qui s’attisent autour d’elle et proposer une voie les transcendant, instinctivement, elle prend parti et, guidée par ses émotions, elle affirme sa position de soumission à la force mâle du leader. Tous les personnages finissent ainsi par être délestés de toute psychologie et de tout sens philosophique pour être dessinés comme des espaces de pulsions qui les constituent bien plus sûrement que d’autres caractéristiques. Au final, sous l’effet de l’alcool, Yvonne libère sa libido et trouve en Freddy, l’homme à tout faire de Dewolf, un partenaire fonctionnel, lui-même n’étant montré, d’un bout à l’autre de la pièce, guère animé d’autre motivation que l’assouvissement de ses pulsions primaires :
YVONNE
J’ai bu l’élixir. Je vole. Freddy, j’ai encore de l’amour sous mes rides, je voudrais tellement le donner !
FREDDY
Viens, je vais te les bouffer tes rides.
Je suis le genre d’homme qui s’occupe de tout.2
Toutefois, c’est sans doute le personnage de Gorda qui cristallise une dimension inattendue quant au politique. Journaliste engagé, Gorda mène par sa plume un combat acharné contre l’extrême-droite et se donne littéralement à corps perdu dans la révélation d’informations sur un de ses maîtres à penser. Or, d’un tel personnage, à première vue héroïque, l’auteur tend à faire une figure quasi pathétique. C’est que Gorda fait littéralement corps avec sa cause n’ayant d’autre ressource identitaire. Et chez Piemme, c’est à nouveau par le corps que se montre l’aporie : Gorda boit, il geint et tout un gestus construit un personnage affectivement désœuvré, un être perdu. Ainsi, lorsqu’enfin il réussit à atteindre sa cible et à confondre Lesca, il jubile surtout parce qu’il donne enfin la preuve « qu’il n’est pas rien »3. Au fil du texte, les manifestations corporelles prolifèrent sur la scène publique. Or, pour des personnages tenant par leurs discours des positions symboliques et culturelles aussi nettes (engagement politique à gauche ou à l’extrême-droite), on attend communément que ces signes envoyés par le corps soient relégués en coulisses, restreints à la sphère privée. En mettant progressivement les dimensions pulsionnelles en pleine lumière, Piemme percute l’imaginaire social commun du corps4. Aux corps façonnés pour avoir une contenance sociale, il substitue des individus comme gouvernés par leur corps. Et contre l’opposition si commune de l’individu à son corps, l’auteur propulse en scène un homme concret, non plus constitué de principes différents mais unifié : une corporéité sociale. En l’occurrence, laisser progressivement saillir, sous la figure positive du journaliste engagé, un individu faisant si intrinsèquement corps avec sa cause politique qu’il finit par s’y sacrifier, ne va pas sans questionner l’engagement politique. À la manière brechtienne, Piemme laisse le public réfléchir, voire décider. Mais il a pris soin d’établir un parallèle entre les deux adversaires et au « corps perdu » de Gorda répond la lâcheté de Lesca échouant à se suicider :
JULIEN
Vous suez ?
Voulez-vous que je vous fasse une théorie ?
Avec une théorie c’est toujours plus facile.
Lesca lève son arme puis la laisse tomber.
LESCA
Je ne peux pas.
[…]
JULIEN
Nous traversons des heures difficiles,
mais à cet instant, je suis particulièrement satisfait
de moi. Je viens de vous apprendre quelque chose :
une certaine lâcheté de l’homme devant ses idées.
(Sirènes de police.)
Voilà, je vous laisse à la justice et à la prison5.
L’auteur se maintient au poste qu’il s’est choisi et promène un regard ironique sur notre société. Il cible particulièrement le sérieux de ceux qui oublient que la vie sociale est avant tout un jeu6 et que, peut-être, il serait salutaire d’y garder un peu de distance tant ce jeu peut fluctuer et ses règles varier au gré des rapports de force qui s’instaurent.
Le corps, écrit David Le Breton, est « l’axe de la relation au monde » en ce qu’il est une « forme façonnée par l’interaction sociale7 ». Et c’est bien cette conception de la corporéité socialement construite qui guidera le renouvellement de tout un théâtre politique en Belgique à la fin du xxe siècle, lorsqu’une voie de réponse s’esquisse à la question qui taraude le Jeune Théâtre des années 1960 – 1970, celle de l’individu et de son articulation au groupe social. Ère de l’individualisme oblige – quand bien même perçu de façon critique –, le primat du groupe social (la classe) sur l’individu, central dans l’approche marxiste, rigidifie dangereusement une analyse critique et politique qui veut intégrer dans son mouvement les cadres de perception du moment contemporain. Ainsi, en 1984, Piemme écrivait-il que le théâtre de Brecht « fait écran à certaines perceptions du réel, plus microscopiques, plus privées, plus singulières »8 et pointe, dans cette optique, « la cécité du marxisme à l’égard de la question du sujet9 ».
Dès lors, ce que vont explorer des artistes, tels Piemme et Louvet en Belgique ou Koltès et Chéreau en France, en quête de renouvellement des formes critiques du théâtre, c’est comment, ainsi que l’écrit Le Breton, « parallèlement à la parole, les mouvements du corps contribuent à la transmission sociale du sens »10. Piemme creusera ce sillon en investissant notamment la voie du grotesque qui lui permettra d’amener à la lumière toute la part « obscène » du sujet que la norme morale occidentale refoule dans la sphère privée et dont il fera précisément le lieu d’ancrage du social en l’individu et de l’individu dans le social. Bien sûr, enchâsser ainsi « le caractère social de la corporéité » (Le Breton) dans le jaillissement du pulsionnel signe la prise de position de l’auteur. Mais, sous l’ironie, sous ce clin d’œil au public qui invite à ne pas être dupe du processus du grossissement ainsi à l’œuvre, Piemme fait davantage qu’affirmer la théâtralité, le jeu : il réinscrit « l’homme incarné » (Le Breton), corps individuel et social tout à la fois, au cœur du projet de théâtre politique.
De fait, cette écriture du sujet ouvre un champ d’exploration très vaste car elle fait de la corporéité un espace du social à part entière. Par delà le modèle biologique encore largement dominant, tenant la condition sociale comme un produit du corps, mais a contrario également de toute une mouvance au sein du « théâtre du corps » prenant celui-ci comme un en-soi, coupé, isolé des autres comme de la personne qu’il incarne, l’inscription de la corporéité dans l’élaboration de tout un théâtre politique permet aussi de dépasser le modèle déterministe. Quand Piemme focalise progressivement l’attention sur le pulsionnel au cœur du sujet, ce n’est évidemment pas pour en déduire une fatalité, une implacable destinée humaine. C’est bien plutôt pour laisser voir combien même la pulsion la plus primaire est sociale puisqu’elle façonne les corps et leurs interactions en société : « nous réagissons par les sens les uns aux autres », écrit Le Breton citant Simmel11. Or, si le corps se livre comme une construction sociale et culturelle, il devient possible d’agir sur lui. Et, contrairement à l’acquiescement de certains sujets à l’enfermement pulsionnel, un effort mental, voire culturel, permet une mise à distance et une transformation de la réaction envers autrui comme de la relation au monde :
CLAUDIA
Vous faites quoi dans la vie ?
LHOMME
Je suis écrivain.
CLAUDIA
Et vos ennuis, c’est à cause de ce que vous écrivez.
LHOMME
Si on veut. Le très haut n’aime pas la concurrence et ceux qui servent le très haut encore moins. Moi, ça ne me convient pas. J’ai une voix, je veux qu’on l’entende. Mais j’aurais pu être berger à la campagne ou ingénieur à la ville ou journaliste ou garçon de course. La guerre civile abolit les privilèges : égalité des gorges devant le rasoir. J’ai dû rapidement mettre la mienne à l’abri.
[…]
CLAUDIA
Quitter son pays est un privilège.
Prendre l’avion est un privilège. […]
L’HOMME
J’aurais peut-être dû mourir ? Mort, est-ce que j’aurais eu droit à votre sympathie ? Pourquoi est-ce que je m’accroche à la vie ? Je déçois votre sens de l’héroïsme ? Je ne suis pas un martyr ? On ne peut pas s’apitoyer sur moi ? Oh, je suis désolé !!! Qu’allez-vous penser de moi ? Que je suis un rat planqué au fond de votre pays ? Oh, j’en ai de la chance, n’est-ce pas ? Je suis traité comme une merde par vos concitoyens, sans papier, sans famille, manœuvre au noir sur les chantiers, formidable ! Et je me porte bien, c’est embêtant, ça ! J’ai aussi deux cicatrices. Un coup de couteau dans le thorax, l’autre dans le dos. Vous voulez les voir, mes cicatrices ? Je vous les montre ? Ca me fera peut-être remonter dans votre estime ?12
Avec le motif de l’écriture, s’impose ici le travail du symbolique, la médiation d’un système symbolique dont tout un théâtre va explorer le potentiel politique. Le symbolique politique présuppose un ancrage, un lieu, un point de vue à partir desquels se développe un mouvement pour s’élever à une dimension plus générale. Et ce mouvement de construction d’une alternative implique aussi une temporalité spécifique, une « étendue temporelle ».
Corps dans la mondialisation
Or, sous l’effet de la mondialisation, cette voie de recherche d’un théâtre politique semble fortement concurrencée par une autre façon d’envisager le corps. Tout un théâtre – celui que l’on retrouve sur les « grandes » scènes internationales et dans les « grands » festivals – en effet se mondialise, ce qui signifie que la circulation internationale devient la condition première de la production.13 De plus en plus, en Europe, les institutions théâtrales sont conduites à diversifier leurs sources de financement et nombre d’entre elles élaborent des projets internationaux afin d’obtenir des subsides européens. En s’imposant, cette modalité de la production s’érige en véritable critère de valeur, confinant d’ailleurs à la visibilité médiatique. Ceci produit des conséquences déterminantes sur les sujets et les objets pris en charge par le théâtre ainsi que sur les formes mobilisées.
Ces conditions amènent nombre d’artistes à transcender les barrières linguistiques et culturelles, et notamment à travailler l’effet de présence du corps sur le plateau. Le personnage s’efface et, à travers les figures qui peuplent les scènes, ce sont les corps qui se livrent sans la médiation d’une représentation, dans l’absolu de leur être-là, en soi et pour soi. L’être présent perd alors sa valeur de signe, il devient une manifestation du vivant, un phénomène, qui, à première vue, guide la réception du spectateur vers un modèle strictement sensible. La pure présence sur scène semble s’abstraire de la construction préalable d’un regard, d’une vision. Le discours critique surenchérit sur le contact direct, sur la relation physique et réfère abondamment au « partage du sensible » commenté par Jacques Rancière. Pour d’aucuns, cette expérience quasi exclusivement sensorielle et émotionnelle relèverait en soi d’une forme du politique laissant au spectateur la pleine construction du sens, des significations, désormais libres et non préconçues par l’artiste. Ce travail de la présence éclipse en effet le temps long, celui de la perspective et du projet. Le spectateur est installé dans une expérience dont les tenants et les aboutissants semblent s’effacer, pour se circonscrire entièrement dans le temps du contact avec l’artiste.
On voit alors des artistes comme Romeo Castellucci, Pippo Delbono ou Jan Fabre proclamer leur déni des idéologies. Or si, dans ces théâtres, le corps « s’absolutise »14, les positions respectives des artistes, données à lire à travers leurs œuvres et leurs déclarations publiques, laissent cependant apparaître un souci du monde. Comment donc cette visée plus collective s’élabore-t-elle à partir du moment où le corps en scène se revendique d’une « autoréférentialité »15 impliquant un « sens en retrait » ou en « suspension »16 ?
Chez Jan Fabre, le désastre est au fondement et il détermine les corps sur le plateau : « Notre monde est brisé comme un miroir, il est en mille morceaux », s’exclamait l’artiste en 200517. La société est d’emblée disqualifiée et les corps sur scène disent un homme perdu et impuissant. Mais Fabre va substituer un homme nouveau à l’homme social moderne dont le corps entrait en interaction avec les autres corps sur le mode du dialogue ou sur celui du conflit. Sur scène, les acteurs parlent peu et ne dialoguent pas, ils font, défont et refont l’espace avec leur corps. L’homme, le sujet, paraît ainsi enfermé dans ce corps et enclos dans l’espace sans possibilité d’échappatoire. Tout semble contraint dans l’ici et maintenant, nul horizon ne se dessine. Le corps s’affirme dans sa matérialité la plus brute (le sang, les humeurs sont omniprésents chez Fabre) mais est coupé du sujet, de la personne.
Dans ce théâtre, si le corps se relie à d’autres corps, c’est davantage sur le mode de l’espèce, de la collection d’exemplaires. Il ne se rattache aux autres que par une énergie vitale propre aux êtres vivants. Bien que Fabre multiplie les signes de son attachement à la vision de l’homme et du monde médiévale, les corps en scène ne sont façonnés par aucune histoire, par aucune manière d’être ni de vivre ensemble fluctuant au fil des temps. L’effet de leur présence immanente vise à recentrer l’attention sur les instincts et les pulsions comme dimensions à redécouvrir. Pour l’artiste, il faut d’urgence se reconnecter à l’espèce, se réinscrire dans le cadre toujours déjà fermé de la nature où tout meurt et où tout renaît. Le monde commun qui se dessine ici relève d’une colonie d’individus unis par des contacts instinctifs sans liens établis ni institués. Dans cette vision, l’homme devient infiniment vulnérable et sans cesse en combat pour se sauver. Soumis aux lois de la nature, il n’a d’autre choix, d’autre liberté que d’adhérer, s’ajuster ou disparaître, aussitôt remplacé par un autre exemplaire de l’espèce.
Ordonnateur de cette mise en scène, l’artiste est le démiurge qui guide l’organisation de ce monde et qui n’a pas hésité – on se souvient des performances de Fabre –, à faire don de son corps dans un geste sacrificiel. C’est par lui que la corporéité ainsi conçue et présentée sur le plateau devient un système symbolique à destination des spectateurs. À ceux-ci d’acquiescer ou non à la vision du commun qui s’y esquisse. Plusieurs des collaborateurs, et surtout des collaboratrices, de Fabre ont en tout cas fait un choix, dénonçant dans une lettre ouverte certains agissements de l’artiste lors des répétitions des spectacles18. Ce faisant, ils nous engagent surtout à réintégrer tout un contexte de l’œuvre dans notre champ de perception. Car le spectacle vivant est aussi, éminemment, une pratique sociale et la reconnaissance des œuvres en tant que telles est tributaire de leur positionnement dans un une institution19 où les autres artistes, les critiques, les médias, les écoles, les instances de décision en matière de subvention jouent un rôle de légitimation.
- La plupart des considérations sur le corps développées dans ce texte sont inspirées par la lecture des travaux de David Le Breton, notamment Anthropologie du corps et de la modernité, P.U.F., « Quadrige », 2013 ; La Sociologie du corps, PUF, « Que sais-je ? », 1995 (plusieurs rééditions). ↩︎
- Jean-Marie PIEMME, 1953 ; Les Adieux ; Café des patriotes, Bruxelles, Éditions Didascalies, 1998, p.203. ↩︎
- PIEMME, op. cit., p.188. ↩︎
- Cf. LE BRETON, La Sociologie du corps, op. cit. ↩︎
- PIEMME, op. cit., p.195. ↩︎
- Comme s’attache à le démontrer la sociologie de Pierre Bourdieu. ↩︎
- Op. cit., p.4 et p.14. ↩︎
- Dans Le Souffleur inquiet. Essais sur le théâtre, Bruxelles, Alternatives théâtrales, décembre 1984, n°20 – 21, p.91. ↩︎
- Jean-Marie PIEMME et Philippe SIREUIL, J’ai peur de ce soleil, maman, je ne sais rien, Théâtre/Public, juillet-août-septembre 1979, n°28 – 29, p. 52 ↩︎
- LE BRETON, op.cit., p.20. ↩︎
- Op.cit., p.18. ↩︎
- PIEMME, op.cit., pp.150 – 151 ↩︎
- Pour plus de développements, nous nous permettons de renvoyer à Nancy DELHALLE, Théâtre dans la mondialisation. Communauté et utopie sur les scènes contemporaines, PULyon, « Théâtre et société », 2017. ↩︎
- Selon l’analyse de Hans-Thies LEHMANN dans Le Théâtre postdramatique, Paris, L’Arche, 2002. ↩︎
- Erika FISCHER-LICHTE, « De l’activité du spectateur », dans Thomas Hunkeler et alii (éds.), Place au public. Les spectateurs du théâtre contemporain, Genève, MētisPresses, 2008, p.7 ↩︎
- LEHMANN, op. cit ↩︎
- Jan Fabre dans Georges BANU et Bruno TACKELS (coord.), Le Cas Avignon 2005. Regards critiques, Vic-la-Gardiole, Éditions L’Entretemps, 2005, p.242. Fabre est alors l’artiste associé au Festival d’Avignon.
LEHMANN, op. cit. ↩︎ - La Lettre ouverte pub-liée sur le site de Rekto:Verso en septembre 2018 a, dans le contexte de « #metoo » connu un large écho. ↩︎
- Cf. le numéro d’Alternatives théâtrales, « Institutions/insurrections », initié et dirigé par Antoine Laubin (n° 134, mars 2018). ↩︎