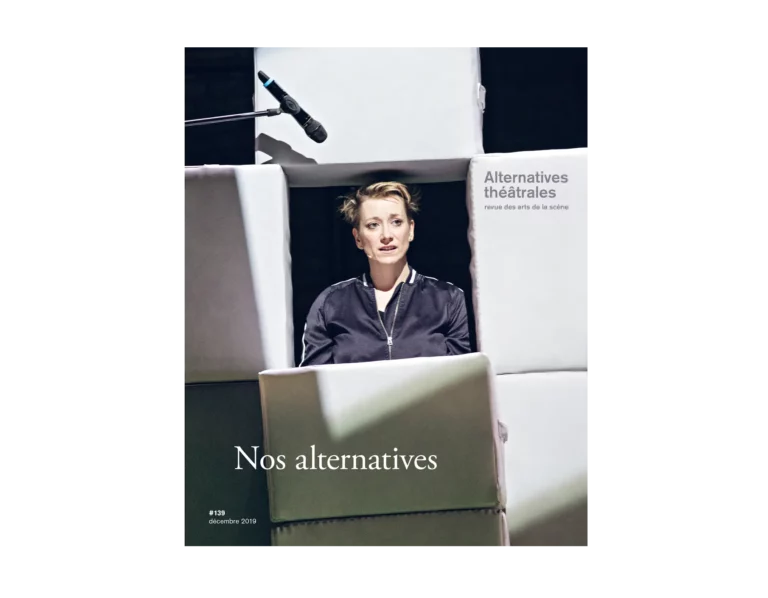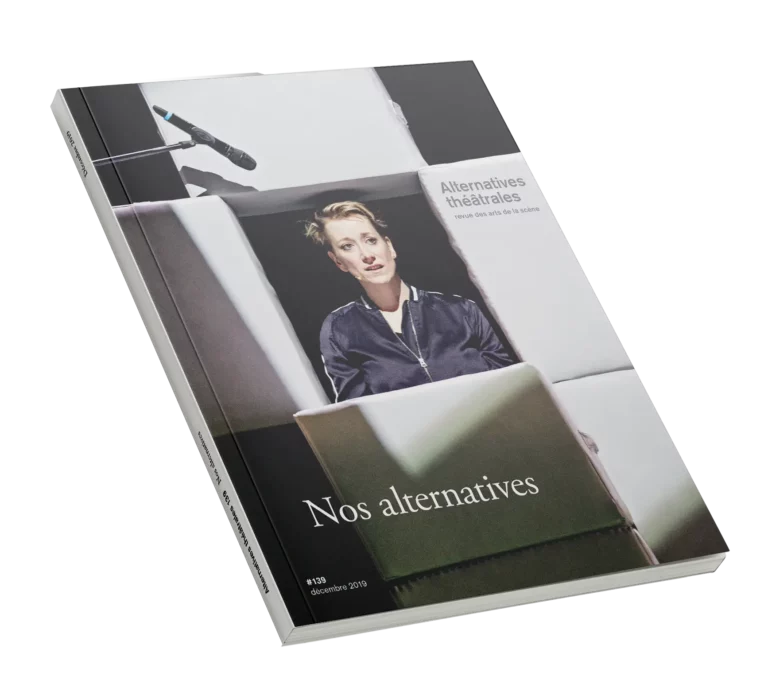PHILIPPE MARTEAU Le collectif permet avant tout de se lancer. Comme un défi irrépressible, d’abord à soi-même et ensuite à l’ensemble : « j’ai envie d’essayer quelque chose avec ce texte, cet auteur. »
Et dans un premier temps, à la marge des institutions, sans disposer toujours de beaucoup de moyens, il est possible de faire exister un nouvel objet. Cela donne de l’encouragement et de la confiance. Et souvent ça marche ! Au-delà de nos espérances. Et c’est ça qui est beau.
Nous nous connaissons depuis 1991 et le regard que nous portons les uns sur les autres est nécessairement profond et complexe.
Il nous arrive parfois de ne pas être d’accord avec ce que fait l’autre. Nous agissons comme une démocratie, rarement avec des votes, mais le plus souvent empiriquement, toujours favorables au développement des projets.
VALÉRIE SCHWARCZ
Que refusez-vous ?
Qu’affirmez-vous ?
Nous avons toujours affirmé la liberté pour chacun d’aller et venir en dehors du collectif et de proposer des projets, de là découlait le fait que nous avons très vite eu plusieurs projets en même temps portés par un porteur(se) de projet différent, sans obligation aucune que tous y soient inclus, ce qui a créé du mouvement, mais aussi un mouvement vers la sortie… et parfois une difficulté à nous identifier.
Quels sont vos objectifs ?
Je crois que nous voulions ça, un théâtre en mouvement, une liberté de jeu, expérimenter les places.
Quelle est la vie organique
du groupe ? Qui entre, qui sort ?
(comment se vit la fidélité)
À partir du moment où le collectif est devenu un collectif de metteurs en scène (plus que d’acteurs) et que chacun est dans une logique de distribution, il arrive de plus en plus souvent à tous de travailler en dehors du collectif ; se pose bien sûr la question du désir, et de la fidélité…disons que nous sommes absolument volages mais que nos amitiés peuvent être fidèles…
PIERRE MAILLET
Quelle est la vie organique
du groupe ? Qui entre, qui sort ?
(comment se vit la fidélité)
La question de la fidélité à l’intérieur des Lucioles est proche de celle qu’on peut ressentir en famille. Le fait de rester ensemble, même si on travaille moins « tous ensemble » que les premières années, en dit suffisamment long sur l’attention portée à chacun, mais c’est une attention pudique. Respectueuse. Une chose tacite entre nous dont on ne parle jamais ouvertement, peut-être à tort d’ailleurs. Car il y a certainement, comme le dit Valérie des frustrations d’en être ou pas, mais ce n’est jamais clairement dit. En tout cas en réunion. Ce qui est indéfectible par contre c’est l’encouragement commun à « faire » coûte que coûte. Que tout le monde ait du travail, et puisse en vivre… Quant à ceux qui y entrent, disons que le cercle s’est considérablement agrandi depuis 25 ans, au gré de nos différentes rencontres « en dehors » : acteurs, auteurs, musiciens et surtout techniciens : créateurs à part entière et avec qui pour le coup une grande fidélité s’est écrite au fil des années. Le noyau dur d’origine lui, n’a jamais vraiment bougé. Deux seules personnes en sont sorties : Marcial Di Fonzo Bo parce qu’il a pris la direction de la Comédie de Caen mais son lien avec la compagnie n’a jamais été rompu. Bien au contraire, c’est même une évidente continuité avec certains d’entre nous. Quant à Mélanie Leray, malgré plusieurs projets personnels dans le cadre des Lucioles elle a eu besoin de s’affranchir du groupe pour faire ses créations, donc elle est volontairement partie créer sa propre compagnie.
ÉLISE VIGIER L’idée première était de se dire que les acteurs étaient actifs, désirants et pas uniquement choisis ou élus, désirés ou non désirés par les metteurs en scènes. L’idée était aussi de ne rien empêcher, d’accompagner et de favoriser tous les désirs, donc si quelqu’un ou quelqu’une d’entre nous avait le désir de mettre en scène un texte, de créer une forme, il le faisait, et d’ailleurs cela continue, il ou elle le fait ! Il n’y a aucune censure… l’idée première était de créer une autonomie.
Un groupe autonome. Un outil de production, même si au départ on ne l’a pas formulé comme ça.
Nous étions au départ tous acteurs actrices et justement l’idée était de ne pas dépendre du désir des autres pour au contraire pouvoir initier des projets. La seule contrainte que nous nous étions donnée était de monter des spectacles avec d’autres membres de collectifs, d’autres lucioles.
FRÉDÉRIQUE LOLIÉE
Y‑a-t-il une dimension politique
à votre démarche collective,
un projet politique à affirmer
et défendre ?
La politique c’est : comment vivre ensemble. Donc oui la démarche collective est politique.
Elle résiste. À la politique qui pense pour d’autres et impose. Aux systèmes fermés, unilatéraux.
Il me semble que dans les Lucioles on a toujours cherché tout ce qui est ouvert, en mouvement et peut produire des effets enthousiastes, vivants. En jouant avec l’économique, la technique et l’artistique. C’est archi politique de rêver et faire rêver…
Le problème du politique c’est qu’il réagit à des effets de mode, de presse, c’est sinistre. C’est résoudre des problèmes. Mais en fait, le chemin est beaucoup plus intéressant que la solution (qui n’en est pas une en plus !). Le fameux « intérêt pour le déroulement et non pour le dénouement » de Brecht. Il y a toujours une force propositionnelle du « bas » à écouter parce qu’elle est souvent inventive, inédite. Drôle aussi.
En 1968, les gens parlaient du dimanche de la vie, ils avaient l’impression de pouvoir toucher leur vie, prendre position, acter.
Quand on conduit on oublie qu’on est dans un espace commun, on est dans sa bagnole et on oublie que la route n’est pas à nous ! Je ne sais pas… peut-être les Lucioles c’est être un à plusieurs.
Le texte complet de l’entretien avec les Lucioles est à retrouver sur
www.alternatives theatrales.be