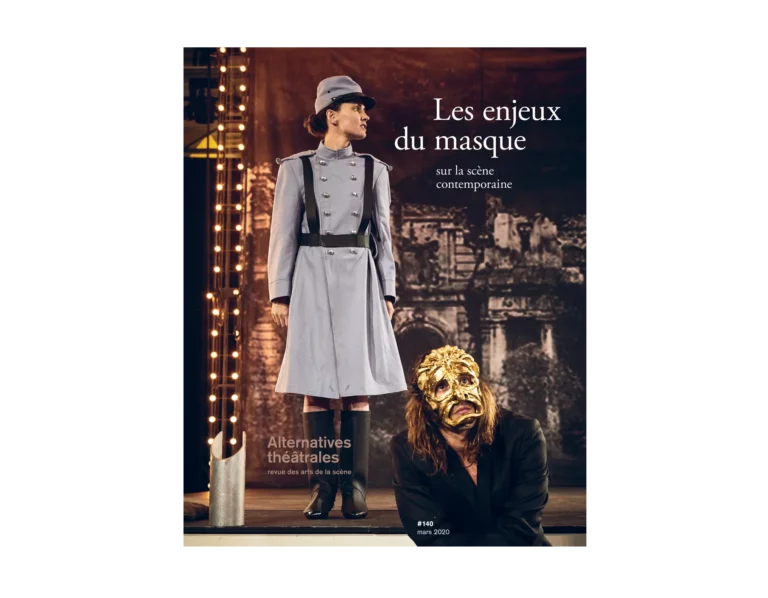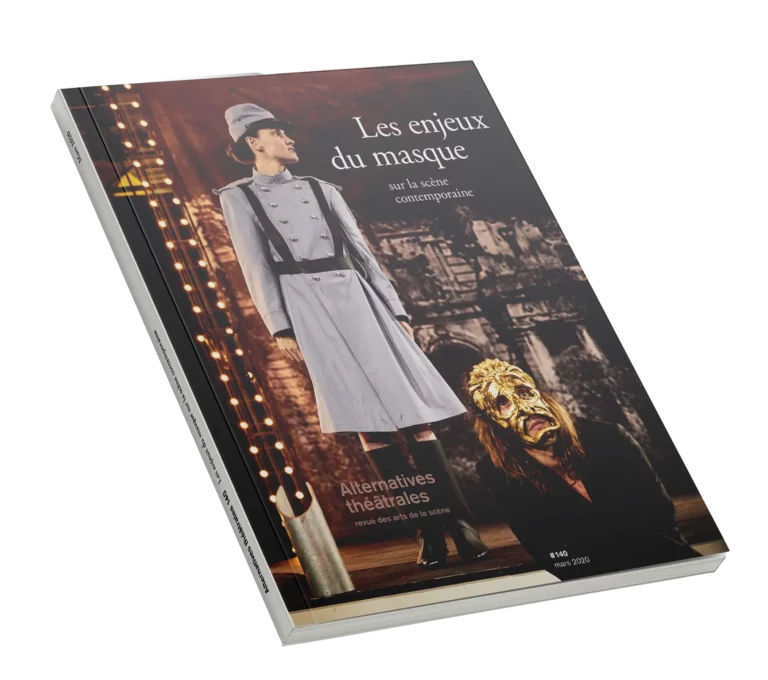Le masque est un objet qui éveille en l’acteur une mémoire profonde. Quand en as-tu fait l’expérience ? Était-ce dans ton pays, en Colombie ?
C’est ici, en France, en Europe, que j’ai découvert le masque. Ne pouvant pas faire de théâtre dans mon pays, à vingt ans, j’ai décidé de gagner Paris. Or, c’était l’époque où toute une constellation de grands maîtres qui m’avaient fait rêver était présente sur les scènes parisiennes : Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie, Antoine Vitez à Chaillot, Jerzy Grotowski et Peter Brook aux Bouffes du Nord, Giorgio Strehler au Théâtre de l’Odéon, Pina Bausch et Caroline Carlson au Théâtre de la Ville… En tant que tout jeune artiste, j’avais l’espoir un peu fou de les approcher, de les rencontrer, de les croiser. C’est aussi alors que je découvre le travail de Marcel Marceau, de Jacques Lecoq et surtout ce spectacle qui se donnait au Théâtre du Soleil et qui fut pour moi une « vision » qui allait m’accompagner dans mon aventure théâtrale : L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge d’Hélène Cixous, dans lequel tu jouais le roi défunt Suramarit avec un masque balinais. Ce fut pour moi comme une épiphanie du théâtre, un corps magique, une apparition qui dansait comme une flamme. Quelques semaines plus tard, je rencontre un masque balinais chez un antiquaire, un signe – qui m’accompagne toujours. Et c’est aussi durant cette période qu’Antonio Díaz-Florián, Directeur du Théâtre de l’Épée de Bois, où j’ai fait mes premiers pas d’acteur, m’a permis de faire venir Mas Sogen pour un stage à la Cartoucherie, qui m’a transmis les linéaments du corps masqué, un sésame pour oser entrer quelques mètres plus loin, au Théâtre du Soleil, pour un stage dirigé par Ariane Mnouchkine, au seuil de sa création L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves.
Penses-tu, comme Antonin Artaud, que « le théâtre est oriental » ?
– Un mot que reprend volontiers Ariane Mnouchkine.
Oui, il n’y a pas de doute, le théâtre est oriental. Le théâtre, c’est l’Orient, le masque balinais, le masque-maquillage du Kathakali, le Nô, le Kabuki. Toutes ces formes entre l’Inde, l’Indonésie et le Japon induisent un corps total, un corps loin de l’ordinaire, extra-ordinaire. Et c’est une fois que j’ai découvert ces grandes formes théâtrales que je me suis intéressé à ce qu’il y a dans ma culture colombienne, avec ses traditions en partie perdues. Nous avons certes des carnavals importants, avec des danses masquées, comme celui de Barranquilla au Nord de la Colombie ou celui de Negros y Blancos dans le département de Nariño. Mais de mon pays, ce qui m’a enrichi le plus pour mon travail théâtral, et qui continue à me nourrir, c’est la musique. C’est grâce la musique que j’ai constitué un entraînement qui me permet d’accéder à un corps masqué : par elle, j’ai façonné un langage qui est devenu un rituel dans mon travail, et qui me sert à présent de préparation avant de monter sur le plateau en tant que comédien, ou avant de commencer les répétitions en tant que metteur en scène.
Dans ton esthétique, je décèle tout de même des traces profondes de ta terre d’origine, peut-être dans cette conjonction entre la démesure de la fête allant jusqu’à la folie et la dimension rituelle, sacrée ?
Oui, tu as raison. C’est incontestable. Il y a aussi ma curiosité de caractère, et les maîtres qui m’ont formé et qui m’ont incité à monter sur le plateau avec le sens du sacré et la conscience d’un corps extra-quotidien. Ensuite, au Japon, j’ai rencontré Tadashi Suzuki qui s’est intéressé à ma méthode de préparation des acteurs et m’a permis d’accéder à son training – dont je me suis fortement inspiré. C’est avec ce type d’entraînement que je suis arrivé à la Comédie-Française, lorsque j’y fus invité par Marcel Bozonnet pour créer en 2006 Pedro et le commandeur de Lope de Vega. J’ai alors associé à cette « méditation en mouvements » les musiques et les danses traditionnelles du Pacifique colombien : constituer cette chaîne de mouvements, cette association de maillons est toujours nécessaire avant d’accéder aux masques. Marcel Bozonnet souhaitait amener le masque à la Comédie-Française, car travailler le masque, c’est revenir aux fondamentaux du jeu de l’acteur. Ce fut un moment essentiel, un temps de communion dont on parle encore, que de voir un texte du Siècle d’or espagnol joué intégralement dans l’énergie vitale du masque. Jouer un texte classique avec les outils de la genèse du théâtre nous a conduits à cet instant de « grâce », à cette magie, à cette lumière, à cette poésie qui éclaire le plateau et révèle sa pureté, son essence. Le masque amenait la discipline de la spontanéité.
Toi-même, tu avais découvert vingt ans plus tôt ces pouvoirs cachés du masque au cours d’un stage avec Ariane Mnouchkine. Pourrais-tu revenir sur cette expérience ?