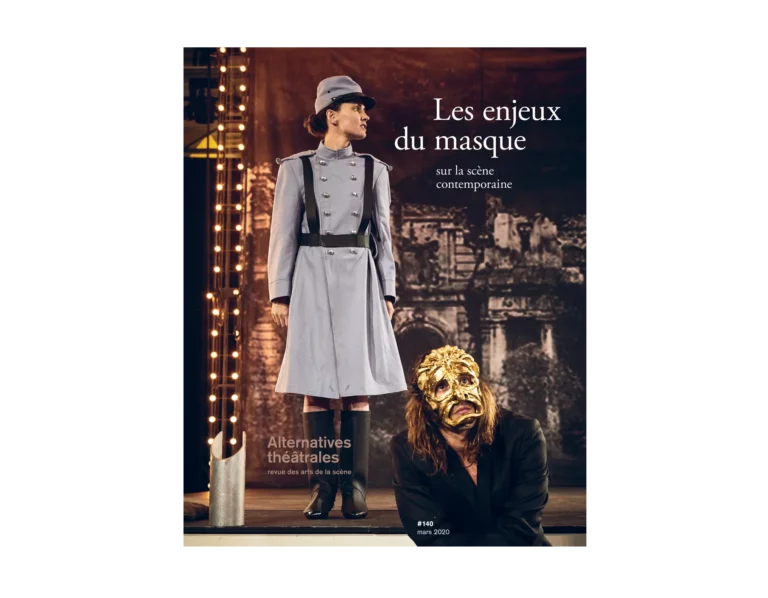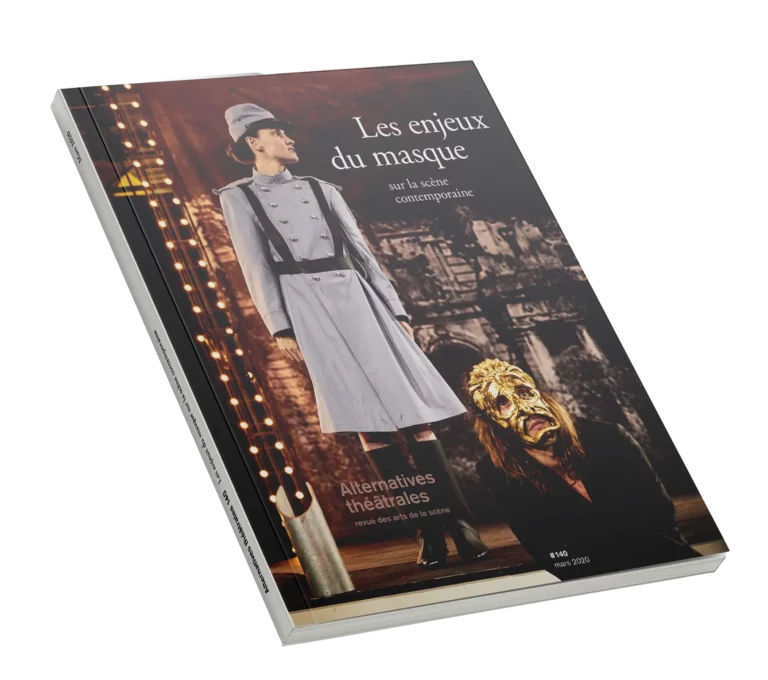« Tel qu’en lui-même enfin, l’éternité le change. »
STÉPHANE MALLARAMÉ
— Maman ?
Pourquoi elle bouge pas ?
— Elle est morte chérie.
— Maman ?
Pourquoi elle parle pas ?
— Elle est morte chérie…
— Maman ?
Pourquoi elle a une serviette nouée autour de la tête ?
— C’est pour lui fermer la bouche, ma chérie.
— Maman…
J’avais sept ans et je découvrais le visage de ma grand-mère, sur son lit de mort. C’est alors qu’il s’imprima en moi ad vitam aeternam, sous couvert du masque que la mort lui conférait. Simple, lisse, reposé, semblant dormir, familier et pourtant froid, énigmatique, violemment silencieux et immobile. Aujourd’hui, ce saisissement primordial me semble à l’origine de ma fascination pour le masque neutre et son étrangeté radicale. Qu’est-ce qu’il y a derrière ? Qui est derrière ? Passé où ?
La première fois
La première fois que j’ai chaussé un masque neutre (inexpressif), quelque chose de cette étrangeté s’est réanimé en moi et m’a guidé intimement. Comme un air de recouvrance de quelque chose qui avait eu lieu auparavant, lointainement enfoui dans mon passé de petite fille. Ce jour-là, le masque neutre devait se déplacer verticalement, selon les lignes d’un drapeau anglais. Ce fut un moment inattendu d’aisance corporelle et de dilatation de mon être, qui alors découvrait à la fois, une autre manière de bouger en suivant simplement le protocole technique, une écoute inattendue des informations sensibles et profondes qui m’assaillaient et l’indéfinissable singularité de mon visage masqué, remorquant mon corps à sa suite. Interpellée, je le fus, ne sachant pas de quelle manière à ce moment-là. Dès lors, je n’ai eu de cesse de creuser l’énigme et la profondeur du sens qui s’en dégageait, de m’interroger, d’éprouver cette présence particulière au monde avec ce double sentiment de se mettre à nu tout en restant couverte. Témoin de ce qui émergeait en moi, je témoignais face au public des possibles et multiples identités que la neutralité du masque me permettait dès lors.
Un masque neutre individuel
L’autre expérience qui s’est imprimée en moi fut le premier moulage en plâtre de mon visage et les conséquences dans mon corps et dans ma démarche ultérieure sur la construction d’un masque neutre individuel (et non un masque fabriqué par un constructeur).
Le recouvrement progressif du visage par des bandes plâtrées froides, y compris les yeux, la bouche, les narines, me signifie la clôture de mes ouvertures sur le monde. Corps allongé et immobile, chaque étape m’est une épreuve de disparition et en même temps productrice de sensations nouvelles et d’une perception générale de mon corps entier : écoute exacerbée des sons extérieurs et soudainement amplification des sons produits par mon corps (battements du cœur, respiration altérée, circulations des humeurs), manifestations minuscules et sensibles de mon corps immobilisé, mais aussi et surtout, plongée dans une intimité où défilent états émotionnels, pensées traversantes, mémoires ravivées, réminiscence des visages de disparus, images, etc.). Puis, je ressens la chaleur du plâtre qui sèche en se solidifiant, le décollement du masque qui adhère par endroits en s’arrachant à moi, le sentiment de renaissance à la libération de mon visage et la découverte de l’empreinte en creux de ma face. Il me faut combler ensuite ce creux, pour en faire un moulage en positif. Je découvre enfin mon visage de dormeuse, détendu, dénué d’expression. C’est blanc. C’est moi et ce n’est pas moi. Ce n’est pas moi, c’est toi. C’est lui/moi séparé de moi. Enfin, du bout du pinceau, avec une attention minutieuse, j’encolle de fines bandes de papier de soie et les superpose, sur toute la surface du moule positif posé devant moi. En prenant soin du masque neutre qui affleure (le mien), j’ai l’impression de prendre soin de mon propre visage.
Voilà, in fine : un masque de soi en papier de soie. Un masque de soi pour soi. Qui se moule sur le visage exactement, sans-gêne. Une interface très légère et fine entre soi et soi, entre soi sujet et soi objet, entre intérieur et extérieur, entre soi et self de soi, entre « quant à soi » et image de soi que l’on veut donner à voir ou qui se révèle de soi. Je peux jouer de la distance entre les deux, en apprivoiser l’entrée, en ressortir, à peine ou totalement. Enfin, je procède à l’ouverture des yeux, des petites ouvertures en forme de fente horizontale avant de les ouvrir un peu plus, sans trop, pour organiser l’articulation de la tête avec le reste du corps et la décomposition de son mouvement dans l’espace.
Envisager le corps
« Tes deux beaux seins radieux comme des yeux. »
CHARLES BAUDELAIRE