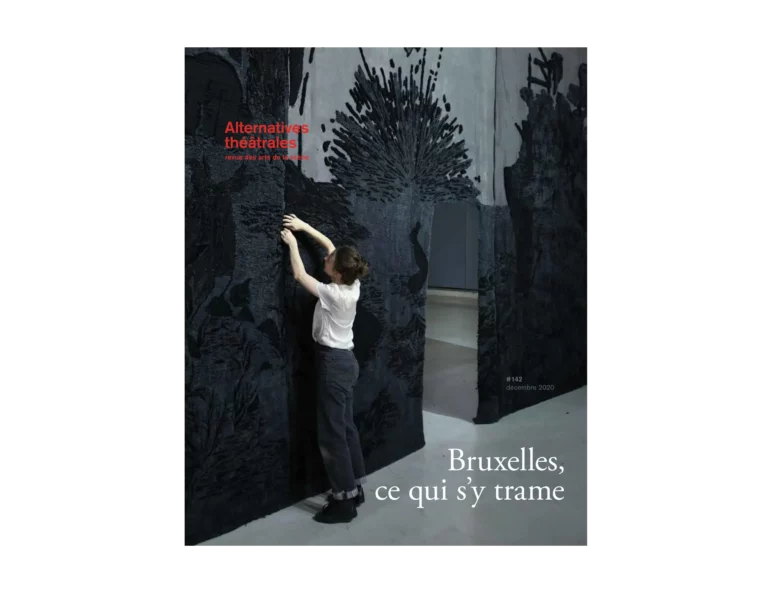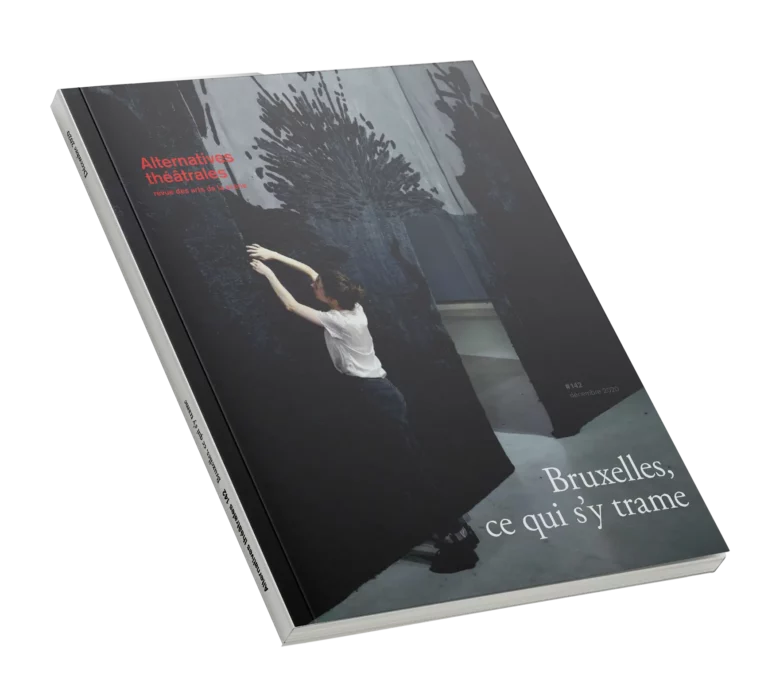Nous écrivons ces lignes en pleine pandémie, et l’éditorial que nous avions préparé il y a plusieurs mois, une éternité, nourri d’enthousiasme pour une ville en ébullition, nous semble aujourd’hui dramatiquement décalé. Les théâtres ont rouvert depuis peu mais sont soumis à des normes sanitaires strictes qui limitent fortement les jauges et obligent à des salles à moitié vides. Nombre de spectacles sont annulés car les artistes ne sont pas autorisé.e.s à passer la frontière, les visages sont masqués et l’on oscille entre peur, exaspération, fatalisme et patience. Pourtant, malgré les circonstances pénibles que nous traversons, Bruxelles vit un moment extraordinaire de son histoire : ces trois dernières décennies, et encore plus particulièrement ces dix dernières années, elle s’est transformée en un des principaux centres de la création en arts de la scène dans le monde : metteur.euse.s en scène, chorégraphes, performeur.euse.s, artistes venu.e.s de Belgique, d’Europe et d’ailleurs génèrent ensemble une émulation créative excitante, stimulante, exceptionnelle. La ville, même en ces temps difficiles, est plus vivante qu’elle ne l’était il y a vingt ans, et les spectateur.rice.s y sont averti.e.s et exigeant.e.s. Mais qui sont les artistes qui la transforment si profondément aujourd’hui ? Quelles formes développent-iels ? Quels discours, quelles visions politiques et philosophiques ? Où créent-iels, quoi, comment et avec quels moyens ? Comment les institutions les soutiennent-elles ?
1Nous écrivons ces lignes en pleine pandémie, et l’éditorial que nous avions préparé il y a plusieurs mois, une éternité, nourri d’enthousiasme pour une ville en ébullition, nous semble aujourd’hui dramatiquement décalé. Les théâtres ont rouvert depuis peu mais sont soumis à des normes sanitaires strictes qui limitent fortement les jauges et obligent à des salles à moitié vides. Nombre de spectacles sont annulés car les artistes ne sont pas autorisé.e.s à passer la frontière, les visages sont masqués et l’on oscille entre peur, exaspération, fatalisme et patience. Pourtant, malgré les circonstances pénibles que nous traversons, Bruxelles vit un moment extraordinaire de son histoire : ces trois dernières décennies, et encore plus particulièrement ces dix dernières années, elle s’est transformée en un des principaux centres de la création en arts de la scène dans le monde : metteur.euse.s en scène, chorégraphes, performeur.euse.s, artistes venu.e.s de Belgique, d’Europe et d’ailleurs génèrent ensemble une émulation créative excitante, stimulante, exceptionnelle. La ville, même en ces temps difficiles, est plus vivante qu’elle ne l’était il y a vingt ans, et les spectateur.rice.s y sont averti.e.s et exigeant.e.s. Mais qui sont les artistes qui la transforment si profondément aujourd’hui ? Quelles formes développent-iels ? Quels discours, quelles visions politiques et philosophiques ? Où créent-iels, quoi, comment et avec quels moyens ? Comment les institutions les soutiennent-elles ?
Dans ce numéro, nous nous concentrerons sur des artistes et institutions que nous estimons parmi les plus générateur.rice.s, pas nécessairement les plus connu.e.s, parmi celles et ceux qui créent des formes et des manières de voir la scène et le monde, qui bouleversent nos habitudes de regard et de pensée, et partagent avec nous des outils esthétiques et politiques qui nous permettent d’appréhender notre temps avec souplesse et agentivité. Faire un instantané de l’histoire culturelle d’une ville, comme ce numéro se propose de le faire, est forcément un exercice imparfait. Très nombreux.ses sont les artistes, institutions, collectifs, intellectuel.le.s que nous aurions voulu évoquer et qui ne le sont pas ; qu’iels nous le pardonnent (on vous voit, on vous entend, on vous aime). De la même manière, sont absents de ce numéro certains partenaires historiques d’Alternatives théâtrales, comme notamment le Théâtre National, les Brigittines, le Varia, le Théâtre 140, le Théâtre Océan Nord ou encore le Rideau2, malgré leur inlassable soutien à la jeune création. La perspective que nous empruntons ici est subjective, au sens le plus strict du terme : nous ne pouvons parler que de ce que nous voyons, de ce que nous connaissons, et nous nous réjouissons d’avance des conversations et rencontres que générera ce numéro. Si cette édition peut permettre d’autres avancées, créons ensemble d’autres temps pour les construire.
Afin de comprendre pourquoi Bruxelles est devenue un tel vivier de création, il faut se pencher en premier lieu sur les conditions sociales et l’architecture institutionnelle de la ville, car ce sont elles qui (dé)forment le terrain dans lequel évoluent les artistes. Embarquons pour un bref mais nécessaire détour administratif.
L’État belge est labyrinthique : basé sur un système de fédéralisme coopératif, il possède plusieurs entités fédérées qui ont chacune leurs propres domaines de compétence, sans hiérarchie entre elles. Les trois Régions, flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale, ont leur propre gouvernement et s’occupent principalement de l’emploi, du logement et de la sécurité sociale. Les trois communautés (flamande, germanophone et francophone) ont elles aussi un gouvernement singulier, et ce sont elles qui sont en charge des compétences culturelles. Ce découpage n’aide pas à assurer une cohérence politique sur le long terme, ni à simplifier la coopération entre toutes ces structures. Les politiques culturelles mises en place font face à de plus en plus de défis pour proposer aux artistes un environnement sécurisé, ce qui est douloureusement évident au regard de leur gestion de la pandémie. Les interlocuteur.rice.s sont multiples, les prises de décision sont lentes, on voit des cheveux blancs apparaître chez les plus jeunes qui ne sont plus si jeunes, et les changements politiques souhaités par la popu-lation s’étiolent immanquablement.
La Belgique fait ressortir toutes ses nuances dans sa capitale, car les décisions prises par les communautés doivent se frayer un chemin dans la gouvernance de la ville de Bruxelles. Le statut particulier de cette dernière la place dans une situation ambivalente ; ville-région bilingue, elle est à la fois nœud administratif et lieu phare de développement culturel. La ville de Bruxelles est complexe, éclectique et unique, et bien qu’historiquement flamande, elle est aujourd’hui majoritairement francophone et compte en tout 184 nationalités. Cette multiplicité fait de cette ville de petite taille un cocon qui accueille une des plus fortes diversités culturelles au monde et où la population peut parfaitement continuer à s’organiser et à fonctionner en l’absence de gouvernement fédéral…
Et maintenant, retour à celles et ceux qui font et sont Bruxelles et qui font battre nos cœurs. Les artistes au sein de cette société ont intégré la nécessité de leur autonomie malgré les subventions accessibles et les outils culturels qui peuvent les soutenir. À Bruxelles, iels n’attendent pas l’appui d’une institution pour pratiquer leur art, se reconnaître entre elles et eux et partager leurs ressources et forces respectives. Aujourd’hui, la conscience que toutes et tous n’ont pas d’entrée de jeu les mêmes privilèges y est forte et il tend à régner une forme de simplicité dans les rapports interpersonnels qui permet de faire partie de plusieurs nous malgré les données de classe, de race, de genre et d’orientation sexuelle.
Aujourd’hui à Bruxelles, les artistes interrogent les modèles dominants et sont déterminé.e.s à construire des alternatives vivantes et fonctionnelles en choisissant souvent des formes de travail et d’organisation collective, et cette préférence ne s’appuie pas uniquement sur un besoin de survie. Pour beaucoup, la quête du succès individuel vient après le besoin de créer du commun, des espaces de solidarités, et des expériences partagées et inclusives. La scène bruxelloise est traversée de réflexions citoyennes qui nourrissent les propositions artistiques qui en émergent.
On y observe ainsi des esthétiques fortes, singulières et diverses, en constante évolution. Il n’est plus rare de voir des artistes concevoir leur scène à l’extérieur des plateaux disponibles au sein des institutions, élaborer des projets qui donnent voix à leurs voisin.e.s, aux invisibilisé.e.s, offrir d’autres temporalités et modalités de réception, etc. Il ne s’agit pas pour elleux de se démarquer du lot par « l’innovation » ou autres termes à paillettes, mais bien de proposer des réflexions sur ce que signifie le collectif et le fait de poser un geste artistique dans la Cité. Vivre à Bruxelles et être influencé.e par son environnement et fonctionnement impulse aux artistes une inventivité créative sans doute plus vivace et soutenue qu’ailleurs, et impose comme dans beaucoup d’autres villes et pays une nécessité de faire voir par leurs œuvres, leurs actes et leurs prises de paroles qu’il existe des alternatives à l’idéologie politique actuelle qui est peu claire et n’inspire guère confiance.

Cette créativité est portée par une activité intellectuelle soutenue. Chaque génération d’artistes dialogue avec une série de figures philosophiques prédominantes. Freud, Sartre, Marx, Nietzsche, Lacan, Derrida, leurs émules et adversaires, ont largement dominé le XXe siècle ; il y a une dizaine d’années, un très grand nombre de créateur.rice.s se réclamaient de Deleuze, et « rhizome » et « déterritorialisation » faisaient partie du vocabulaire des espaces de création. Aujourd’hui, c’est un autre courant qui nourrit princi-palement la pensée artistique à Bruxelles, celui qui s’est constitué autour d’Isabelle Stengers, Vinciane Despret3, Donna Haraway, Anna Tsing et Bruno Latour. Avant de l’aborder plus spécifiquement, il faut noter que ces penseur.euse.s sont influencé.e.s, entre autres, par les théories féministes, queer, décoloniales et écologistes, elles-mêmes très présentes dans le champ intellectuel bruxellois. On y cite beaucoup le féminisme français contemporain (Virginie Despentes, Chloé Delaume, Mona Chollet, Elsa Dorlin), la pensée queer (Paul B. Preciado, Judith Butler, Monique Wittig), l’afro-fémi-nisme (Audre Lorde, Kimberlé W. Crenshaw, Djamila Ribeiro, Angela Davis, bell hooks) et l’écologie (Starhawk, Timothy Morton, Emanuele Coccia).
Parmi tou.te.s ces penseur.euse.s, Stengers et Despret occupent une place particulière ; ce sont elles que l’on retrouve le plus souvent citées dans les dossiers, projets et conversations avec les artistes et les dramaturges. Plusieurs aspects de leur travail interpellent : leurs réflexions à toutes deux sur le féminisme et la démocratie, celles de Stengers sur les communs, l’écoféminisme, la finance, l’écologie, et celles de Despret sur les animaux, les scientifiques, le rapport de notre société aux morts, à la mort et aux vivants en général. Mais c’est peut-être leur pratique d’écriture elle-même qui permet le mieux de cerner leur influence sur les arts de la scène à Bruxelles : elles « pensent par le milieu », pour reprendre une formule de Gilles Deleuze que cite souvent Stengers, c’est-à-dire qu’elles étudient des faits, des situations, des concepts dans toute leur complexité et leurs multiples réseaux, sans chercher à rien en soustraire, ce qui les amène à refuser d’endosser une position d’autorité et à respecter la positivité de tous les savoirs. Par exemple, dans Au bonheur des morts, Vinciane Despret veut représenter avec le plus de justesse possible la position de chacune des personnes qu’elle a consultées. Elle ne prend parti ni pour celleux (et iels sont majoritaires) qui affirment cultiver un lien vivant avec leurs mort.e.s, ni pour l’argument qui situe ce lien dans leur imagination ou leur inconscient, elle décrie ainsi de fait la posture intellectuelle qui prétend mieux et plus savoir et qui en vient souvent à mépriser celleux qu’elle étudie. Sans pudeur, nous leur déclarons ici notre amour et notre reconnaissance d’ainsi rétablir l’équilibre des forces qui nous habitent et nous entourent.
Représenter plusieurs points de vue dans leur intégrité, sans juger : les spectacles que l’on voit aujourd’hui à Bruxelles sont pour la plupart politiques, mais sans que des opinions ne soient nécessairement énoncées. C’est alors la forme elle-même qui est investie d’une puissance de transformation, en permettant l’ouverture à une multiplicité de points de vue, le refus de la position d’autorité et la circulation des savoirs et des pensées. L’artiste ne sait pas mieux que ses spectateur.rice.s, et ce qu’iel leur demande est de s’ouvrir à cette instabilité. Ces spectacles-là sont politiques non pas parce qu’ils veulent nous transmettre une vérité ou parce qu’ils ont quelque chose à nous apprendre, mais justement parce qu’ils se refusent à nous dire quoi penser et nous invitent plutôt à nous saisir des ressorts de notre propre intelligence.
Ce parti pris, résolument anti-pédagogique, fait écho au travail d’un autre penseur incontournable pour comprendre ce qui se joue sur les plateaux aujourd’hui : Jacques Rancière. Dans Le spectateur émancipé, il déplore l’accusation trop souvent dirigée à l’encontre du spectateur selon laquelle celui-ci serait un être passif et ignorant, attendant de l’artiste qu’iel lui transmette des « messages » visant à le sortir de son abrutissement. Au lieu de cela, Rancière postule l’égalité de toutes les intelligences : la spectatrice agit, elle trace elle-même son propre cheminement intellectuel et sensible à travers l’œuvre qui lui est proposée. Elle ressent, interprète, compare, compose, elle est « émancipée », c’est-à-dire que loin d’être un jouet aux mains d’un artiste qui pourrait diriger ses pensées et ses affects, elle est, tout autant que lui, sujet actif. Dès lors, l’art n’a pas pour mission d’éduquer, mais de proposer des régimes de sensorialités, des manières de ressentir qui vont à l’encontre de celles qui dominent dans notre monde, car quand les repères sensibles se troublent, c’est l’ordre des choses qui tout entier est ébranlé.
Cette attention des artistes à la théorie et l’éthique va de pair avec l’expansion ces dernières années des pratiques dramaturgiques, non au sens de l’écriture dramatique, mais d’un accompagnement sensible, esthétique et philosophique d’œuvres en création. Ces pratiques ne sont pas nouvelles (Jean-Marie Piemme4 et Marianne van Kerkhoven en étaient déjà des figures de proue dans les années 1980) et elles sont depuis longtemps habituelles en Flandre, mais il est intéressant qu’elles deviennent de plus en plus habituelles en Belgique francophone. C’est pourquoi nous avons demandé à Camille Louis5, philosophe et dramaturge, associée à La Bellone depuis 2015, de nous livrer dans cette partie introductive une réflexion sur sa propre pratique de la dramaturgie et la manière dont elle s’inscrit dans le contexte actuel.
Le deuxième article de cette introduction propose un entretien avec les artistes Soraya Amrani et Luanda Casella. Un des défis principaux auxquels doit faire face le monde culturel belge aujourd’hui est celui de l’entre-soi, car si Bruxelles jouit d’une multiculturalité vivante, c’est beaucoup moins le cas de ses théâtres : le public et les artistes sur scène y sont en très grande majorité blanc.he.s, et on est souvent choqué.e, après s’être promené.e à travers des rues largement métissées, de se retrouver soudain dans un lieu culturel à l’uniformité ethnique criante. C’est pourquoi il nous a semblé essentiel d’interroger deux personnalités racisées, l’une active en Belgique francophone (Soraya Amrani), l’autre en Flandre (Luanda Casella), sur les difficultés que rencontrent les artistes de couleur des deux côtés de la frontière linguistique.
Pour structurer notre réflexion sur les arts de la scène bruxelloise, nous avons décidé de nous ancrer dans la notion de « lieu », d’une part parce que ce lieu qu’est Bruxelles est le sujet de ce numéro, et d’autre part parce qu’il s’agit d’un des enjeux politiques principaux de la ville aujourd’hui. En effet, « comment occuper un lieu ? » est au cœur de questions féministes, décoloniales, écologiques, communautaires, de gentrification, d’accueil des réfugié.e.s., etc., qui sont elles-mêmes au cœur des pratiques artistiques dont nous rendons compte ici.
Nous commencerons par une série d’articles basés sur des entretiens avec des directeur.rice.s de structures subventionnées bruxelloises, Daniel Blanga Gubbay (Kunstenfestivaldesarts), Monica Gomes (Théâtre de la Balsamine) et Michèle Braconnier (Théâtre de L’L), choisi.e.s pour leur infatigable attention à l’évolution des pratiques artistiques à Bruxelles et le soutien qu’iels leur ont apporté au cours des ans.
Ensuite, nous nous tournerons vers les plateaux eux-mêmes, pour nous pencher sur le travail de quatre artistes, Léa Drouet, Sarah Vanhee, Lara Barsacq et Louise Vanneste, qui cultivent ces pratiques que l’on rencontre fréquemment sur la scène bruxelloise : plutôt que d’exposer un discours ou un point de vue, elles conçoivent des dispositifs et des langages scéniques qui créent un dialogue entre les spectateur.rice.s et l’œuvre autour d’une idée ou d’un questionnement, activant ainsi la pensée et un engagement égal dans la création et la réception.
D’autres artistes, et ce sont de nouveau là des procédés que l’on retrouve régulièrement à Bruxelles, choisissent de déployer leurs pratiques au-delà des plateaux ; nous traiterons ici de Gurshad Shaheman, Lucile Choquet, Anna Rispoli et du collectif Loop‑s6. Iels ne font pas d’art urbain ou in situ, mais plutôt écrivent et conçoivent des formes en dehors des plateaux par nécessité formelle, suivant les impératifs de leur processus et de leurs ambitions esthétiques pour que les matières émergent d’un contexte précis et s’y dessinent, s’y adressent directement.
Nous conclurons notre tour d’horizon par une réflexion sur des lieux particuliers qui participent du caractère singulièrement créatif de la scène artistique bruxelloise : Le Lac, Decoratelier et Days4Ideas, événement emblématique de La Bellone. Leurs responsables sont animé.e.s d’une conception rigoureuse du rôle social de leur espace dans la ville tout autant qu’iels sont conscient.e.s de l’importance de proposer des formes d’invitation à leurs publics qui vont plus loin que la représentation. La force de leur présence réside principalement dans l’écriture des événements qu’iels organisent et qui visent à proposer des expériences incarnées du politique plutôt qu’à la diffusion de messages pédagogiques ou didactiques.
Le cahier critique qui clôt ce numéro aborde le travail de Florence Minder et du collectif Ne mosquito pas, et propose le compte rendu poétique d’une pièce non vue car annulée pour cause de confinement, Une cérémonie du Raoul Collectif, qui aurait dû être jouée au Théâtre National la saison passée.

La pandémie a évidemment eu un impact fort sur ce numéro, et elle est évoquée dans bon nombre d’articles. Il est à ce jour impossible de déterminer quel sera son impact à long terme sur la ville en général et sur les arts de la scène en particulier ; un autre numéro sera nécessaire dans cinq ans, dix ans, pour mesurer l’étendue des dégâts et aussi, peut-être, ce que cette crise aura rendu possible. Il nous reste à continuer à appliquer le motto du philosophe Lieven De Cauter : « pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk »7, pour à la fois rester vigilant.e.s à ce que Bruxelles reste le lieu unique, précieux qu’elle est devenue sans être aveugle aux sinistres injustices qui y sont commises, et pour continuer à la célébrer et à y vivre, penser, créer, lutter sans nous égarer ni dans le cynisme, ni dans la vanité.
- Nous reprenons ici la graphie créée par le Kunstenfestivaldesarts en 2020. ↩︎
- Alternatives théâtrales collabore depuis longtemps avec ces institutions, et nous en profitons pour signaler qu’un grand format sur le Rideau paraîtra en mai 2021. ↩︎
- Voir l’entretien d’Isabelle Dumont avec Vinciane Despret dans notre numéro 129, Scènes de femmes, Écrire et créer au féminin. ↩︎
- Pour en savoir plus : Jean-Marie Piemme, Accents toniques Journal de théâtre 1974 – 2017, Bruxelles : Alternatives théâtrales édition, collection alth, 2018. ↩︎
- Mylène Lauzon a recueilli les propos de Camille Louis dans « Huit mots tendus chez Camille Louis », paru dans notre numéro 135, Philoscène. ↩︎
- Pour en savoir plus, un dossier de notre numéro 139, Nos Alternatives, est consacré aux collectifs. L’extension numérique de ce numéro réunit neuf entretiens avec des collectifs (entre autres Greta Koetz et Clinic Orgasm Society), disponibles sur notre blog. ↩︎
- « Le pessimisme en théorie, l’optimisme en pratique. » ↩︎