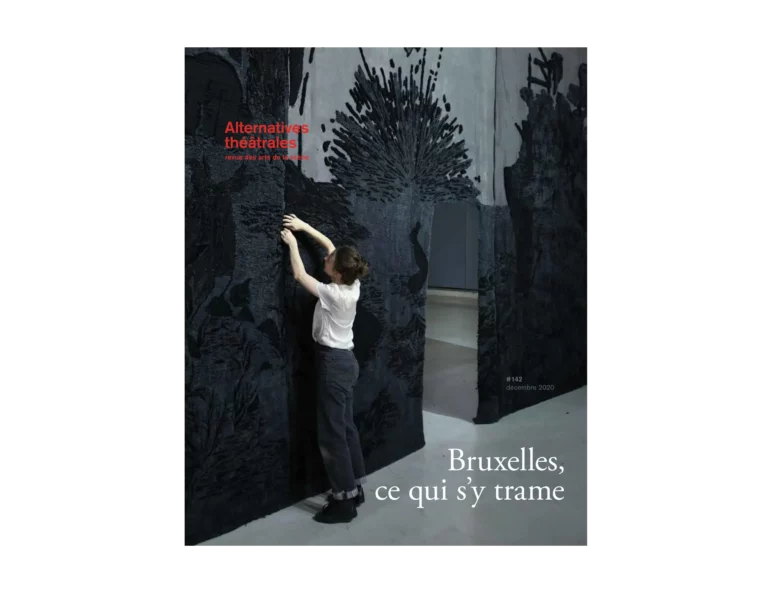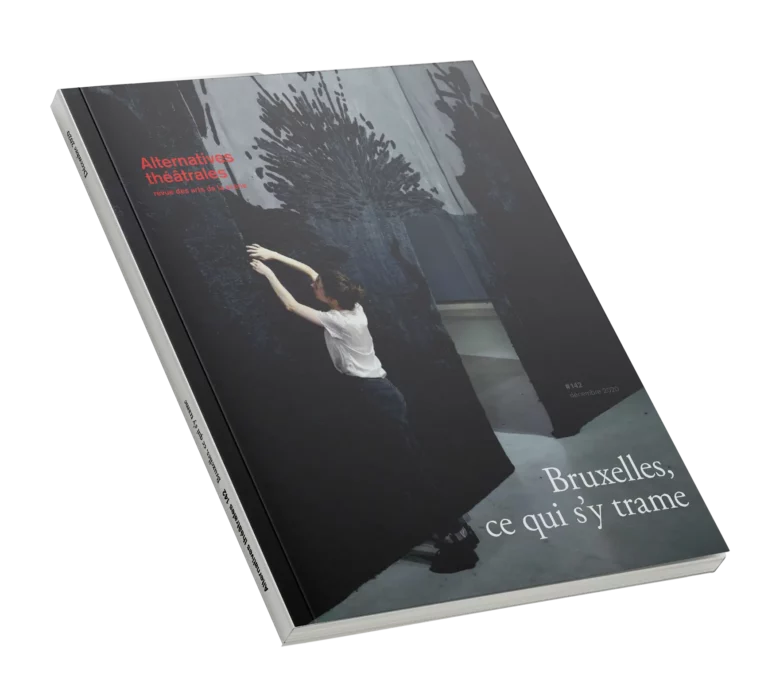Depuis sa création en 1994, le Kunstenfestivaldesarts a, sans conteste, participé à mettre Bruxelles sur la carte des arts scéniques en Europe et dans le monde. Aux côtés d’artistes internationaux aujourd’hui établis, comme Romeo Castellucci, Milo Rau et Marlene Monteiro Freitas, ce sont aussi plusieurs générations de créateur.rice.s issu.e.s de la scène bruxelloise bicommunautaire qui font l’histoire du festival et réactualisent localement et internationalement l’effervescence artistique de la ville. Un projet artistique anime le festival depuis son origine : remettre en question notre vision de l’art contemporain et de ses modes d’expérience, en soutenant et en produisant des créations souvent expérimentales et interdisciplinaires qui réfléchissent le présent mais ne se laissent pas réduire à une esthétique ou une thématique commune. Chaque année au mois de mai, la programmation met en résonance théâtre, performance, arts visuels, cinéma, approches pédagogiques, théoriques et activistes, pour vivre ce « temps que nous partageons »1.
Daniel Blanga Gubbay, directeur artistique du Kunstenfestivaldesarts depuis 2018 avec Sophie Alexandre et Dries Douibi,2 est installé à Bruxelles depuis plusieurs années. Il a pratiqué la ville et la scène artistique en tant qu’habitant, citoyen, bénévole, curateur, programmateur et enseignant à l’Académie royale des Beaux-Arts, et reconnaît avoir une affinité forte avec l’hétérogénéité et le cosmopolitisme culturel de Bruxelles. Sa vision du festival contre l’opposition binaire qui existe parfois entre production artistique locale et internationale, tout en cherchant à comprendre ce que le contexte bruxellois peut faire émerger comme objets artistiques spécifiques. « Avec les tendances de globalisation dans les années 1990 et l’explosion de la circulation internationale des artistes, en particulier des artistes non-européens en Europe, il y a une pression de la part du marché qui réduit parfois les artistes à être des ambassadeurs de leur culture. On leur demande de manière inconsciente de créer des projets qui puissent répondre à l’imaginaire exotique et à l’héritage colonial qui existe encore autour du monde arabe, de l’Afrique subsaharienne ou de l’Amérique latine par exemple.3 » À l’échelle de Bruxelles, soutenir le travail d’artistes comme Sara Sejin Chang, Cherish Menzo et Radouan Mriziga, c’est partager la sensibilité pour la complexité de leur travail, la multiplicité des expressions culturelles, et résister à l’homogénéisation des imaginaires. Il trouve aussi intéressant de « travailler avec des artistes internationaux qui connaissent moins Bruxelles et permettent de porter une vision qui n’est pas encore inscrite dans les règles silencieuses qui existent déjà dans une ville. »
Pour Daniel Blanga Gubbay, naviguer à l’intérieur et en dehors des institutions culturelles est une condition importante pour rencontrer des œuvres qui renouvellent le langage artistique. Cela implique de reconsidérer le régime de visibilité qui forge notre perception de ce qui compose la scène émergente bruxelloise, ou de ce qui en est justement exclu. « Des artistes sont parfois placés sous la catégorie “ arts urbains ”, parce que ne répondant pas aux codes esthétiques qui les placeraient dans “ le bon périmètre du contemporain ” et tels qu’ils sont sous-entendus par les institutions dominantes, majoritairement blanches. Parallèlement, le Kunstenfestivaldesarts n’est pas une référence pour de nombreux bruxellois.es qui n’évoluent pas dans les mêmes réseaux. Le visible et l’invisible ne tiennent donc pas en tant que catégories définitives. » Selon Blanga Gubbay, il est essentiel de redessiner la cartographie des collaborations qui organisent le secteur culturel afin d’imaginer de nouvelles écologies à partir de ce qui existe déjà, en dehors des hiérarchies. L ’« agency » – ou la capacité d’une institution à se questionner et à se transformer de l’intérieur aussi bien au niveau de la programmation et des publics que de sa propre structuration – est une condition fondamentale pour soutenir des pratiques artistiques émergentes dans toute leur singularité. Qui y est présenté et représenté ? Qui vient voir le travail ? Dans quelles conditions ? Qui rend le festival possible ? L ’accompagnement artistique implique donc d’interroger chaque artiste sur ce que le contexte spécifique du festival peut rendre possible : une création in situ, une collaboration avec des écoles, associations ou collectifs ; l’implication de publics spécifiques ; des projets aux temporalités et aux géographies marginalisées, etc. « Ce que je trouve intéressant chez les artistes bruxellois.es avec qui on est en dialogue, c’est la liberté qu’iels prennent de ne pas immédiatement traduire ou produire leurs intuitions artistiques en un format préétabli. Il doit y avoir de l’espace pour comprendre plus tard quelle forme le projet prendra. » Le caractère nomade du festival, qui a lieu grâce à une vingtaine de lieux partenaires, permet aussi de suivre le développement d’une œuvre sans prérequis de salle ou de formes esthétiques, et de sortir de cette idée qu’il faut « domestiquer la création artistique à l’intérieur de formats existants ».