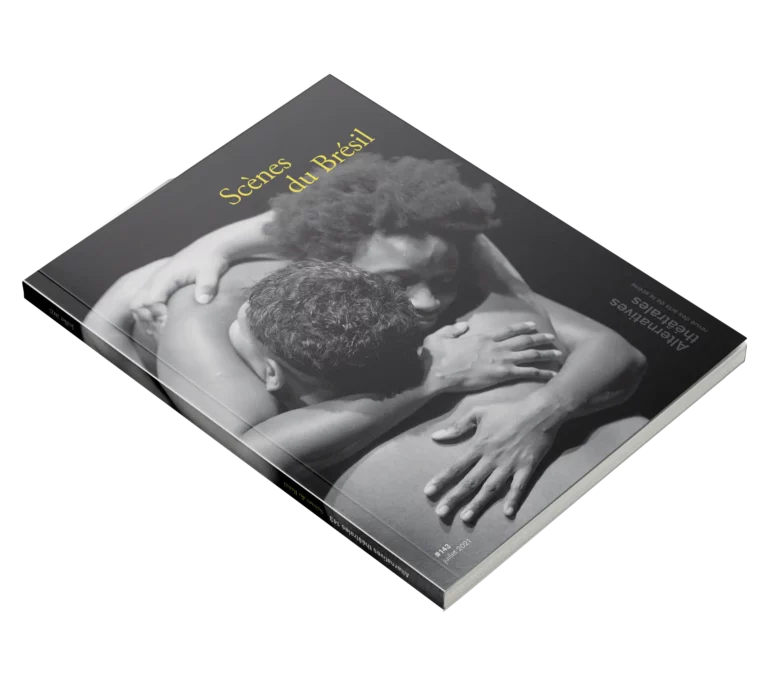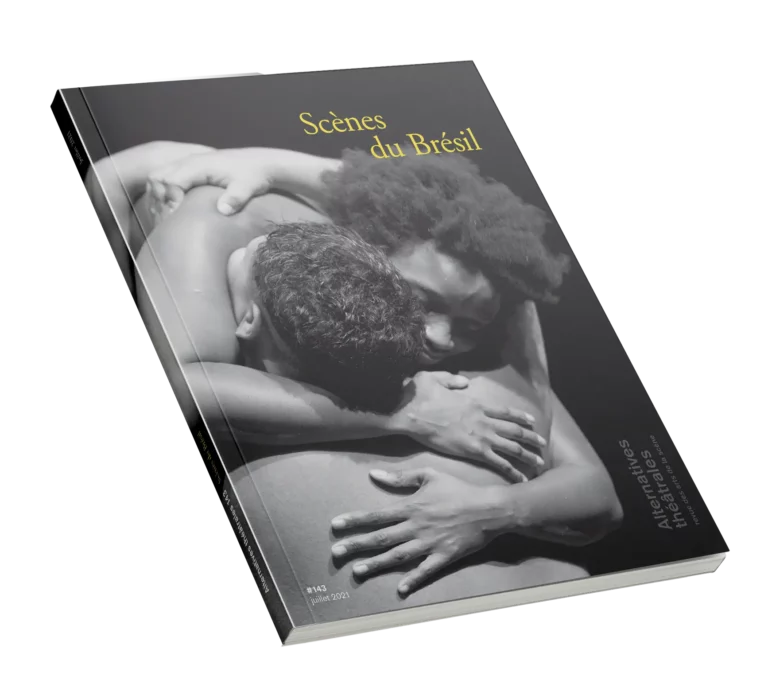Seizième siècle, début de la colonisation portugaise sur les terres brésiliennes. Les prêtres de la Compagnie de Jésus, qui cherchent à inculquer la foi chrétienne aux peuples de la forêt, utilisent les représentations théâtrales comme premier instrument de catéchèse.
Inspirées des moralités médiévales, les pièces mélangeaient le portugais, l’espagnol et le tupi – l’une des langues autochtones – et l’opposition Dieu-Diable constituait le centre de la dramaturgie. Leur prétention, par rapport aux peuples indigènes, était « d’anéantir toute leur singularité, d’abolir en eux tout ce qui les différencie des Européens »1 au profit du projet colonial.
C’est ainsi qu’est né, avec un caractère pédagogique, ou plutôt éminemment didactique, ce qui allait être légitimé comme « le » théâtre au Brésil. Nous proposons ici au lecteur un éclairage sur la dimension pédagogique présente dans la scène actuelle du pays. Comme nous le verrons, cette dimension marque une série d’initiatives qui se caractérisent par l’expérimentation et l’audace, en même temps qu’elles sont traversées par de constantes instabilités et par la précarité du soutien public.
Nous aborderons ici la pédagogie des arts de la scène envisagée, selon un point de vue large, comme une réflexion sur les finalités et les modalités de connaissances impliquées dans les processus d’apprentissage des arts de la scène. Des références théoriques issues de multiples domaines de connaissance et d’aspects méthodologiques variés caractérisent cette pédagogie. Stanislavski, Grotowski, Barba et, dans le cas du Brésil, Augusto Boal, sont devenus des metteurs en scène pédagogues de référence en associant radicalement l’épuration de leur art à l’épanouissement personnel de ceux qui le pratiquaient.
Ainsi, les principes qui fondent aujourd’hui les pratiques des artistes et des enseignants dans ces apprentissages sont le résultat d’une vision contemporaine de la scène qui comprend, entre autres facteurs, une extension de la notion de théâtralité au-delà des schémas établis, la valorisation du travail collectif, la remise en cause de la relation entre celui qui joue et le spectateur et enfin la mise en avant de la réflexion sur le processus de création lui-même. Des domaines tels que le théâtre-éducation, le théâtre professionnel ou le théâtre amateur, dont les limites étaient jusqu’à récemment clairement établies, ne sont plus aussi nets ; les fusions, les croisements et les passerelles entre eux mettent en évidence les traces des préoccupations pédagogiques dont ils sont porteurs.
Les établissements de l’enseignement primaire et secondaire, la formation d’acteurs et de danseurs dans des cours spécialisés, les modalités d’action culturelle promues par des institutions publiques, privées et les ONG, les activistes de la société civile, les personnes à besoins spécifiques, les personnes âgées, les institutions telles que les prisons2 et les hôpitaux sont quelques-uns des terrains où agissent les professionnels engagés dans des visions pédagogiques de la scène. L’éventail est large et couvre à la fois le système éducatif et l’éducation dite non formelle. Il s’agit de pratiques et de savoirs qui contribuent à des modes de subjectivation prenant appui sur le caractère virulent de l’art, à contre-courant de l’establishment. Le dialogue en vue des transformations sociales, la lutte contre les préjugés et les inégalités et contre les modes de vie hégémoniques dans le capitalisme, s’imposent au premier plan. Comme on pouvait s’y attendre, les processus d’apprentissage et de création traversés par de telles valeurs provoquent – et ce n’est pas plus mal – des malaises, des questionnements et des frictions.
Dans le cas du Brésil, les universités publiques réparties dans tout le pays sont au cœur des avancées significatives observées dans ce domaine depuis les années 1970. Les étudiants en licencia- tura (diplôme équivalent à un Bac+4 qui confère à son titulaire l’aptitude à l’enseignement) sont formés comme professeurs de théâtre ou d’arts du spectacle par des enseignants eux-mêmes metteurs en scène, acteurs, scénographes, etc., et simultanément détenteurs d’un doctorat3.
La pratique et la réflexion s’influencent mutuellement, ce qui est alimenté par l’accent mis sur la recherche académique et artistique dès l’entrée de l’étudiant à l’Université. En réponse à une politique d’encouragement à l’obtention de diplômes de master et de doctorat dans les établissements publics, la recherche universitaire génère un large éventail de publications qui consolident le champ de la pédagogie des arts du spectacle dans le pays.
L’enseignement des arts (théâtre, danse, musique, arts visuels) est rendu obligatoire par la loi dans les écoles publiques et privées depuis 1996. Cependant, l’institution scolaire, au cœur du projet démocratique, reflète les profondes inégalités de la société brésilienne. D’une part, nous avons des écoles privées très sophistiquées qui s’adressent à peu de gens et, d’autre part, il est évident que l’enseignement public, toujours présent dans la rhétorique des gouvernants, n’est toujours pas soumis au respect de la législation et ne reçoit pas l’attention nécessaire. Des enseignants mal formés et mal payés travaillant toute la semaine dans diverses écoles aux installations insatisfaisantes, constituent une situation de précarité pédagogique et matérielle qui place le Brésil dans une très mauvaise position en matière d’éducation parmi les nations dites émergentes. Ces circonstances expliquent la faible reconnaissance sociale des enseignants du primaire et du secondaire.
Le manque de mobilisation de la société autour de ces besoins explique en grande partie le peu d’intérêt des étudiants récemment diplômés pour l’enseignement artistique dans la sphère publique.
Formés pour dispenser les matières Théâtre ou Danse dès la sixième au collège (11 ans) et jusqu’à la terminale au lycée (17 ans), peu de jeunes professionnels sont prêts à faire face aux difficultés présentes dans le système éducatif.
Le paradoxe est évident : les universités publiques – certes les plus prestigieuses – forment des professionnels qui se vouent peu à l’éducation publique des enfants et des jeunes.
Trois axes sont définis par la législation pour guider l’enseignement : la pratique artistique, l’appréciation de l’œuvre d’art et la compréhension de son contexte historique et social. Si chacun de ces axes peut devenir le point de départ pour traiter les autres, ce qui est observé en classe est la primauté absolue du premier. À ce jour, la grande influence exercée par les défenseurs de la libre expression4, notamment dans l’enseignement du théâtre et des arts visuels, se reflète dans les institutions scolaires, se traduisant par un certain laisser-faire – nous parlons là de la primauté de l’expression individuelle des enfants et des jeunes, sans tenir compte de la jouissance des œuvres, de la pertinence de leur signification symbolique ou de l’héritage culturel qu’elles représentent.
Bien que lentement et non sans obstacles, ce panorama est en train de changer au cours des dernières décennies. En lien avec le développement des manifestations théâtrales contemporaines qui n’entendent pas promouvoir l’illu- sion, mais plutôt suggérer, ce sont des formes de caractère ludique qui apparaissent aujourd’hui au premier plan dans les processus avec les enfants et les jeunes à l’école. Manifestation de la contradiction féconde entre « d’un côté le plaisir ludique de l’invention, et de l’autre l’expérience esthétique de la contrainte des formes », selon les mots de Pierre Voltz5, les processus d’apprentis- sage et de création basés sur l’incertitude du jeu et de l’action improvisée sont la clé de voûte des arts de la scène dans les établissements scolaires.
Les theater games développés par l’Américaine Viola Spolin dans les années 1960, connus dans tout le Brésil grâce aux recherches initiées à l’Université de São Paulo, ainsi que les jeux dramatiques diffusés par le Français Jean-Pierre Ryngaert6 constituent des références pour l’action théâtrale évoquée ci-dessus. Les deux modalités se dispensent de toute exigence préalable à l’acte même de jouer, considèrent que la disponibilité pour l’expérience et le caractère collectif sont des points centraux des processus d’apprentissage et envisagent l’appréciation des spectateurs – membres du groupe de joueurs, en alternance – comme un facteur important pour le développement artistique des participants.