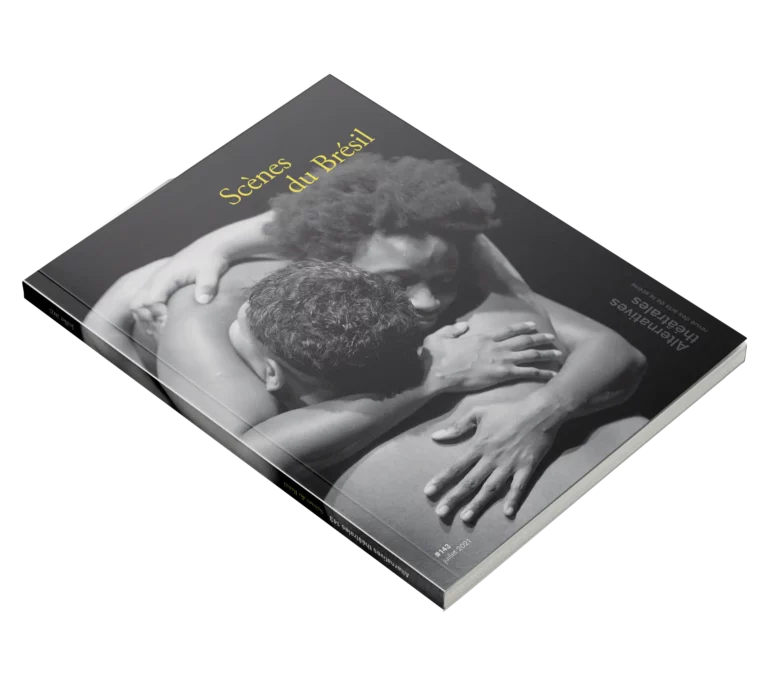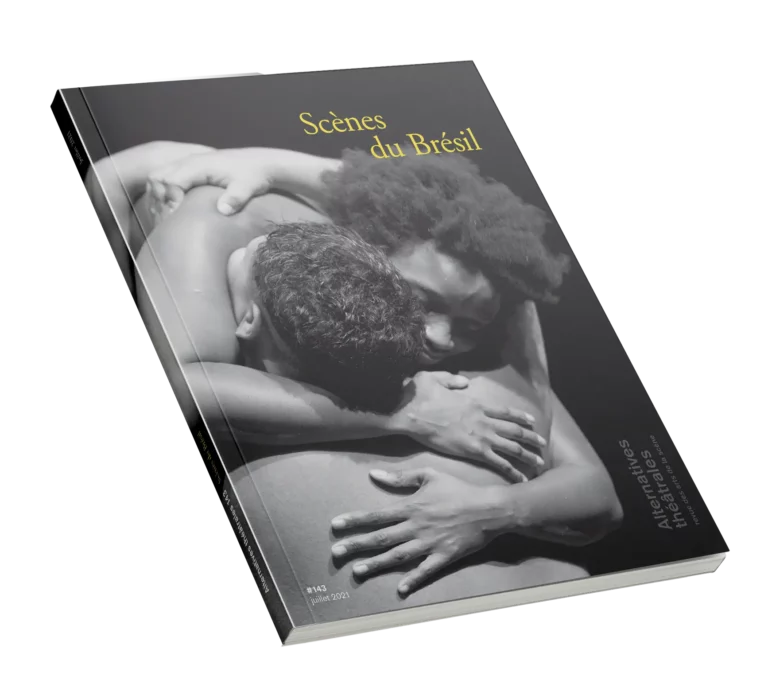1.
Je me pencherai ici sur deux œuvres montées par de jeunes artistes en cours de formation au sein d’universités situées dans deux différents États du Brésil : le spectacle Histórias Compartilhadas (Histoires partagées), à l’Université fédérale du Ceará dans la ville de Fortaleza, dans la région nord-est du pays ; et la pièce Isto é um Negro ? (Ceci est un Noir ?), dans le cadre du cours de formation professionnelle d’acteurs de l’École d’art dramatique de l’Université de São Paulo, dans la région sud-est. Dans les deux cas, les artistes ont mené au préalable une vaste recherche, respectivement documentaire et théorique, durant près d’une année. Ils ont également en commun le fait que les processus de création ont pris place au cours de la période qui a débuté avec la gestation (en 2015) et l’aboutissement (en 2016) du coup d’État contre la présidente Dilma Rousseff, démocratiquement élue en 2014 pour son second mandat. Le putsch mené par la droite s’est renforcé par la sentence d’emprisonnement à l’encontre de Luiz Inácio Lula da Silva, dirigeant ouvrier et populaire, prédécesseur de Rousseff qui aurait probablement été à nouveau élu président du Brésil en 2018 si sa candidature n’avait pas été ainsi empêchée. Jair Bolsonaro, homme politique d’extrême droite, gouverne le pays depuis 2019.
Au sein des secteurs critiques et d’opposition, les tensions affleurent. Les désaccords internes au sein de la gauche s’étaient intensifiés sous les gouvernements du Parti des Travailleurs pour apparaître au grand jour lors des Journées de juin, ces grandes manifestations qui ont eu lieu en 2013 dans tout le pays, au caractère autonome, organisées indépendamment des partis ou des syndicats traditionnels. Depuis la destitution de Rousseff, les divisions n’ont fait que s’accentuer. Les points de vue s’affrontent, aussi nombreux que disparates, sur les questions prioritaires autant que sur la légitimité de la parole des dirigeants, la représentativité de ceux qui s’expriment au nom des opprimés et des laissés-pour-compte, les manières d’organiser les luttes, ou encore l’appréhension de l’idée de communauté et de sa portée.
Les deux spectacles commentés ici traitent de réalités effectives. Mais, au-delà de leurs référents dans le monde, ces artistes démontrent qu’ils portent une attention particulière à la façon de produire des images. Leur autoréflexion sur la place sociale et la position de sujet qu’ils occupent intègrent aussi les images théâtrales qu’ils produisent. Les œuvres ne s’en tiennent pas à inverser l’ordre hiérarchique dans des oppositions comme hétérosexuel-homosexuel, cisgenre-transgenre, blanc-noir, homme-femme. Plus que cela, elles s’attachent à réaliser une déconstruction des dualismes et des dichotomies.
2.
Le spectacle Histórias Compartilhadas est ce que l’on appelle au Brésil un Travail de Conclusion de Cours (TCC)1, réalisé par Ari Areia à la fin de sa formation en journalisme.
Cette brève œuvre théâtrale d’environ 50 minutes a été structurée à partir des caractéristiques du théâtre documentaire et semble n’avoir exploité qu’une partie des témoignages recueillis durant la recherche. Areia est l’unique interprète2 du spectacle mis en scène par Eduardo Bruno et réalisé par Outro Grupo de Teatro.
Durant la pièce, qui reprend le format du journal télévisé comme modalité discursive, Areia utilise différents moyens pour présenter des personnes ayant vécu une transition de genre Female to Male. N’incarnant pas les personnages, ce dernier n’est qu’un médiateur et un opérateur de média audiovisuels. Jeune artiste lui-même cisgenre, Areia a conscience que ce statut de médiateur et d’opérateur exige de lui une série de précautions à l’égard des personnes dont il parle et qui s’expriment elles-mêmes. Le procédé de médiation qu’il déploie demande de sa part une extrême délicatesse dans son jeu, qui maintient une passivité délibérée et adopte la plupart du temps un ton mineur. Le performer semble aussi avoir une conscience aiguë du fait que les référents de sa pièce-reportage (autant les sujets dont il parle que lui-même, acteur-reporter) ne peuvent se constituer théâtralement comme réels qu’au moyen d’une certaine économie des images (coupées et collées) et de leur juxtaposition séquentielle. Pendant qu’Areia effectue en silence une série d’actions en tant qu’opérateur des ressources théâtrales mobilisées, on entend la voix grave de l’écrivain transsexuel João W. Nery (décédé en 2018) lire un extrait de son autobiographie dans lequel il raconte les douleurs et les espérances qui s’entremêlaient pendant sa convalescence après son opération de réassignation sexuelle3. On verra également des extraits de films pornographiques au milieu d’un récit de Buck Angel, acteur porno transsexuel nord-américain. On accompagnera encore les témoignages et les entretiens avec d’autres hommes transsexuels.
Les œuvres ne s’en tiennent pas à inverser l’ordre hiérarchique dans des oppositions comme hétéro-sexuel – homosexuel, cisgenre – trans-genre, blanc-noir, homme – femme. Plus que cela, elles s’attachent à réaliser une déconstruction des dualismes et des dichotomies.
Areia a essuyé non seulement des critiques, mais aussi des attaques agressives sur Internet de la part de groupes conservateurs l’accusant d’offenser la religion, pour l’utilisation qu’il fait de l’image de Jésus. Leur accusation est-elle fondée ? Quand le spectateur entre dans la salle du théâtre, l’unique interprète est déjà sur scène, vêtu d’un costume noir, portant des chaussures noires elles aussi. Son attitude est à la fois formelle et discrète. Il est assis, à l’extrémité gauche de la scène, en silence, il lit simplement le livre qu’il tient entre les mains. À côté de lui, une petite étagère à deux tablettes. Sur celle du dessus, un téléviseur et, au-dessous, une petite sculpture représentant un Jésus miséricordieux. Aucun élément matériel autour d’elle ne saurait constituer, par sa proximité, le signe d’une opposition offensive à l’image religieuse. Ensuite, quand l’acteur retire du sang de son bras à l’aide d’une seringue pour le répandre sur l’image de Jésus, aucune agressivité ne transparaît dans sa posture. À l’égard de l’icône sacrée, Areia adopte la même attitude sobre et respectueuse que vis-à-vis des sujets des différents épisodes de la pièce.
Dès le début, on voit au centre de la scène deux bonbonnes d’eau de vingt litres. La première, rose, est pleine. L’autre, de couleur bleue, est vide.