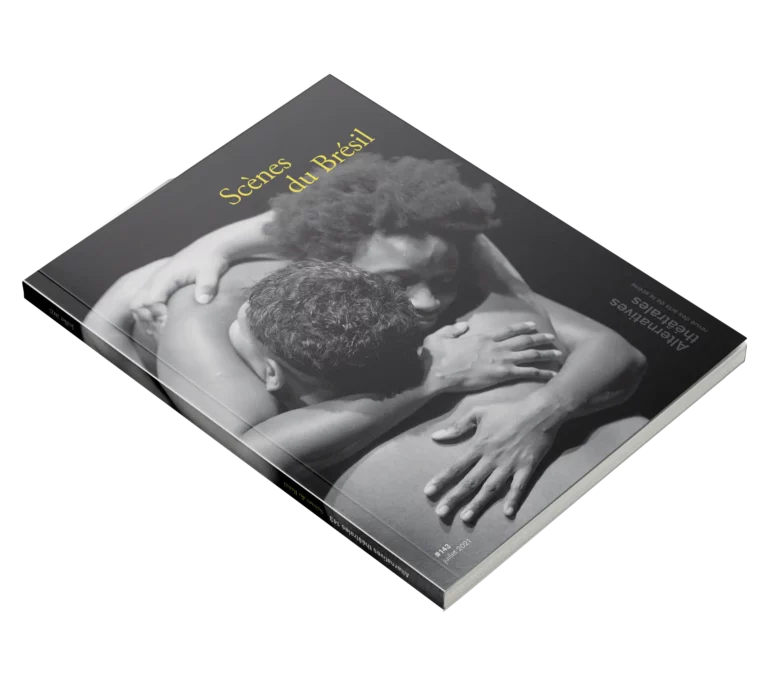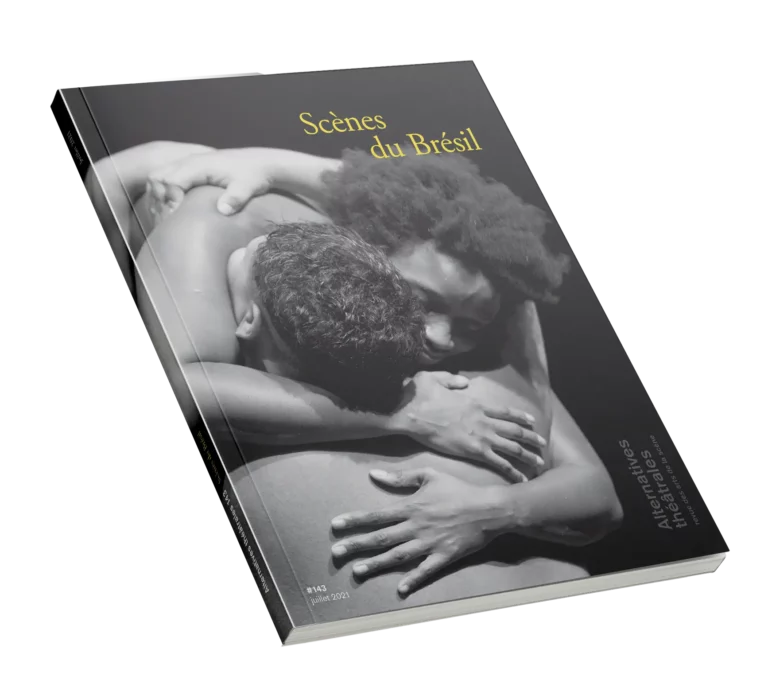Le souvenir de l’après-midi passée avec un groupe d’adolescents à Nova Holanda, l’une des seize communautés qui composent la favela da Maré, reste encore gravé dans ma mémoire. La rencontre a eu lieu en 2010. J’étais accompagnée de quelques étudiants de l’Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro — UNIRIO et le but de notre visite était de discuter avec ce groupe d’adolescents du quartier sur l’idée de mener un projet théâtral avec eux. La proposition a été accueillie avec enthousiasme et, la semaine suivante, nous avons entamé des cours de théâtre dans un espace de l’association Redes da Maré. Surgissait ainsi l’ébauche du programme d’extension universitaire Teatro em Comunidades1 (Théâtre dans les communautés) qui accomplira, en 2021, une décennie d’existence.
Au Brésil, « extension universitaire » désigne toutes les activités promues par les établissements d’enseignement supérieur qui visent à interagir avec d’autres sphères de la société, constituant ainsi un pont permanent entre une université et la ville dans laquelle elle est située. En tant que professeur au département de licenciatura2 en Théâtre à l’UNIRIO, j’ai été l’une des fondatrices du programme d’extension universitaire Teatro em Comunidades en m’appuyant sur mes recherches et mes pratiques développées au cours de plus de dix-huit ans. Des cours de théâtre, pour enfants, adolescents et adultes, sont dispensés par des étudiants de l’UNIRIO dans les espaces du Centre d’Arts de la Maré (CAM), du Centre Américo Veloso et de l’Arena Carioca Dicró. Il s’agit de rencontres hebdomadaires régulières durant lesquelles la plupart des participants entrent en contact pour la première fois avec le langage théâtral.
Pour que ce projet prenne l’ampleur qu’il a aujourd’hui, il a été indispensable d’établir des partenariats solides. L’une de nos institutions partenaires est l’Association Redes da Maré3 dont les actions s’organisent autour de quatre axes considérés comme structurants pour améliorer la qualité de vie et garantir des droits élémentaires à la population du quartier de la Maré. Dans l’axe « Arts et Culture » sont comprises les activités du Centre des Arts de la Maré (CAM). Le programme est également soutenu par le Centro Américo Veloso, centre municipal de santé de la ville de Rio de Janeiro où travaille l’orthophoniste Clarisse Lopes qui intervient également dans notre programme. Enfin, nous comptons sur le soutien de l’Observatório de favelas4 (observatoire des Favelas), l’ONG gestionnaire de l’Arena Carioca Dicró située dans le quartier voisin, la favela de la Penha.

Le quartier de la Maré est situé en bordure de la Baie de Guanabara, entre l’avenue Brasil et la voie express Presidente João Goulart (communément appelée par les habitants de la ville Linha Vermelha [voie rouge]), les deux principales voies d’accès à la ville de Rio de Janeiro, et compte aux alentours de cent quarante mille habitants. Comme bien d’autres périphéries urbaines brésiliennes, délaissées successivement et historiquement par les pouvoirs publics, son quotidien est ponctué par la combinaison d’innombrables difficultés : un faible taux de scolarisation, une cohabitation avec des groupes criminels, des conflits armés fréquents et une forte discrimination à l’encontre de ses habitants. Selon un compte-rendu5 élaboré par l’association Redes da Maré, ce qui interfère le plus négativement dans la vie de la population locale est la présence de réseaux liés au trafic de drogues ou de groupes paramilitaires qui exploitent les services de base, monopolisant les fonctions que l’État est censé réglementer. L’étude révèle également qu’en 2019, avec l’augmentation des opérations policières dans la région, il y a eu, dans la favela da Maré, 117 jours de fusillade au total sur une année et que toutes les semaines sur la même année, une personne au moins est morte victime de cette violence. Ce panorama renvoie à ce qu’Achille Mbembe a nommé de « nécropolitique »6. En effet, à travers cette notion, le philosophe camerounais questionne les limites d’une souveraineté quand un État choisit qui doit vivre et qui doit mourir.
Cependant, ce tableau n’est qu’une image partielle que l’on peut donner de la Favela da Maré. Malgré les insuffisances chroniques de l’État à assurer des services publics de base [santé, sécurité, éducation et culture], de nombreuses organisations sociales — telles que celles déjà évoquées et avec lesquelles le programme « Teatro em comunidades » collabore — cherchent à promouvoir un réseau de développement durable visant la transformation structurelle de l’ensemble des favelas. Le récit qui identifie l’espace des favelas à ses seules violences risque de renforcer la stigmatisation sociale imposée à ces territoires et leurs populations. L’identification de la favela comme lieu des carences et des violences a été historiquement construite et, encore aujourd’hui, elle marque l’imaginaire commun. Tout en défendant la « construction d’une autre représentation des favelas — au-delà de leurs absences les plus visibles »7, je pense qu’il est important de diffuser un récit alternatif qui puisse rendre compte de la favela telle qu’elle est : un espace de résistance et de créativité dans lequel la grande majorité de la population fait partie de la classe ouvrière. C’est à partir de cette perspective que nous développons notre pratique théâtrale dans ce programme.