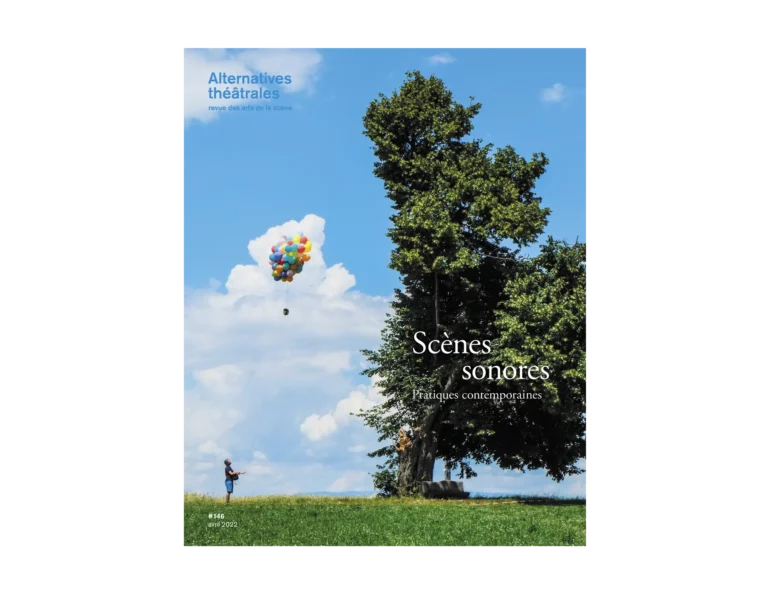Au théâtre, nous jouons avec l’espace. La définition de cet espace est une quête récurrente de chaque création. Depuis de nombreuses années, je m’interroge à propos de sa nature et de sa médiatisation. Comme beaucoup de concepteurs-rices sonores pour le théâtre, je me questionne sur l’écriture du son dans l’espace, le cœur même de notre métier.
Nos écoutes de l’espace
La recherche de formes sonores pour la scène pose principalement la question de la diffusion des médias. Un son enregistré n’existe que dans l’espace de sa diffusion. Cependant, disposer des enceintes dans la zone d’écoute ne suffit pas à définir un lieu. Les haut-parleurs ne sont que la dernière étape de multiples processus. Comment alors esquisser les éléments structurels d’une écriture dans les trois dimensions ?
Notre rapport à l’environnement sonore est singulier. Nous appréhendons l’espace avec notre propre culture. Tout le monde n’est pas sensible aux mêmes sonorités et chacun entend l’environnement sonore différemment. Écouter, c’est se positionner dans le monde, trouver sa place dans le milieu où l’on se situe. Dans un environne- ment sonore intrusif, le besoin de s’échapper, de fuir est irrémédiable… Je n’ai pas de place dans cet espace ! Si notre écoute est singulière, elle est aussi diffractée. Nous entendons les sons autour de nous, mais notre écoute n’est pas homogène. Chaque son qui nous entoure, proche ou loin- tain, est perçu de manière très différente. Nous avons la capacité de nous focaliser sur les sons que nous sélectionnons en jouant avec l’espace. Nous pouvons apprécier le détail d’un son situé dans une pièce voisine et en négliger un autre, pourtant plus proche de nous. La précision de notre perception spatiale n’est pas homogène. Nous avons une grande faculté à localiser les éléments sonores situés devant nous, dans notre cône de vision. Sur les côtés, à gauche ou à droite, nous sommes moins précis. Derrière nous, la perception est très imprécise et nous ressentons le besoin de tourner la tête pour vérifier visuellement la cause du son alors perçu. Sur le plan vertical, nous sommes encore moins capables de localiser précisément la situation d’un son situé au-dessus de nous. La définition de la verticalité passe souvent par des indices qui nous aident à préciser sa complexité. Par exemple, le timbre du son d’une goutte d’eau qui tombe au sol nous renseigne sur la hauteur de son origine. En effet, l’espace sonore est inscrit dans la matière même du son. Les éléments sonores qui arrivent à nos oreilles portent en eux l’espace où ils se propagent. Il n’y a pas de son sans espace1 et chaque matériau sonore est une signature spatiale, même avec les sons de synthèse. L’utilisation, parfois abusive, des effets de réverbération artificielle révèle la nécessité qui existe de toujours situer la matière sonore elle-même dans un espace. Un son trop « sec » ou trop « mat » ne sonnera pas, même s’il est localisé dans un endroit particulier. L’aspect sémantique des éléments sonores participe également à la localisation dans l’espace perçu. Le bruit d’une pelle qui creuse vient du sol, celui d’un avion vient du le ciel. Tous les sons ont une histoire spatiale. Même abstraits, ils sont révélateurs de la dynamique qui leur a donné naissance dans un lieu particulier. Il suffit d’en- tendre une femme en talons marcher hâtivement sur un trottoir pour être transporté dans l’espace urbain d’un centre-ville. Ces talons signent aussi des espaces sociaux. Ils créent un rapport parti- culier à la féminité et la rapidité du pas engendre des interrogations. Pourquoi est-elle pressée ? Est- elle en danger ? La définition d’un espace sonore est liée à l’histoire des sons qui le composent, à leurs dramaturgies propres.
Nous sommes très sensibles aux mouvements d’éléments sonores. Un déplacement, même mineur, attire instantanément notre attention. Notre cerveau reptilien est en alerte. Ça bouge ! Et si ça bouge, c’est vivant ! Comment ce vivant induit par le mouvement peut-il être en phase avec le vivant du plateau ? Les physiciens nous l’on dit, un mouvement, c’est du temps dans l’espace. Mais les temporalités d’un mouvement sonore ne sont pas linéaires. Il peut accélérer, ralentir, s’immobiliser puis reprendre sa course. Sa géographie n’est pas linéaire non plus. La trajectoire peut être tordue, hésitante de droite à gauche, pour finalement revenir en arrière…
Le son d’un élément acoustique du plateau, un violoncelle par exemple, peut s’échapper et partir dans la salle pour revenir ensuite à sa place d’objet acoustique. Cette faculté à saisir les mouvements, à les désigner comme des entités propres met en perspective la nécessité de comprendre le vocabulaire de ces mouvements sonores. Ils peuvent être complexes et ce sont de véritables éléments d’écriture. Les musiciens contemporains les ont intégrés dans leurs compositions, souvent avec talent. Cependant c’est un champ qui reste à explorer au théâtre. Peu de créations travaillent à cet endroit, le mouvement de sons en temps réel est une exception dans les spectacles actuels. Enfin, notre écoute de l’espace est multiple. Une multiplicité d’approches pour la diffusion sonore est donc nécessaire. Nous devons gérer un nombre croissant de paramètres dans les temporalités variables qui se dessinent au cours de la création. Il faut peut-être aujourd’hui questionner nos habitudes de travail au regard du besoin spécifique d’outils souples et rapides à mettre en œuvre.
Multidiffusion, diffusion multiple