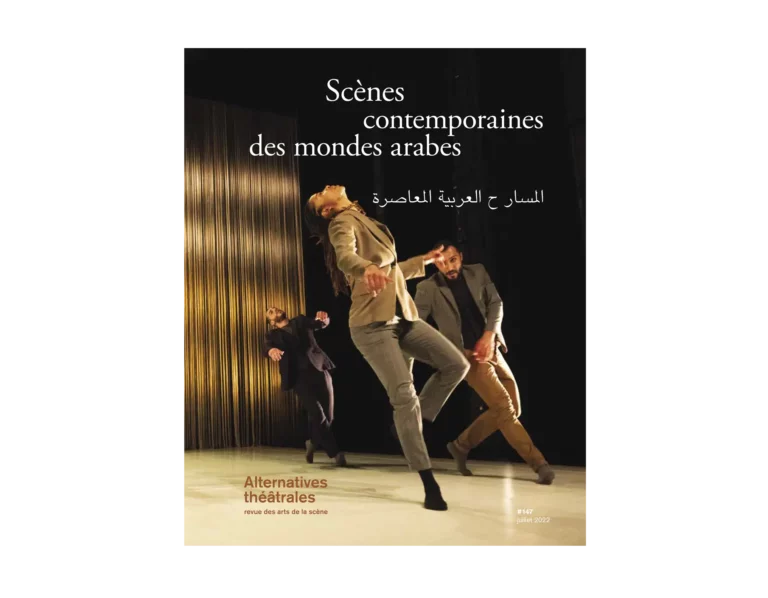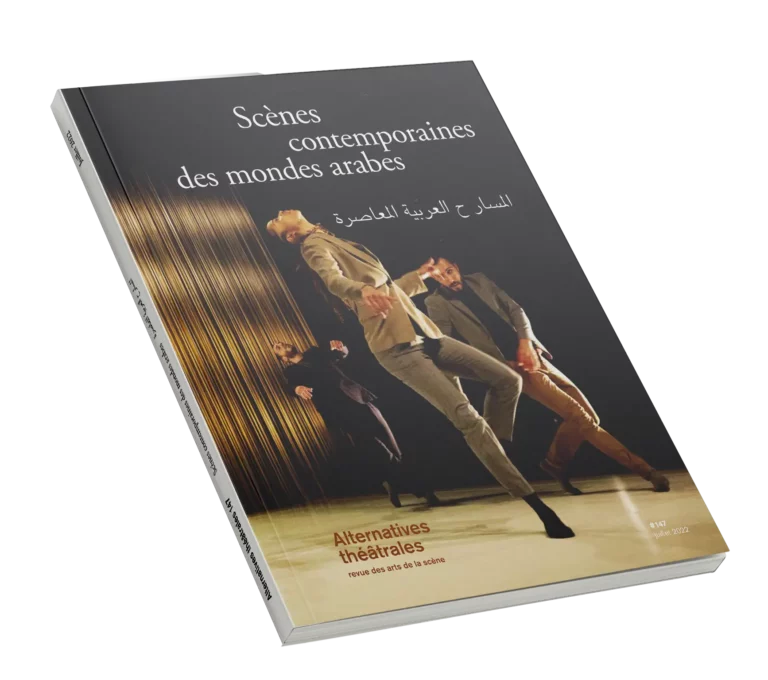Le Maroc n’a découvert le théâtre que vers le début du xxe siècle, quand un groupe de jeunes a monté la pièce Saladin en 1927. Si les Marocains ignoraient le théâtre à l’italienne, ils savaient ce qu’était la théâtralité puisqu’ils étaient familiers des formes spectaculaires propres à leur culture dont les places publiques, comme Jamma el Fnaâ, étaient le théâtre. Ce qui expliquerait, selon certains chercheurs, leur prédisposition à accueillir favorablement cette nouvelle forme artistique qu’ils ont adoptée très rapidement. Néanmoins tout le long de son histoire, hormis une courte période au cours des années 1950, le jeune théâtre marocain n’a jamais bénéficié d’une vraie politique publique. La gestion des activités théâtrales a longtemps été confiée au ministère de la Jeunesse et des Sports au même titre que les sports et les actions en faveur de la jeunesse.
Il a fallu aussi attendre longtemps, 1986, pour que l’ISADAC (Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle), première institution publique dédiée à la formation théâtrale, voie le jour et au prix de quels efforts !1 Pendant les années 1980, avec l’arrivée des socialistes au pouvoir et la désignation de Mohammed Achaari, homme de lettres, poète et ancien président de l’Union des Écrivains du Maroc, comme ministre de la Culture, le secteur théâtral a connu une courte embellie grâce à la mise en place d’une politique publique dite de soutien à la production et à la diffusion théâtrale, qui consistait à subventionner une trentaine de troupes locales pour les aider soit à produire soit à diffuser leurs spectacles. Cette politique s’est largement inspirée d’une initiative similaire qui a été prise dans le cadre de la promotion du cinéma marocain et qui a porté ses fruits. Malheureusement, le cinéma n’est pas le théâtre.
Car si la production d’un film peut présenter l’une des phases les plus importantes dans l’industrie cinématographique, la diffusion est moins coûteuse et les possibilités d’exporter un film sont moins contraignantes. Ce qui n’est pas le cas pour le théâtre, qui est un art vivant qui nécessite la mobilisation permanente d’une équipe de comédiens, techniciens, ouvriers, etc., et dont la diffusion et la promotion demandent beaucoup de moyens.
D’autre part, si le public marocain est prêt à payer un ticket pour assister à un film, il ne le fait pas quand il s’agit d’une pièce de théâtre. Aujourd’hui, les femmes et les hommes du théâtre marocain ne peuvent pas compter sur les ventes des billets pour gagner leur pain.
Certes, le Maroc s’est lancé ces dernières années dans la construction de grandes salles de spectacle, à Casablanca et à Rabat – dont les plans ont été dessinés par feue la grande architecte irakienne Zaha Hadid. Mais cela reste insuffisant, car la population a surtout besoin de salles de proximité. Or celles-ci sont rares et quand elles existent, elles sont mal équipées et mal gérées. Les deux problèmes essentiels dont souffre le théâtre marocain aujourd’hui sont, d’abord, l’absence d’une vraie politique publique et d’une vraie stratégie culturelle, susceptibles de garantir une pérennité aux acteurs de la scène locale et de favoriser une expression artistique de qualité. Ensuite se pose le problème de la défaillance, voire du manque d’éducation artistique. La majorité des Marocains connaissent très mal le théâtre, car ils ne l’ont pas étudié ni fréquenté suffisamment pendant leur scolarité. Ce qui explique en partie l’inexistence d’un public pour ce théâtre.
Voici donc le contexte général dans lequel évoluent les acteurs de la scène théâtrale marocaine, dont la majorité dépend des maigres subventions du ministère de la Culture et de quelques institutions publiques comme le Théâtre national Mohamed V situé à Rabat. Si cette nouvelle politique prônée par le nouveau ministre consistant à favoriser les spectacles qui font le plus de recettes se confirme, ce sera un coup dur pour les promoteurs d’un théâtre exigeant, sérieux et expérimental.
Néanmoins, malgré ces défaillances structurelles, malgré les difficultés auxquelles les artistes sont confrontés, et malgré le statut presque marginal du théâtre au Maroc, il y existe des expériences théâtrales de qualité dont les artisans privilégient la qualité artistique, l’expérimentation, au détriment de la facilité, du populisme et du rire gratuit.
La majorité des animateurs de cette « nouvelle scène », que certains qualifient d’alternative, est généralement issue de l’ISADAC. Ce sont des femmes et des hommes qui ont appris les bases du métier du théâtre, dans différents domaines de spécialisation, en suivant un cursus de quatre ans au sein de cette institution. Leur formation de base en plus des multiples stages qu’ils effectuent, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, leur permet de rencontrer de grands noms du théâtre mondial et arabe, à l’instar de Peter Brook, Andrzej Seweryn, Fernando Arrabal ou encore Fadhel Jaïbi… et d’être confrontés à d’autres traditions et pratiques scéniques. Ce qui favorise leur ouverture sur les expériences mondiales tout en restant très attachés à leur territoire. Les lauréats de l’ISADAC sont aujourd’hui les principales figures de la scène théâtrale marocaine.