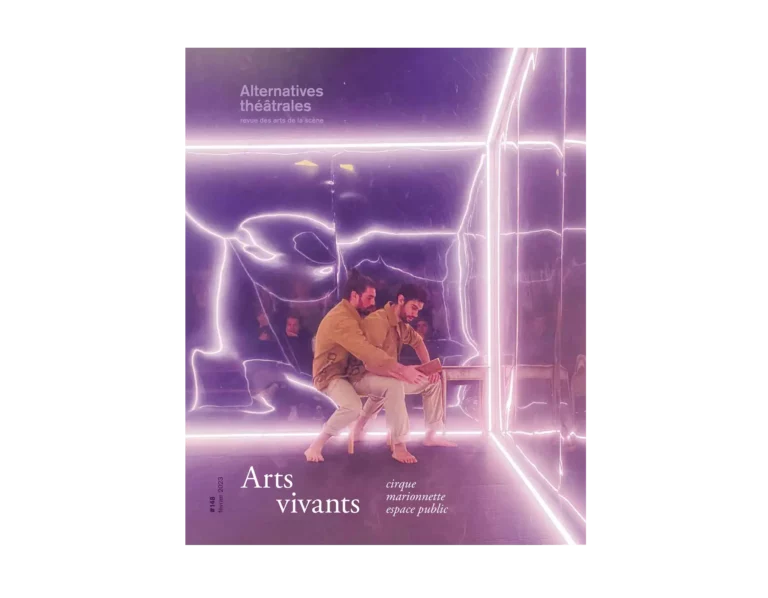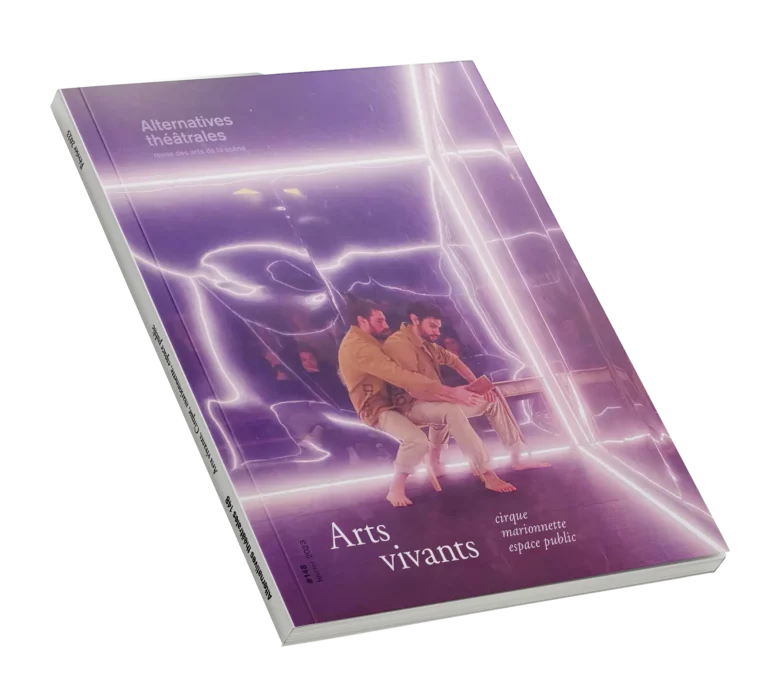Un père emmène sa jeune fille dans la forêt de son enfance, un espace qu’il affectionne tout particulièrement, car propre à l’imaginaire. Il fait nuit. Elle a peur, lui non : aveugle depuis la naissance, il connaît par cœur les chemins sensoriels de l’endroit. Privée de lumière, elle expérimente alors pour la première fois, juchée sur les épaules de son père, la traversée d’un monde qu’elle ne voit pas, mais qu’elle sent tout autour d’elle. Aujourd’hui adulte, elle se tient devant nous, et nous raconte cette histoire, d’abord en mots, puis en voltiges. C’est aussi, dans les coulisses, l’histoire de deux sœurs, l’une scénographe (Cécile Massou) et l’autre circassienne (Sonia Massou), dont le père n’a jamais vu le travail, parce que lui-même aveugle. Sanctuaire sauvage apparaît comme une métaphore scénique de la rencontre entre deux mondes et des relations singulières que chacun·e entretient au visible et au sensible. Poétique donc, cette traversée de la forêt à laquelle nous sommes invité·e·s ne se donne jamais à voir de manière littérale. Les récits du père (enregistrés) et de la fille (en adresse public) contextualisent les référents imaginaires du spectacle (le père, la fille, la forêt, le village en campagne, la grand-mère au coin du feu), sans jamais que ceux-ci nous soient imposés par la suite.

Œuvre collective circassienne du Collectif Rafale, sonore et scénographique, Sanctuaire sauvage fait le pari d’une forme accessible à un public malvoyant, jouant des relations sensibles et complexes entre ombre et lumière, fracas et silence, courant d’air et tempête orageuse. Évoluant dans une scénographie épurée rappelant la mise en espace traditionnelle des cirques sous chapiteau (cercle au centre et spectateur·ice·s autour, assis·e·s sur des gradins très proches de la scène), les trois circassien·ne·s Julien Pierrot, Thibaut Lezervant et Sonia Massou ne cessent de jouer avec la contrainte – mais n’est-ce pas plutôt avec l’horizon ? Il ne s’agit ici plus de donner à voir, mais bien de donner à sentir. Comment donner à sentir le cirque ? La relation entre un porteur et une voltigeuse ? Comment transmettre à tous·te·s le frisson de la chute possible d’un corps dans un numéro de main à main ? La virtuosité d’un jongleur acrobate ? La fluidité d’un mouvement ? Le mouvement en lui-même ? Le parti pris dramaturgique n’est cependant nullement celui d’une adaptation négative, mais bien d’une affirmation esthétique et artistique : l’audiodescription fusionne avec les pratiques circassiennes, scénographiques et sonores. Porteur et voltigeur·euse·s décrivent au présent l’immense et intense travail de concentration physique et mental – en principe invisible – qui leur permet de garder l’équilibre ; mais aussi leurs sensations, douleurs, craintes, soulagements, nous détournant de notre habitude de corps en scène performants et parfaitement silencieux. Les balles du jongleur acrobate sont sonorisées, jouant ainsi avec le principe d’une audiodescription poétisée, car rythmique et musicale. Les créations lumière (Anaïs Ruales), sonore (Victor Praud) et scénographique (Cécile Massou) offrent au public une expérience sensible et sensuelle d’une générosité et d’une finesse rares.
Sanctuaire sauvage est donc l’affirmation d’un geste philosophique et politique : penser une œuvre en termes d’inclusivité des publics permet l’élargissement des possibles d’expression, la réinvention des codes. Cela signifie que penser une inclusivité des publics n’est pas affaire de présupposition limitante, mais bien d’ouverture de nos pratiques artistiques à une multiplicité de rapports au monde et de relations au sensible. C’est la perspective de l’émergence de nouveaux langages scéniques. Toute cette réflexion donne naissance à un spectacle d’une simplicité bouleversante et d’une clarté radicale, saisissant au vol ce qu’il y a d’essentiel dans la présence d’un corps en scène, l’adresse à un public, porter, être por