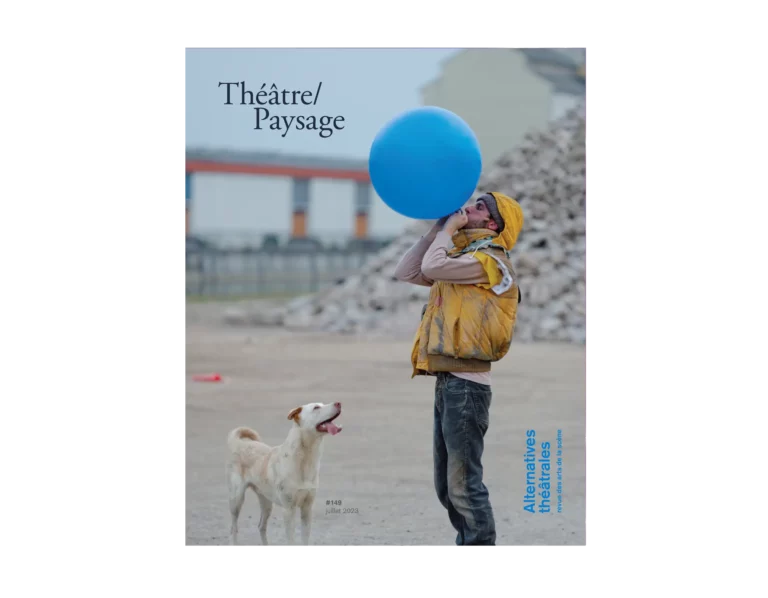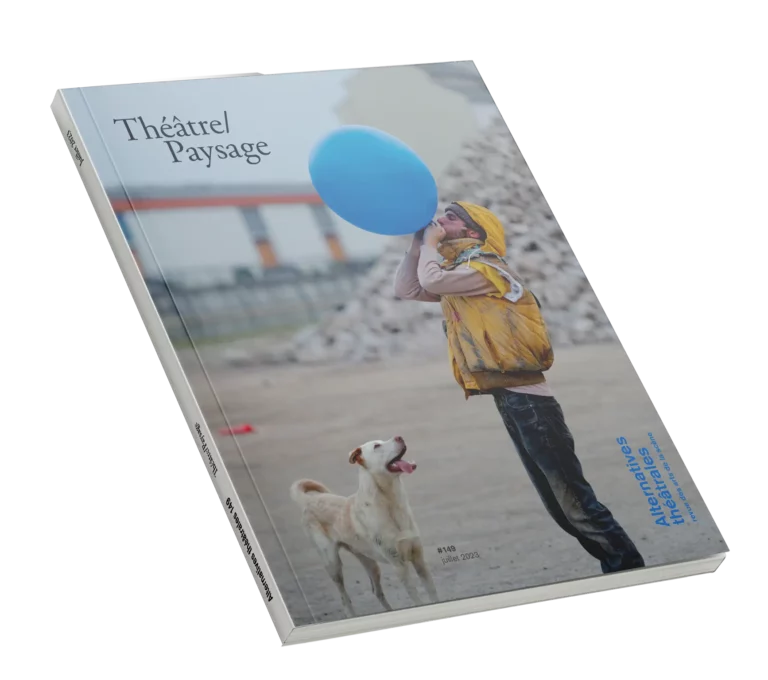Vous menez depuis 2010 un travail commun entre danse, performance et art visuel dévolu à ce que vous nommez une « dramaturgie de la perception ». Comment est née cette collaboration ?
François Bodeux Pour ma part, j’ai d’abord commencé une thèse en sociologie urbaine, avec une sensibilité forte pour l’image, ce qui m’a amené à suivre en parallèle un cursus en photographie. J’ai quitté l’université avant la fin de ma thèse, en étant en crise face à la manière dont on produit du savoir universitaire. L’année suivante, en 2006, je rencontrais Monia aux rencontres d’Arles et nous avons commencé à collaborer ensemble, d’abord au sein du collectif européen de photographes SMOKE puis en tant qu’éclai-ragiste improvisé sur ses premiers solos. En 2009, j’ai repris un cursus en régie de spectacle pour compléter mon bagage technique, sentant qu’il y avait là quelque chose qui m’intéressait.
Monia Montali De mon côté j’ai commencé par des études en arts de la scène à l’Université de Bologne que j’ai aussi interrompues pour déménager à Bruxelles et commencer à travailler comme danseuse. J’ai eu ensuite moi aussi ma petite crise avec le langage de la danse. J’ai arrêté de danser et j’ai commencé des études de photographie. C’est là que j’ai rencontré François. Quelques années plus tard je suis revenue au théâtre parce que la réalité de l’art vivant me manquait. J’ai commencé à travailler différemment. La recherche sur le mouvement chorégraphique en soi ne m’intéressait plus vraiment, c’était plutôt la question de mettre le corps dans un cadre de perception très précis, toute une réflexion autour de la relation entre le corps et l’image.
FB Ce que la photographie nous a aussi apporté, c’est la question du parcours de l’œil et du spectateur. Au sein du collectif SMOKE nous faisions beaucoup d’accrochages, d’editing et cela nous a fait comprendre que la photographie ne consiste pas seulement à produire des images mais nécessite de travailler sur une trajectoire à proposer au spectateur. Cela m’a permis d’appréhender le lieu du théâtre différemment, de penser le travail sur une autre base que celle du récit, une question qui ne m’intéressait absolument pas et qui ne faisait pas écho à nos parcours.
Vous vous qualifiez d’« agrimenseurs du voir », une expression chargée d’une dimension très concrète, voire artisanale de découpage, de mesure. Pourquoi ce choix ?
MM C’est une expression de Georges Didi-Huberman que je trouve très belle. Elle renvoie à une question fondamentale dans notre travail : comment créer les conditions du regard ? C’est-à-dire quel cadre de perception mettre en place et quels sont les mécanismes capables d’activer ou d’infléchir le regard du spectateur ? Il ne s’agit pas ici seulement de vision mais du regard dans sa perception totale, avec le corps, le sensible. Être agrimenseur du voir renvoie aussi à une forme de précision, de rigueur dans l’écriture, pour activer chez le spectateur une sorte d’hyperacuité, pour l’amener à percevoir ce que, d’habitude, il ne perçoit pas. Le spectacle Company (2015) par exemple débutait par sept minutes de noir complet avec une voix et un travail sonore spatialisé, mobilisant l’oreille du spectateur de manière aiguë.
Le choix d’un cadre, la délimitation d’un espace pour le regard et son élargissement : ce sont des gestes que l’on retrouve dans la notion de paysage. Comment se traduisent-ils dans votre travail scénique ?