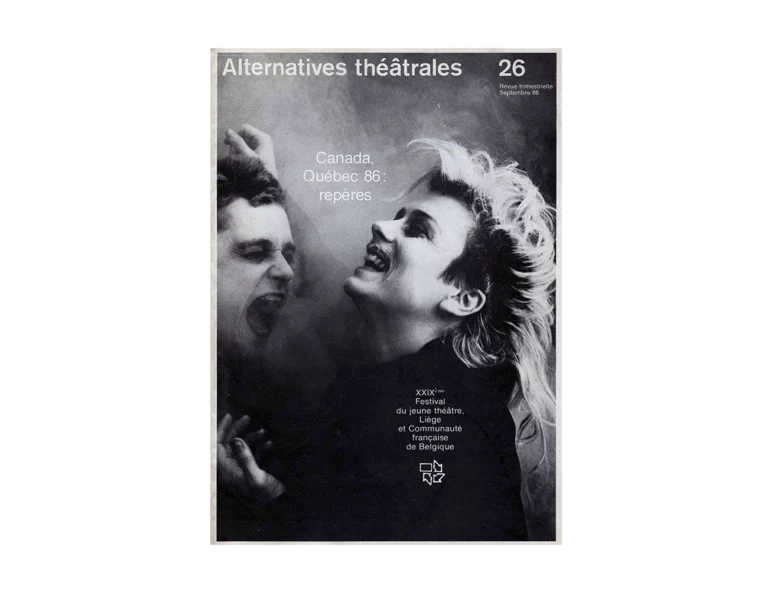«(….) je ne suis pas un homme ni un poête, ni une feuille mais une pulsation blessée qui sonde les choses de l’autre côté. »
Cet extrait d’un poème de Lorca (Poème double du Lac Eden), placé en exergue à Deux tangos pour toute une vie, pourrait être signé Marie Laberge. De même, cette citation de R.D. Laing, en introduction à une autre de ses pièces, Avec l’hiver qui s’en vient : «(.…) quoi de plus digne de mon attention et de mon intérêt que le soi, le cœur humain, l’intellect, les émotions etlou l’univers physique ? (.…) Ou est le cœur ?», qui situe très Simplement, mais si justement le projet dramaturgique de Marie Laberge. Sonder le cœur sous toutes ses coutures, le déterrer, le sortir de Sa gangue mortifère, le délester du poids du mensonge. Tant pis ou tant mieux s’il n’avait à raconter que l’histoire navrante de son exil hors de Soi, s’il n’avait à dire, une fois réanimé, que les monstres qui l’habitent, l’empêchent d’aimer, le rendent fou, le tuent. Toute l’œuvre de Marie Laberge procède d’une quête d’absolu : apprendre à vivre sans Compromission, intensément, passionnément. En toute lucidité, en même temps qu’avec indulgence à l’égard d’elle-même et des Personnages qui, à répétitions, l’entraînent dans leur grand désordre amoureux. L’auteure dit souvent de Son œuvre que c’est une œuvre de silence, pleine de mystères. En apparence, tout semble dit : la facture réaliste fait illusion. Au premier plan, toujours, la tranche de vie, sans jeu de mots, sanglante : des personnages d’hommes et de femmes pris sur le vif, dans le vif de leur douleur, dans un moment crucial de vérité, alors que tout autour conspire à faire lever la barrière des interdits. Une Séparation, un moment de dépression, la maladie, l’ivresse, un viol, un suicide nous livrent les personnages en état de crise, au sens de crisis, les forcent à mettre en mots tous ces non-dits qui leur barrent l’accès à la vie, à l’autre, à la conscience. Les dialogues, cependant, accumulent les mots piégés, les silences, les points de Suspension contribuant ainsi à distendre les fils de la toile pour nous faire voir en creux la face cachée du drame qui se joue. Les faux miroirs volent en éclats, la photo de famille se déchire laissant voir un trou béant, un puits sans fond.
« Je pense qu’on a tous de la folie en soi. Quand on écrit, c’est comme si on enlevait la barrière mentale qu’on a toujours vis-à-vis ce trou-là. On a tous en soi la possibilité de devenir fou ou non (.…) Je pense que la folie est la fuite finale qu’on a au fond, qui est fondamentale et qui fait que la barrière, on la met plus ou moins proche. (.…) C’est comme la passion. On la refuse souvent, on veut pas savoir jusqu’où peuvent aller nos désirs, l’ampleur de nos désirs, c’est refoulé continuellement parce que sinon on croit qu’on serait des monstres, des monstres de désirs, des gouffres d’amour. »1
Plus souvent qu’autrement, c’est une image — un homme qui entre dans un motel avec, dans les mains, deux boîtes de poulet barbecue — une phrase — « comme on fait son lit, on se couche » — un événément — une petite fille, à Barcelone, perdue, qui crie : « maman » —, qui s’imposent à l’auteure, tels des énigmes à déchiffrer. Chaque fois, les personnages qui surgissent semblent sortir de la jarre de Pandore : ils l’entraînent, quasi malgré elle, dans un trajet sinueux, inquiétant, vertigineux.
« Je peux penser, supputer, rêver longtemps une pièce, des années peut-être… mais quand je commence à écrire, c’est une débâcle, une urgence qui prend toute la place et je ne cesse d’écrire (physiquement et dans le temps) qu’une fois le mot FIN inscrit. Et jamais je ne connais cette fin en commençant. Jamais. (…) Il faut que le danger soit là, réel, il me faut aller plus loin que le connu, le dépasser, et creuser, creuser en écrivant jusqu’à l’angoisse fondamentale, la révélation brutale, implacable de ce qui m’habite, du moteur inconscient de l’écriture ou enfin d’une partie de ce qui la fait. Ce n’est qu’une fois arrivée là, dans la mesure où on y arrive puisque jamais cette recherche ne s’épuise, une fois atteint ce fond puissant et indéfinissable que les personnages qui sont plus forts que moi, plus forts que mon contrôle conscient, agissent d’eux-mêmes et se précipitent vers la fin qu’eux seuls, finalement, portaient. »2
Un fil d’ariane
Toute cette faune si étrange, qui l’habite, la ramène toujours là où la blessure est à son plus coupant, à cette blessure qui provient de la famille, du drame initial savamment occulté. Au fil des mots, que semblent lui dicter ses personnages, toujours secs, décapants, cassants comme une volée de coups de couteau, la syntaxe se bouscule, le dessein se précise, la tragédie s’installe, impose son décor. Toujours ou presque, dans les pièces de Marie Laberge, l’espace scénique est dédoublé : au premier plan, la scène du drame qui renvoie, au deuxième plan, à une autre scène, celle du souvenir, du rêve ou du phantasme. Lieu occulté où se profilent tous ces monstres d’amour qui alimentent la terreur des personnages, leur peur de la folie et que l’action qui se déroule au premier plan découvre peu à peu. Des objets, en apparence anodins, se révèlent aussi investis par les personnages d’une symbolique qui réactive le passé et, plus loin, tous ces archétypes qui modèlent les comportements du père, de la mère, de la fille, du fils, de la tante, de l’amie, de l’étrangère au clan familial. Oedipe, Médée, Electre, Iphigénie, Ariane, Hyppolite, Pandore sont, peut-être, les véritables actants du drame, ces figures monstrueuses auxquelles les personnages ont peur de ressembler.
« Il y a un sous-sol émotif qui me construit, une logique très grande, supérieure à ma logique consciente, une sorte de logique émotionnelle qui, branchée sur des thèmes qui toujours me déchireront, fait l’intérêt et la valeur de ce que j’écris. Et pour ne pas me censurer, m’empêcher d’écrire avec cet abandon et cette intégrité, je n’écris que ce qui m’est essentiel, que ce qui s’impose, s’oblige, devient une obsession. Sans obsession, pas d’écriture pour moi. (…) Je ne crois pas, encore une fois, à la création nécessairement souffrante, mais je sais que lorsque l’émotion fait aller ma plume tout croche, que lorsque je hachure mes phrases parce que des larmes m’étouffent et qu’il faut continuer à écrire parce qu’entfin j’atteins le cœur de mon propos, le cœur de mon angoisse et, disons-le donc, de ma souffrance, je sais que je livre alors un secret fondamental que même moi j’ignorais et qui résiste à mon analyse. On apprend à voir à travers les larmes. Ce n’est pas une raison pour arrêter. Ou se taire. »3